Séraphita (Balzac)
Entre Drontheim et Christiania, se trouve une baie nommée le Stromfiord. Si le Stromfiord n’est pas le plus beau des paysages, il a du moins le mérite de résumer les magnificences terrestres de la Norvège, et d’avoir servi de théâtre aux scènes d’une histoire vraiment céleste. Quelques écueils de formes fantastiques en défendent l’entrée aux vaisseaux. . Le Fiord est fermé dans le fond par un bloc de gneiss couronné de forêts, d’où tombe en cascades une rivière qui à la fonte des neiges devient un fleuve, forme une nappe d’une immense étendue, s’échappe avec fracas en vomissant de vieux sapins et d’antiques mélèzes, aperçus à peine dans la chute des eaux. La montagne qui dans le Stromfiord reçoit à ses pieds les assauts de la mer et à sa cime ceux des vents du nord, se nomme le Falberg. La partie du Fiord d’où s’échappent les eaux, sous les pieds de la forêt, s’appelle le Siegdalhen, mot qui pourrait être traduit par le versant de la Sieg, nom de la rivière. La courbure qui fait face aux tables du Falberg est la vallée de Jarvis, joli paysage dominé par des collines chargées de sapins, de mélèzes, de bouleaux, de quelques chênes et de hêtres. Au bas des montagnes de Jarvis se trouve le village composé de deux cents maisons de bois, où vit une population perdue là, comme dans une forêt ces ruches d’abeilles qui, sans augmenter ni diminuer, végètent heureuses, en butinant leur vie au sein d’une sauvage nature. Le village de Jarvis aurait peut-être pu communiquer avec la Norvège intérieure et la Suède par la Sieg ; mais, pour être mis en rapport avec la civilisation, le Stromfiord voulait un homme de génie. Ce génie parut en effet : ce fut un poète, un Suédois religieux qui mourut en admirant et respectant les beautés de ce pays, comme un des plus magnifiques ouvrages du Créateur. Il y a au-dessus des prairies de la plage, sur le dernier pli de terrain qui s’ondule au bas des hautes collines de Jarvis, deux ou trois cents maisons couvertes en nœver, espèce de couvertures faites avec l’écorce du bouleau, maisons toutes frêles, plates. Au-dessus de ces humbles, de ces paisibles demeures, est une église construite avec une simplicité qui s’harmonie à la misère du village. Un cimetière entoure le chevet de cette église, et plus loin se trouve le presbytère. Encore plus haut, sur une bosse de la montagne est située une habitation, la seule qui soit en pierre, et que pour cette raison les habitants ont nommée le château Suédois. En effet, un homme riche vint de Suède, trente ans avant le jour où cette histoire commence, et s’établit à Jarvis, en s’efforçant d’en améliorer la fortune. Cette petite maison, construite dans le but d’engager les habitants à s’en bâtir de semblables, était remarquable par sa solidité, par un mur d’enceinte, chose rare en Norvège, où, malgré l’abondance des pierres, l’on se sert de bois pour toutes les clôtures, même pour celles des champs.
L’hiver de 1799 à 1800 fut un des plus rudes dont le souvenir ait été gardé par les Européens ; la mer de Norvège se prit entièrement dans les Fiords, où la violence du ressac l’empêche ordinairement de geler. Les dangers de la moindre course retenaient au logis les plus intrépides chasseurs qui craignaient de ne plus reconnaître sous la neige les étroits passages pratiqués au bord des précipices, des crevasses ou des versants. Aussi nulle créature n’animait-elle ce désert blanc où régnait la bise du pôle, seule voix qui résonnât en de rares moments. Là, rien ne trahissait la vie. Une seule puissance, la force improductive de la glace, régnait sans contradiction. Le bruissement de la pleine mer agitée n’arrivait même pas dans ce muet bassin, si bruyant durant les trois courtes saisons où la nature se hâte de produire les chétives récoltes nécessaires à la vie de ce peuple patient. Chaque famille restait au coin du feu, dans une maison soigneusement close, fournie de biscuit, de beurre fondu, de poisson sec, de provisions faites à l’avance pour les sept mois d’hiver. Pendant ces terribles hivers, les femmes tissent et teignent les étoffes de laine ou de toile dont se font les vêtements, tandis que la plupart des hommes lisent ou se livrent à ces prodigieuses méditations qui ont enfanté les profondes théories, les rêves mystiques du nord, ses croyances, ses études si complètes sur un point de la science fouillé comme avec une sonde ; mœurs à demi monastiques qui forcent l’âme à réagir sur elle-même, à y trouver sa nourriture, et qui font du paysan norvégien un être à part dans la population européenne. Dans la première année du dix-neuvième siècle, et vers le milieu du mois de mai, tel était donc l’état du Stromfiord.
Par une matinée où le soleil éclatait au sein de ce paysage en y allumant les feux de tous les diamants éphémères produits par les cristallisations de la neige et des glaces, deux personnes passèrent sur le golfe, le traversèrent et volèrent le long des bases du Falberg, vers le sommet duquel elles s’élevèrent de frise en frise. Elles s’appelaient Séraphîtüs et Minna. Le couple avançait grâce à des patins en bois attachés à leurs pieds. Ils étaient déjà montés au tiers du Bonnet de glace, le pic auquel Minna donna le nom populaire sous lequel on le connaît en Norvège. Ils s’élancèrent sur les faibles sentiers tracés le long de la montagne, en y dévorant les distances et volant d’étage en étage, de ligne en ligne, avec la rapidité dont est doué le cheval arabe, cet oiseau du désert. Ils atteignirent un tapis d’herbes, de mousses et de fleurs, sur lequel personne ne s’était encore assis. Séraphîtüs donna soudain à Minna une plante hybride que ses yeux d’aigle lui avaient fait apercevoir parmi des silènes acaulis et des saxifrages, véritable merveille éclose sous le souffle des anges. Minna saisit avec un empressement enfantin la touffe d’un vert transparent et brillant comme celui de l’émeraude, formée par de petites feuilles roulées en cornet, d’un brun clair au fond, mais qui, de teinte en teinte, devenaient vertes à leurs pointes partagées en découpures d’une délicatesse infinie. Il lui demanda de garder cette fleur unique comme un souvenir de cette matinée unique dans sa vie. Çà et là, sur le sol, s’élevaient des étoiles blanches, bordées d’un filet d’or, du sein desquelles sortaient des anthères pourprées, sans pistil. Une odeur qui tenait à la fois de celle des roses et des calices de l’oranger, mais fugitive et sauvage, achevait de donner quelque chose de céleste à cette fleur mystérieuse que Séraphîtüs contemplait avec mélancolie, comme si la senteur lui en eût exprimé de plaintives idées que, lui seul ! il comprenait. Mais à Minna, ce phénomène inouï parut être un caprice par lequel la nature s’était plu à douer quelques pierreries de la fraîcheur, de la mollesse et du parfum des plantes. Il défit les patins de Minna, aux pieds de laquelle il s’était agenouillé. L’enfant ne s’en apercevait pas, tant elle s’émerveillait du spectacle imposant que présente la vue de la Norvège, dont les longs rochers pouvaient être embrassés d’un seul coup d’œil, tant elle était émue par la solennelle permanence de ces cimes froides, et que les paroles ne sauraient exprimer. Elle aurait voulu délier les siens en lui baisant les pieds. Il lui demanda de garder ces paroles pour Wilfrid. Minna lui dit que jamais il n’avait été si beau, en s’asseyant sur une roche moussue et s’abîmant dans la contemplation de l’être qui l’avait conduite sur une partie du pic qui de loin semblait inaccessible. Quelque mollement effilées que fussent ses mains qu’il avait dégantées pour délier les patins de Minna, elles paraissaient avoir une force égale à celle que le Créateur a mise dans les diaphanes attaches du crabe. Les feux jaillissant de son regard d’or luttaient évidemment avec les rayons du soleil, et il semblait ne pas en recevoir, mais lui donner de la lumière. Son corps, mince et grêle comme celui d’une femme, attestait une de ces natures faibles en apparence, mais dont la puissance égale toujours le désir, et qui sont fortes à temps. Quant à Minna, elle eût éclipsé par sa grâce féminine les plus belles têtes dues à Raphaël. Le teint de Séraphîtüs était d’une blancheur surprenante que faisaient encore ressortir des lèvres rouges, des sourcils bruns et des cils soyeux, seuls traits qui tranchassent sur la pâleur d’un visage dont la parfaite régularité ne nuisait en rien à l’éclat des sentiments : ils s’y reflétaient sans secousse ni violence, mais avec cette majestueuse et naturelle gravité que nous aimons à prêter aux êtres supérieurs. Tout, dans cette figure marmorine, exprimait la force et le repos. Minna se leva pour prendre la main de Séraphîtüs, en espérant qu’elle pourrait ainsi l’attirer à elle, et déposer sur ce front séducteur un baiser arraché plus à l’admiration qu’à l’amour ; mais un regard du jeune homme, regard qui la pénétra comme un rayon de soleil traverse le prisme, glaça la pauvre fille. Elle sentit, sans le comprendre, un abîme entre eux, détourna la tête et pleura. Tout à coup une main puissante la saisit par la taille, une voix pleine de suavité lui dit : – Viens. Elle obéit, posa sa tête soudain rafraîchie sur le cœur du jeune homme, qui réglant son pas sur le sien, douce et attentive conformité, la mena vers une place d’où ils purent voir les radieuses décorations de la nature polaire. Elle lui demanda pourquoi il la repoussait et il lui conseilla de mêle toujours l’idée du Tout-Puissant aux affections d’ici-bas, et elle aimerait alors toutes les créatures, et son cœur ira bien haut ! mais il ne pouvait être son compagnon. Il voulut prier. Séraphîtüs plia le genou, se posa les mains en croix sur le sein et Minna tomba sur ses genoux en pleurant. Ils restèrent ainsi pendant quelques instants. Elle voulut savoir pourquoi il ne pleurait pas quand elle pleurait. Il lui répondit que ceux qui étaient tout esprit ne pleuraient pas et qu’il ne voyait plus les misères humaines. Elle pensait qu’il ne l’aimait pas. Il lui expliqua qu’il était sans goût pour les fruits de la terre car il avait reçu le don de vision. Il voulait qu’elle le quitte car il n’avait rien de ce qu’elle voulait de lui. Son amour était trop grossier pour lui. Il lui demanda pourquoi elle n’aimait pas Wilfrid, un homme éprouvé par les passions, qui saurait la serrer dans ses bras nerveux, qui lui fera sentir une main large et forte. Il lui ordonna d’aimer Wilfrid. Il la considérait comme une pauvre enfant de la terre où sa destinée la clouait invinciblement. Il s’empara de Minna par un geste qui la força de venir au bord du sœler d’où la scène était si étendue qu’une jeune fille pleine d’enthousiasme pouvait facilement se croire au-dessus du monde. Il souhaitait un compagnon pour aller dans le royaume de lumière, il avait voulu lui montrer ce morceau de boue, et il l’y voyait encore attachée. Alors il l’incita à obéir à sa nature, pâlir avec les hommes pâles, rougir avec les femmes, jouer avec les enfants, prier avec les coupables, lever les yeux vers le ciel dans ses douleurs. Il se voyait comme un proscrit, loin du ciel ; et comme un monstre, loin de la terre. Son cœur ne palpitait plus ; il ne vivait que par lui et pour lui. Il était seul. il se résignait et attendait.
En un moment, leurs patins furent rattachés, et tous deux descendirent le Falberg par les pentes rapides qui l’unissaient aux allées de la Sieg. Quand ils atteignirent les chemins du Siegdalhen et qu’il leur fut permis de voyager presque sans crainte en ligne droite pour regagner la glace du Stromfiord, Séraphîtüs arrêta Minna : – Tu ne me dis plus rien, demanda-t-il.
– Je croyais, répondit respectueusement la jeune fille, que vous vouliez penser tout seul.
Séraphîtüs commençait à laisser sa force mâle et à dépouiller ses regards de leur trop vive intelligence. Bientôt ces deux jolies créatures cinglèrent sur le Fiord, atteignirent la prairie de neige qui se trouvait entre la rive du golfe et la première rangée des maisons de Jarvis ; puis, pressées par la chute du jour, elles s’élancèrent en montant vers le presbytère, comme si elles eussent gravi les rampes d’un immense escalier. Le couple était devant le porche de l’humble demeure où monsieur Becker, le pasteur de Jarvis, lisait en attendant sa fille pour le repas du soir. C’était le père de Minna. Séraphîtüs lui annonça qu’il lui ramenait sa fille. Becker crut que Séraphîtüs était une femme. Séraphîtüs inclina la tête par un geste coquet, salua le vieillard, partit, et en quelques instants arriva dans la cour du château suédois. Un serviteur octogénaire apparut sous l’immense auvent en tenant une lanterne. Séraphîtüs quitta ses patins avec la dextérité gracieuse d’une femme, s’élança dans le salon du château, tomba sur un grand divan couvert de pelleteries, et s’y coucha. Séraphîtüs défit sa pelisse fourrée de martre, s’y roula, et dormit. Son vieux serviteur resta pendant quelques moments debout à contempler avec amour l’être singulier qui reposait sous ses yeux, et dont le genre eut été difficilement défini par qui que ce soit, même par les savants. Le serviteur pensait que son maître souffrait et ne voulait pas le lui dire. Il croyait qu’il se mourait comme une fleur frappée par un rayon de soleil trop vif. Et il pleura, le vieil homme.
II
Séraphîta
Pendant la soirée, David vint annoncer à Séraphîta l’arrivée de Wilfrid. David la trouva fatiguée. Elle lui dit avoir commis la folie de traverser le Fiord avec Minna et monté sur le Falberg. David s’énerva et ordonna à Séraphîta de ne pas mettre en doute son amour. Il pensait qu’elle prenait Minna comme une hache, et l’en frappait à coups redoublés. Elle lui demanda ce qu’elle pouvait pour lui et il voulait qu’elle l’aime comme lui l’aimait. Il lui pardonna pensant qu’elle ne savait ce qu’elle faisait. Elle rétorqua qu’une femme, depuis Ève, avait toujours fait sciemment le bien et le mal. Elle pensait que Wildrid ne l’aimait pas. Il voulut savoir pourquoi elles étaient allées sur le Falberg. Elle lui demanda son avis sur la question mais il lui reprocha de ne rien admettre au monde. Elle affirma qu’elle n’était pas une femme et qu’il avait tort de l’aimer. Elle quittait les régions éthérées de sa prétendue force, se faisait humblement petite, se courbait à la manière des pauvres femelles de toutes les espèces, et Wilfrid la rehaussait aussitôt. Elle avait besoin de son bras, et il la repoussait. Ils ne s’entendaient pas. Elle était fatiguée et ne voulait plus l’amuser. Elle avait plus de cent ans et ne voulait plus de lui. Elle lui ordonna d’aller aux pieds de Minna. Wilfrid ne reconnaissait plus en je ne reconnais plus en Séraphîta la pure et céleste jeune fille qu’il avait vue pour la première fois dans l’église de Jarvis. Elle lui dit qu’il avait raison. Elle avait toujours tort de mettre les pieds sur sa terre. Il lui demanda d’être son étoile mais elle repoussa sa main sans colère. Wilfrid se leva brusquement, et s’alla placer près de la fenêtre, vers laquelle il se tourna pour ne pas laisser voir à Séraphîta quelques larmes qui lui roulèrent dans les yeux. Alors elle lui dit qu’il n’était plus un enfant et lui demanda de revenir près d’elle. Elle lui reprocha de l’aimer pour lui et non pour elle. Puis elle se leva et lui dit qu’elle ne pouvais être à lui. Elle pensait que deux sentiments dominaient les amours qui séduisaient les femmes de la terre. Ou elles se dévouaient à des êtres souffrants, dégradés, criminels, qu’elles voulaient consoler, relever, racheter ; ou elles se donnaient à des êtres supérieurs, sublimes, forts, qu’elles voulaient adorer, comprendre, et par lesquels souvent elles étaient écrasées. Wilfrid avez été dégradé, mais il s’était épuré dans les feux du repentir, et il était grand aujourd’hui ; Séraphîta se sentait trop faible pour être son égale, et était trop religieuse pour s’humilier sous une puissance autre que celle d’En-Haut. Wilfrid répondit qu’il souffrait toujours en la voyant user de la science monstrueuse avec laquelle elle dépouillait toutes les choses humaines des propriétés que leur donnaient le temps, l’espace, la forme, pour les considérer mathématiquement. Alors elle affirma qu’elle lui obéirait. Elle détourna la conversation sur un tapis de peau d’ours. Il la complimenta pour son goût et elle lui reprocha d’endormir ses douleurs avec des paroles qu’il avait dites à d’autres. Il voulut partir mais elle l’encouragea à se marier avec Minna quand il ne la verrait plus. Séraphîta pensait que le ciel les avait destinés l’un à l’autre. Elle le tourmentait, et il était venu dans cette sauvage contrée pour y trouver le repos. Wilfrid était tombé demi-mort sur le tapis, mais Séraphîta souffla sur le front de cet homme qui s’endormit aussitôt paisiblement à ses pieds. Après avoir imposé ses mains au-dessus du front de Wilfrid, elle lui dit qu’elle l’aimait d’un amour qui était la vraie lumière. Elle voulait le faire entrer par avance dans le monde où les plus pures joies du plus pur attachement qu’on éprouve sur cette terre feraient une ombre dans le jour qui vient incessamment éclairer et réjouir les cœurs. En atteignant au but de son voyage, Wilfrid entendrait sonner les clairons de la toute-puissance, retentir les cris de la victoire. Puis elle étendit la main, et Wilfrid se leva. Quand il regarda Séraphîta, la blanche jeune fille était couchée sur la peau d’ours, la tête appuyée sur sa main, le visage calme, les yeux brillants. Wilfrid la contempla silencieusement, mais une crainte respectueuse animait sa figure, et se trahissait par une contenance timide. Il savait maintenant qu’ils étaient séparés par des mondes entiers. Il se résignait, et ne pouvait qu’adorer Séraphîta. Aors elle l’enjoignit à revenir le lendemain boire le thé avec monsieur Becker et Minna. Quoiqu’il voulût s’éloigner, il demeura pendant quelques moments debout, occupé à regarder la lumière qui brillait par les fenêtres du château suédois. Il se demandait ce qu’il avait vu. Il savait que c’était une création, un monde, entrevu à travers des voiles et des nuages, dont il lui restait des retentissements semblables aux souvenirs d’une douleur dissipée. Il savait que Séraphîta était le centre rayonnant d’un cercle qui formait autour d’elle une atmosphère plus étendue que ne l’est celle des autres êtres : quiconque y entrait, subissait le pouvoir d’un tourbillon de clartés et de pensées dévorantes. Après avoir franchi l’enceinte de cette maison, il reconquit son libre arbitre, marcha précipitamment vers le presbytère, et se trouva bientôt sous la haute voûte en bois qui servait de péristyle à l’habitation de monsieur Becker. Il salua fort affectueusement Minna, serra la main de monsieur Becker, promena ses regards sur un tableau dont les images calmèrent les convulsions de sa nature physique. Depuis quelques jours, lorsque Wilfrid entrait chez Séraphîta, son corps y tombait dans un gouffre. Par un seul regard, cette singulière créature l’entraînait en esprit dans la sphère où la Méditation entraîne le savant, où la Prière transporte l’âme religieuse, où la Vision emmène un artiste, où le Sommeil emporte quelques hommes ; car à chacun sa voix pour aller aux abîmes supérieurs, à chacun son guide pour s’y diriger, à tous la souffrance au retour. Là seulement se déchirent les voiles et se montre à nu la Révélation, ardente et terrible confidence d’un monde inconnu, duquel l’esprit ne rapporte ici-bas que des lambeaux. Il sortait brisé de chez Séraphîta comme une jeune fille qui s’est épuisée à suivre la course d’un géant. Il tomba dans un fauteuil, et regarda pendant quelque temps autour de lui, comme un homme qui s’éveille. Becker proposa à Wilfrid de fumer une pipe. Il accepta. Minna remarqua sa fatigue. Il était toujours ainsi quand il sortait du château. Depuis ces deux derniers mois, chaque jour les chaînes l’attachaient à Jarvis s’étaient plus fortement rivées, et il avait peur d’y finir ses jours. Becker lisait le livre des INCANTATIONS de Jean Wier et Wilfrid savait qu’il pourrait le comprendre. Il décrivit l’enchantement qu’il subissait et parla de Séraphîta qui faisait partie de ces êtres qui enchantent les humains, les dominent, les réduisent à un horrible vasselage, et font peser sur eux les magnificences et le sceptre d’une nature supérieure en agissant tantôt à la manière de la torpille qui électrise et engourdit le pêcheur ; tantôt comme une dose de phosphore qui exalte la vie ou en accélère la projection ; tantôt comme l’opium qui endort la nature corporelle, dégage l’esprit de ses liens, le laisse voltiger sur le monde, le lui montre à travers un prisme, et lui en extrait la pâture qui lui plaît le plus ; tantôt enfin comme la catalepsie qui annule toutes les facultés au profit d’une seule vision. Pour Wilfrid, Séraphîta était un de ces rares et terribles démons auxquels il était donné d’étreindre les hommes, de presser la nature et d’entrer en partage avec l’occulte pouvoir de Dieu. Le cours de ses enchantements avait commencé chez lui par le silence qui lui était imposé. Chaque fois qu’il osait vouloir interroger monsieur Becker sur elle, il lui semblait qu’il allait révéler un secret dont il devait être l’incorruptible gardien ; chaque fois qu’il avait voulu le questionner, un sceau brûlant s’était posé sur ses lèvres. Il saisit donc le moment où il avait le courage de résister à ce monstre qui l’entraînait après lui, sans se demander s’il pouvait suivre son vol. Il demanda des détails sur elle à Becker. - Ceci ressemble fort au discours d’un homme amoureux, dit naïvement le bon pasteur. – Vous l’aimez donc ? dit Minna d’un ton de reproche. Wilfrid répondit qu’il quittait Séraphîta toujours plus désolé et revenait toujours avec plus d’ardeur, comme les savants qui cherchent un secret et que la nature repousse. Minna évoqua sa course sur les sommets du Falberg avec Séraphîtus. Becker fut surpris alors elle lui montra la fleur qu’elle avait reçue de Séraphîtus en guise de preuve. Becker dit à Wilfrid que pour lui expliquer la naissance de Séraphîta, il était nécessaire de lui débrouiller les nuages de la plus obscure de toutes les doctrines chrétiennes. Il allait aborder la doctrine de Swedenborg.
III
Séraphîta-Séraphîtüs
Selon ses disciples, Swedenborg aurait été vu à Jarvis et à Paris postérieurement à la date de sa mort. La vie d’Emmanuel Swedenborg fut scindée en deux parts, reprit le pasteur. De 1688 à 1745, le baron Emmanuel de Swedenborg apparut dans le monde comme un homme du plus vaste savoir, estimé, chéri pour ses vertus, toujours irréprochable, constamment utile. Tout en remplissant de hautes fonctions en Suède, il avait publié de 1709 à 1740, sur la minéralogie, la physique, les mathématiques et l’astronomie, des livres nombreux et solides qui éclairèrent le monde savant. Il étudia pendant sa jeunesse les langues hébraïque, grecque, latine et les langues orientales dont la connaissance lui devint si familière, que plusieurs professeurs célèbres l’avaient consulté souvent, et qu’il put reconnaître dans la Tartarie les vestiges du plus ancien livre de la Parole, nommé LES GUERRES DE JEHOVAH, et LES ÉNONCÉS dont il est parlé par Moïse dans les NOMBRES. Monsieur de Thomé prouva par des citations victorieuses, tirées des œuvres encyclopédiques de Swedenborg, que ce grand prophète avait devancé de plusieurs siècles la marche lente des sciences humaines. Monsieur Becker montra une longue planche attachée entre le poêle et la croisée sur laquelle étaient des livres de toutes grandeurs, dix-sept ouvrages différents, dont un seul, ses Œuvres Philosophiques et Minéralogiques, publiées en 1734, avaient trois volumes in-folio. Ces productions, qui attestaient les connaissances positives de Swedenborg, lui avaient été données par monsieur Séraphîtüs, son cousin, père de Séraphîta. En 1740, Swedenborg tomba dans un silence absolu, d’où il ne sortit que pour quitter ses occupations temporelles, et penser exclusivement au monde spirituel. Il reçut les premiers ordres du Ciel en 1745. Un soir, à Londres, après avoir dîné de grand appétit, un brouillard épais se répandit dans sa chambre. Quand les ténèbres se dissipèrent, une créature qui avait pris la forme humaine se leva du coin de sa chambre, et lui dit d’une voix terrible : Ne mange pas tant ! Il fit une diète. La nuit suivante, le même homme vint, rayonnant de lumière, et lui dit : Je suis envoyé par Dieu qui t’a choisi pour expliquer aux hommes le sens de sa parole et de ses créations. Je te dicterai ce que tu dois écrire. Pendant cette nuit, les yeux de son homme intérieur furent ouverts et disposés pour voir dans le Ciel, dans le monde des Esprits et dans les Enfers ; trois sphères différentes où il rencontra des personnes de sa connaissance, qui avaient péri dans leur forme humaine, les unes depuis longtemps, les autres depuis peu. Dès ce moment, Swedenborg avait constamment vécu de la vie des Esprits, et resta dans ce monde comme Envoyé de Dieu. L’état de vision dans lequel Swedenborg se mettait à son gré, relativement aux choses de la terre, et qui étonna tous ceux qui l’approchèrent par des effets merveilleux, n’était qu’une faible application de sa faculté de voir les cieux. Parmi ces visions, celles où il raconta ses voyages dans les TERRES ASTRALES ne furent pas les moins curieuses, et ses descriptions devaient nécessairement surprendre par la naïveté des détails. Il décrivit les mœurs des peuples attachés aux planètes du système solaire. Swedenborg vivait caché, sans vouloir s’enrichir ou parvenir à la célébrité. Il se distinguait même par une sorte de répugnance à faire des prosélytes, s’ouvrait à peu de personnes, et ne communiquait ces dons extérieurs qu’à celles en qui éclataient la foi, la sagesse et l’amour. Une seule personne, un prêtre suédois, nommé Matthésius, l’accusa de folie. Par un hasard extraordinaire, ce Matthésius, ennemi de Swedenborg et de ses écrits, devint fou peu de temps après, et vivait encore il y a quelques années à Stockholm avec une pension accordée par le roi de Suède. Il avait prédit fort exactement le jour et l’heure de sa mort. Le jour même, le dimanche 29 mars 1772, il demanda l’heure. – Cinq heures, lui répondit-on. – Voilà qui est fini, dit-il, Dieu vous bénisse ! Puis, dix minutes après, il expira de la manière la plus tranquille en poussant un léger soupir. Il publia successivement ainsi vingt-sept traités différents, tous écrits, dit-il, sous la dictée des Anges. Becker avait lu Swedenborg en entier. Il pensait qu’en le lisant, il fallait ou perdre le sens, ou devenir un Voyant. Mais Becker avait résisté à ces deux folies, il avait souvent éprouvé des ravissements inconnus, des saisissements profonds, des joies intérieures que donnaient seules la plénitude de la vérité, l’évidence de la lumière céleste. Selon becker, il était impossible de ne pas être frappé d’étonnement en songeant que, dans l’espace de trente ans, Swedenborg avait publié, sur les vérités du monde spirituel, vingt-cinq volumes in-quarto, écrits en latin, dont le moindre avait cinq cents pages, et qui étaient tous imprimés en petits caractères. Il en avait laissé vingt autres à Londres, déposés à son neveu, M. Silverichm, ancien aumônier du roi de Suède. Becker avait repéré quelques absurdités matérielles semées dans les ouvrages de Swedenborg mais pensait qu’elles avaient peut-être des significations spirituelles. Puis Becker parla des Arcanes qui concernaient la naissance de Séraphîta. Après avoir mathématiquement établi que l’homme vivait éternellement en des sphères, soit inférieures, soit supérieures, Swedenborg appela Esprits Angéliques les êtres qui, dans ce monde, étaientpréparés pour le ciel, où ils devenaient Anges. Selon lui, Dieu n’avait pas créé d’Anges spécialement, il n’en existait point qui n’avait été homme sur la terre. Les Esprits Angéliques passaient par trois natures d’amour, car l’homme ne pouvait être régénéré que successivement (Vraie Religion). D’abord l’AMOUR DE SOI : la suprême expression de cet amour était le génie humain, dont les œuvres obtenaient un culte. Puis l’AMOUR DU MONDE, qui produisait les prophètes, les grands hommes que la Terre prenait pour guides et saluait du nom de divins. Enfin l’AMOUR DU CIEL, qui faisait les Esprits Angéliques. Ces Esprits étaient, pour ainsi dire, les fleurs de l’humanité qui s’y résumait et travaillait à s’y résumer, toujours dans l’Amour avant d’être dans la Sagesse. Ainsi la première transformation de l’homme était l’AMOUR. Pour arriver à ce premier degré, ses existers antérieurs avaient dû passer par l’Espérance et la Charité qui l’engendraient pour la Foi et la Prière. Les idées acquises par l’exercice de ces vertus se transmettaient à chaque nouvelle enveloppe humaine sous laquelle se cachaient les métamorphoses de l’ÊTRE INTÉRIEUR. A chaque transformation les Esprits Angéliques se dépouillaient insensiblement de la chair et de ses erreurs. La seconde transformation était la Sagesse. La Sagesse était la compréhension des choses célestes auxquelles l’Esprit arrivait par l’Amour. L’union qui se faisait d’un Esprit d’amour et d’un Esprit de Sagesse mettait la créature à l’état divin pendant lequel son âme était FEMME, et son corps était HOMME, dernière expression humaine où l’Esprit l’emportait sur la Forme, où la forme se débattait encore contre l’Esprit divin ; car la forme, la chair, ignorait, se révoltait, et voulait rester grossière. Cette épreuve suprême engendrait des souffrances inouïes que les cieux voyaient seuls, et que le Christ avait connues dans le jardin des Oliviers. Après la mort le premier ciel s’ouvrait à cette double nature humaine purifiée. Ainsi le NATUREL, état dans lequel étaient les êtres non régénérés ; le SPIRITUEL, état dans lequel étaient les Esprits Angéliques ; et le DIVIN, état dans lequel demeurait l’Ange avant de briser son enveloppe, étaient les trois degrés de l’exister par lesquels l’homme parvenait au ciel. Il existait un lien mystérieux entre les moindres parcelles de la matière et les cieux et ce lien constituait ce que Swedenborg appelait un ARCANE CÉLESTE. Il existait deux perceptions : l’une interne, l’autre externe ; l’Homme était tout externe, l’Esprit Angélique était tout interne. L’Esprit allait au fond des Nombres, il en possédait la totalité, connaissait leurs signifiances. Il disposait du mouvement et s’associait à tout par l’ubiquité : Un ange, selon le Prophète Suédois, était présent à un autre quand il le désirait (car il avait le don de se séparer de son corps, et voyait les cieux comme les prophètes les avaient vus, et comme Swedenborg les voyait lui-même. « Dans cet état, disait-il (Vraie Religion, 136), l’esprit de l’homme est transporté d’un lieu à un autre, le corps restant où il est ». La doctrine de Swedenborg sur les mariages pouvait se réduire à ce peu de mots : « Le Seigneur a pris la beauté, l’élégance de la vie de l’homme et l’a transportée dans la femme. Quand l’homme n’est pas réuni à cette beauté, à cette élégance de sa vie, il est sévère, triste et farouche ; quand il y est réuni, il est joyeux, il est complet. » Les Anges étaient toujours dans le point le plus parfait de la beauté. Leurs mariages étaient célébrés par des cérémonies merveilleuses. Dans cette union, qui ne produisait point d’enfants, l’homme avait donné L’ENTENDEMENT, la femme avait donné la VOLONTÉ : ils devenaient un seul être, UNE SEULE chair ici-bas ; puis ils allaient aux cieux après avoir revêtu la forme céleste. Tout Swedenborg était là : Souffrir, Croire, Aimer. Pour bien aimer, ne faut-il pas avoir souffert, et ne faut-il pas croire ? L’Amour engendre la Force, et la Force donne la Sagesse ; de là, l’Intelligence ; car la Force et la Sagesse comportent la Volonté. Être intelligent, n’est-ce pas Savoir, Vouloir et Pouvoir, les trois attributs de l’Esprit Angélique. Swedenborg, affectionnait particulièrement le baron de Séraphîtz, dont le nom, suivant un vieil usage suédois, avait pris depuis un temps immémorial la terminaison latine üs. Le baron fut le plus ardent disciple du Prophète suédois qui avait ouvert en lui les yeux de l’Homme Intérieur, et l’avait disposé pour une vie conforme aux ordres d’En-Haut. Il chercha parmi les femmes un Esprit Angélique, Swedenborg le lui trouva dans une vision. Sa fiancée fut la fille d’un cordonnier de Londres, en qui, disait Swedenborg, éclatait la vie du ciel, et dont les épreuves antérieures avaient été accomplies. Après la transformation du Prophète, le baron vint à Jarvis pour faire ses noces célestes dans les pratiques de la prière. Tous deux, ils avaient adouci la misère des habitants, et leur avaient donné à tous une fortune qui n’allait point sans un peu de travail, mais qui suffisait à leurs besoins ; les gens qui vécurent près d’eux ne les avaient jamais surpris dans un mouvement de colère ou d’impatience ; ils avaient été constamment bienfaisants et doux, pleins d’aménité, de grâce et de vraie bonté. La femme était simple dans ses manières, belle de formes, belle de visage, et d’une noblesse semblable à celle des personnes les plus augustes. En 1783, dans la vingt-sixième année de son âge, cette femme conçut un enfant ; sa gestation fut une joie grave. Les deux époux faisaient ainsi leurs adieux au monde, car ils seraient sans doute transformés quand leur enfant aurait quitté la robe de chair qui avait besoin de leurs soins jusqu’au moment où la force d’être par elle-même lui serait communiquée. L’enfant naquit, et fut cette Séraphîta. Dès qu’elle fut conçue, son père et sa mère vécurent encore plus solitairement que par le passé, s’exaltant vers le ciel par la prière. Leur espérance était de voir Swedenborg, et la foi réalisa leur espérance. Le jour de la naissance de Séraphîta, Swedenborg se manifesta dans Jarvis, et remplit de lumière la chambre où naissait l’enfant. Becker voulut la baptiser mais le baron refusa et lui dit : « – Votre ministère est superflu, me dit-il ; notre enfant doit être sans nom sur cette terre. Vous ne baptiserez pas avec l’eau de l’Église terrestre celui qui vient d’être ondoyé dans le feu du Ciel. Cet enfant restera fleur, vous ne le verrez pas vieillir, vous le verrez passer ; vous avez l’exister, il a la vie ; vous avez des sens extérieurs, il n’en a pas, il est tout intérieur. »
L’enfance de Séraphîta fut accompagnée de circonstances extraordinaires dans le climat de Jarvis. Pendant neuf années, les hivers furent plus doux et les étés plus longs que de coutume. Jamais Séraphîta n’avait été vue dans sa nudité, comme le sont quelquefois les enfants ; jamais elle n’avait été touchée ni par un homme ni par une femme ; elle avait vécu vierge sur le sein de sa mère, et n’avait jamais crié. Dès l’âge de neuf ans, l’enfant avait commencé à se mettre en état de prière : la prière était sa vie ; on la voyait au temple, à Noël, seul jour où elle y venait ; elle y était séparée des autres chrétiens par un espace considérable. Si cet espace n’existait pas entre elle et les hommes, elle souffrait. Aussi restait-t-elle la plupart du temps au château. Quand elle eut neuf ans, son père et sa mère expirèrent ensemble, sans douleur, sans maladie visible, après avoir dit l’heure à laquelle ils cesseraient d’être. Debout, à leurs pieds, elle les regarda d’un œil calme, sans témoigner ni tristesse, ni douleur, ni joie, ni curiosité ; son père et sa mère lui souriaient. Elle dit à Becker qu’ils étaient en elle pour toujours. Becker voyait en elle une fille extrêmement capricieuse, gâtée par ses parents, qui lui avaient tourné la tête avec les idées religieuses. Ses parents lui avaient légué l’exaltation funeste qui égarait les mystiques et les rendait plus ou moins fous. Elle se soumettait à des diètes qui désolaient le pauvre David. Becker demanda à Minna si la compagnie de ce démon n’avait rien de bien extraordinaire. Elle répondit qu’elle avait pu, près de lui, sentir des parfums célestes, contempler des merveilles, et ne plus en avoir idée ici. Ce qui avait surpris le plus Becker depuis qu’il connaissait Séraphîta, ce fut de la voir souffrir Wilfrid près d’elle. Wilfrid répondit qu’elle ne l’avait jamais laissé ni lui baiser, ni même lui toucher la main. La terreur lui faisait croire en elle. - Et moi l’amour, dit Minna sans rougir.
Becker avait été fort surpris d’apprendre qu’aujourd’hui, pour la première fois, Minna et Séraphîta étaient allées sur le sommet du Falberg. Minna répondit avoir donc été sous le pouvoir du démon, car elle avait gravi le Falberg avec lui. Wilfrid affirma que Séraphîta exerçait sur lui des pouvoirs si extraordinaires, qu’il ne savait aucune expression qui pouvait en donner une idée. Elle lui avait révélé des choses que lui seul pouvait connaître. C’était du somnambulisme pour Becker. Wilfrid lui demanda les œuvres de Swedenborg car Becker lui avait donné soif. Monsieur Becker tendit un volume à Wilfrid, qui se mit à lire aussitôt. En dévorant les pages du prophète, Wilfrid n’existait plus que par ses sens intérieurs. Parfois, le pasteur le montrait d’un air moitié sérieux, moitié railleur à Minna qui souriait avec une sorte de tristesse. Minuit sonna. La porte extérieure fut violemment ouverte. Des pas pesants et précipités, les pas d’un vieillard effrayé, se firent entendre dans l’espèce d’antichambre étroite qui se trouvait entre les deux portes. Puis, tout à coup, David se montra dans le parloir. Il s’écria que les satans étaient déchaînés contre Séraphîta et leur demanda de venir. Cela faisait cinq heures qu’elle était debout, les yeux levés au ciel, les bras étendus ; elle souffrait, elle criait à Dieu. Becker accepta d’accompagner David pour lui prouver qu’il ne se trouvait chez lui ni Vertumnes, ni Satans, ni Sirènes. Wilfrid, sur qui la lecture d’un premier traité de Swedenborg, qu’il avait rapidement parcouru, venait de produire un effet violent, était déjà dans le corridor, occupé à mettre ses patins. Minna fut prête aussitôt. Tous deux laissèrent en arrière les deux vieillards, et s’élancèrent vers le château suédois. Quand tous deux furent dans la cour, ils ne se sentirent ni la faculté ni la force d’entrer dans la maison. Minna se plaça devant la fenêtre du salon. Elle vit Séraphîtüs debout, légèrement enveloppé d’un brouillard couleur d’opale qui s’échappait à une faible distance de ce corps presque phosphorique. Wilfrid, lui, vit Séraphîta et la trouva belle. En ce moment, monsieur Becker arriva, suivi de David. Il regarda par la fenêtre et vit Séraphîta qui priait. En ce moment, un rayon de la lune, qui se levait sur le Falberg, jaillit sur la fenêtre. Tous se retournèrent émus par cet effet naturel qui les fit tressaillir ; mais quand ils revinrent pour voir Séraphîta, elle avait disparu. David était rentré. Ils revinrent en silence ; aucun d’eux ne comprenait les effets de cette vision de la même manière : Monsieur Becker doutait, Minna adorait, Wilfrid désirait. Au premier abord, Wilfrid semblait devoir être classé parmi les êtres purement instinctifs qui se livrent aveuglément aux besoins matériels ; mais dès le matin de la vie, il s’était élancé dans le monde social avec lequel ses sentiments l’avaient commis ; l’étude avait agrandi son intelligence, la méditation avait aiguisé sa pensée, les sciences avaient élargi son entendement. Il paraissait s’être familiarisé de bonne heure avec les abstractions sur lesquelles reposent les Sociétés. Il avait pâli sur les livres qui sont les actions humaines mortes, puis il avait veillé dans les capitales européennes au milieu des fêtes, il s’était éveillé dans plus d’un lit, il avait dormi peut-être sur le champ de bataille pendant la nuit qui précède le combat et pendant celle qui suit la victoire ; peut-être sa jeunesse orageuse l’avait-elle jeté sur le tillac d’un corsaire à travers les pays les plus contrastants du globe ; il connaissait ainsi les actions humaines vivantes. Il savait donc le présent et le passé ; l’histoire double, celle d’autrefois, celle d’aujourd’hui. Minna soupçonnait le forçat de la gloire en cet homme, et Séraphîta le connaissait ; toutes deux l’admiraient et le plaignaient. Séraphîtus avait dit à Minna posséder le don de Spécialité. La Spécialité constituait une espèce de vue intérieure qui pénétrait tout. Il était en lui comme un miroir où venait se réfléchir la nature morale avec ses causes et ses effets. Il devinait l’avenir et le passé en pénétrant ainsi la conscience. Il avait lu dans l’âme de Wilfrid. Si Wilfrid tenait aux deux premières portions de l’humanité si distinctes, aux hommes de force et aux hommes de pensée ; ses excès, sa vie tourmentée et ses fautes l’avaient souvent conduit vers la Foi, car le doute a deux côtés : le côté de la lumière et le côté des ténèbres. Wilfrid avait trop bien pressé le monde dans ses deux formes, la Matière et l’Esprit, pour ne pas être atteint de la soif de l’inconnu, du désir d’aller au-delà, dont sont presque tous saisis les hommes qui savent, peuvent et veulent. Mais ni sa science, ni ses actions, ni son vouloir n’avaient de direction. Il avait fui la vie sociale par nécessité, comme le grand coupable cherche le cloître. Le remords, cette vertu des faibles, ne l’atteignait pas. Mais en parcourant le monde dont il s’était fait un cloître, Wilfrid n’avait trouvé nulle part de baume pour ses blessures ; il n’avait vu nulle part de nature à laquelle il se pût s’attacher. En lui, le désespoir avait desséché les sources du désir. Il était de ces esprits qui, s’étant pris avec les passions, s’étant trouvés plus forts qu’elles, n’ont plus rien à presser dans leurs serres et achèteraient au prix d’un horrible martyre la faculté de se ruiner dans une croyance. Le jour où, pour la première fois, il vit Séraphîta, cette rencontre lui fit oublier le passé de sa vie. La jeune fille lui causa ces sensations extrêmes qu’il ne croyait plus ranimables. Les cendres laissèrent échapper une dernière flamme et se dissipèrent au premier souffle de cette voix. Tout à coup Wilfrid aima comme il n’avait jamais aimé ; il aima secrètement, avec foi, avec terreur, avec d’intimes folies. Sa vie était agitée dans la source même de la vie, à la seule idée de voir Séraphîta. En l’entendant, il allait en des mondes inconnus ; il était muet devant elle, elle le fascinait. Après avoir épuisé la coupe de l’amour terrestre que ses dents avaient broyée, il apercevait le vase d’élection où brillaient les ondes limpides, et qui donne soif des délices immarcessibles à qui peut y approcher des lèvres assez ardentes de foi pour n’en point faire éclater le cristal. Il avait rencontré ce mur d’airain à franchir qu’il cherchait sur la terre. Il allait impétueusement chez Séraphîta dans le dessein de lui exprimer la portée d’une passion sous laquelle il bondissait comme le cheval de la fable sous ce cavalier de bronze que rien n’émeut, qui reste droit, et que les efforts de l’animal fougueux rendent toujours plus pesant et plus pressant. Il arrivait pour dire sa vie, pour peindre la grandeur de son âme par la grandeur de ses fautes, pour montrer les ruines de ses déserts ; mais quand il avait franchi l’enceinte, et qu’il se trouvait dans la zone immense embrassée par ces yeux dont le scintillant azur ne rencontrait point de bornes en avant et n’en offrait aucune en arrière, il devenait calme et soumis comme le lion qui, lancé sur sa proie dans une plaine d’Afrique, reçoit sur l’aile des vents un message d’amour, et s’arrête. Il était enfant, enfant de seize ans, timide et craintif devant la jeune fille au front serein, devant cette blanche forme dont le calme inaltérable ressemblait à la cruelle impassibilité de la justice humaine. Et le combat n’avait jamais cessé que pendant cette soirée, où d’un regard elle l’avait enfin abattu, comme un milan qui, après avoir décrit ses étourdissantes spirales autour de sa proie, la fait tomber stupéfiée avant de l’emporter dans son aire. Il est en nous-mêmes de longues luttes dont le terme se trouve être une de nos actions, et qui font comme un envers à l’humanité. Cet envers est à Dieu, l’endroit est aux hommes. Plus d’une fois Séraphîta s’était plu à prouver à Wilfrid qu’elle connaissait cet envers si varié, qui compose une seconde vie à la plupart des hommes. Wilfrid se promettait en chemin de l’enlever afin d’en faire une chose à lui. Wilfrid seul était assez fort pour jeter le cri de révolte qu’il venait de pousser chez monsieur Becker, et que le récit du vieillard avait calmé. Cet homme si moqueur, si insulteur, voyait enfin poindre la clarté d’une croyance sidérale en sa nuit ; il se demandait si Séraphîta n’était pas une exilée des sphères supérieures en route pour la patrie. Les déifications dont abusent les amants en tous pays, il n’en décernait pas les honneurs à ce lis de la Norvège, il y croyait. Pourquoi restait-elle au fond de ce Fiord ? qu’y faisait-elle ? C’était donc un amour sans espoir, mais non sans curiosité. Dès le moment où Wilfrid soupçonna la nature éthérée dans la magicienne qui lui avait dit le secret de sa vie en songes harmonieux, il voulut tenter de se la soumettre, de la garder, de la ravir au ciel où peut-être elle était attendue. S’il ne réussissait pas, il la briserait. Il est si naturel de détruire ce qu’on ne peut posséder, de nier ce qu’on ne comprend pas, d’insulter à ce qu’on envie !
Le lendemain, Wilfrid, préoccupé par les idées que devait faire naître le spectacle extraordinaire dont il avait été le témoin la veille, voulut interroger David, et vint le voir en prenant le prétexte de demander des nouvelles de Séraphîta. Le langage constamment figuré, souvent incompréhensible, empêchait les habitants de lui parler ; mais ils respectaient en lui cet esprit profondément dévié de la route vulgaire, que le peuple admire instinctivement. Wilfrid le trouva dans la première salle, en apparence endormi près du poêle. Comme le chien qui reconnaît les amis de la maison, le vieillard leva les yeux, aperçut l’étranger, et ne bougea pas. Wilfrid demanda où était Séraphîta. David agita ses doigts en l’air comme pour peindre le vol d’un oiseau. Il dit que les créatures promises au ciel savaient seules souffrir sans que la souffrance diminue leur amour, ceci était la marque de la vraie foi. Wilfrid lui demanda ce qu’il avait vu la veille au soir. David répondit :
– J’ai vu les Espèces et les Formes, j’ai entendu l’Esprit des choses, j’ai vu la révolte des Mauvais, j’ai écouté la parole des Bons ! Ils sont venus sept démons, il est descendu sept archanges. Les archanges étaient loin, ils contemplaient voilés. Les démons étaient près, ils brillaient et agissaient. Mammon est venu sur sa conque nacrée, et sous la forme d’une belle femme nue ; la neige de son corps éblouissait, jamais les formes humaines ne seront si parfaites, et il disait : « – Je suis le Plaisir, et tu me posséderas ! » Lucifer, le prince des serpents, est venu dans son appareil de souverain, l’Homme était en lui beau comme un ange, et il a dit : – « L’Humanité te servira ! » La reine des avares, celle qui ne rend rien de ce qu’elle a reçu, la Mer est venue enveloppée de sa mante verte ; elle s’est ouvert le sein, elle a montré son écrin de pierreries, elle a vomi ses trésors et les a offerts ; elle a fait arriver des vagues de saphirs et d’émeraudes ; ses productions se sont émues, elles ont surgi de leurs retraites, elles ont parlé ; la plus belle d’entre les perles a déployé ses ailes de papillon, elle a rayonné, elle a fait entendre ses musiques marines, elle a dit : « – Toutes deux filles de la souffrance, nous sommes sœurs ; attends-moi ? nous partirons ensemble, je n’ai plus qu’à devenir femme. » L’Oiseau qui a les ailes de l’aigle et les pattes du lion, une tête de femme et la croupe du cheval, l’Animal s’est abattu, lui a léché les pieds, promettant sept cents années d’abondance à sa fille bien-aimée. Le plus redoutable, l’Enfant, est arrivé jusqu’à ses genoux en pleurant et lui disant : « – Me quitteras-tu ? moi faible et souffrant, reste, ma mère ! » Il jouait avec les autres, il répandait la paresse dans l’air, et le ciel se serait laissé aller à sa plainte. La Vierge au chant pur a fait entendre ses concerts qui détendent l’âme. Les rois de l’Orient sont venus avec leurs esclaves, leurs armées et leurs femmes ; les Blessés ont demandé son secours, les Malheureux ont tendu la main : « – Ne nous quittez pas ! ne nous quittez pas ! » Moi-même j’ai crié : « Ne nous quittez pas ! Nous vous adorerons, restez ! » Les fleurs sont sorties de leurs graines en l’entourant de leurs parfums qui disaient : « – Restez ! » Le géant Énakim est sorti de Jupiter, amenant l’Or et ses amis, amenant les Esprits des Terres Astrales qui s’étaient joints à lui, tous ont dit : « – Nous serons à toi pour sept cents années. » Enfin, la Mort est descendue de son cheval pâle et a dit : « – Je t’obéirai ! » Tous se sont prosternés à ses pieds, et si vous les aviez vus, ils remplissaient la grande plaine, et tous lui criaient : « – Nous t’avons nourri, tu es notre enfant, ne nous abandonne pas. »
La Vie est sortie de ses Eaux Rouges, et a dit : « – Je ne te quitterai pas ! » Puis trouvant Séraphîta silencieuse elle a relui comme le soleil en s’écriant : « – Je suis la lumière ! » – La lumière est là ! s’est écriée Séraphîta en montrant les nuages où s’agitaient les archanges ; mais elle était fatiguée, le Désir lui avait brisé les nerfs, elle ne pouvait que crier : « – Ô mon Dieu ! » Combien d’Esprits Angéliques, en gravissant la montagne, et près d’atteindre au sommet, ont rencontré sous leurs pieds un gravier qui les a fait rouler et les a replongés dans l’abîme ! Tous ces Esprits déchus admiraient sa constance ; ils étaient là formant un Chœur immobile, et tous lui disaient en pleurant : « – Courage ! » Enfin elle a vaincu le Désir déchaîné sur elle sous toutes les Formes et dans toutes les Espèces. Elle est restée en prières, et quand elle a levé les yeux, elle a vu le pied des Anges revolant aux cieux. Le calme du vieux serviteur frappa Wilfrid, qui s’en alla se demandant si ces visions étaient moins extraordinaires que celles dont les relations se trouvaient dans Swedenborg, et qu’il avait lues la veille. En entrant au presbytère, il trouva monsieur Becker seul. Il lui dit que Séraphîta ne tenait à eux que par la forme, et sa forme était impénétrable. Il avait découvert une proie et la voulait. Il demanda à Becker de l’aider. Becker répondit que ce serait une conquête difficile car cette pauvre fille était folle. Wilfrid avait été confondu par l’érudition de Séraphîta et demanda à Becker si elle avait voyagé et beaucoup lu. Becker répondit qu’elle n’avait pas lu une ligne et était resté à Jarvis. Elle n’avait pas eu d’autres amis que Wilfrid et Minna, ni d’autre serviteur que David. Cette fille avait conquis peut-être, pendant quelques années de silence, les facultés dont jouissaient Apollonius de Tyane et beaucoup de prétendus sorciers que l’inquisition avait brûlés, ne voulant pas admettre la seconde vue. Wilfrid dit qu’elle connaissait dans le passé de sa vie des choses dont le secret n’était qu’à lui. Minna rentra. Elle dit que les passions humaines, revêtues de leurs fausses richesses, avaient entouré Séraphîtus pendant la nuit, et lui avaient déroulé des pompes inouïes. Pour Becker, ce n’était que des contes. Wilfrid demanda à Minna si elle croyait à la réalité de ces visions. Elle acquiesca. Wilfrid fut surpris qu’elle parle de Séraphîta au masculin. Becker les trouvait fous.
IV
Les nuées du sanctuaire
L’homme peut se trouver face à face avec une seule créature, et trouver dans un seul mot, dans un seul regard, un faix si lourd à porter, d’un éclat si lumineux, d’un son si pénétrant, qu’il succombe et s’agenouille. Les plus réelles magnificences ne sont pas dans les choses, elles sont en nous-mêmes. Pour le savant, un secret de science n’est-il pas un monde entier de merveilles ? Les trompettes de la Force, les brillants de la Richesse, la musique de la Joie, un immense concours d’hommes accompagne-t-il sa fête ? Non, il va dans quelque réduit obscur, où souvent un homme pâle et souffrant lui dit un seul mot à l’oreille. Ce mot, comme une torche jetée dans un souterrain, lui éclaire les Sciences. Toutes les idées humaines, habillées des plus attrayantes formes qu’ait inventées le Mystère, entouraient un aveugle assis dans la fange au bord d’un chemin. Les trois mondes, le Naturel, le Spirituel et le Divin, avec toutes leurs sphères, se découvraient à un pauvre proscrit florentin : il marchait accompagné des Heureux et des Souffrants, de ceux qui priaient et de ceux qui criaient, des anges et des damnés. Quand l’envoyé de Dieu, qui savait et pouvait tout, apparut à trois de ses disciples, ce fut un soir, à la table commune de la plus pauvre des auberges ; en ce moment la lumière éclata, brisa les Formes Matérielles, éclaira les Facultés Spirituelles, ils le virent dans sa gloire, et la terre ne tenait déjà plus à leurs pieds que comme une sandale qui s’en détachait. Monsieur Becker, Wilfrid et Minna se sentaient agités de crainte en allant chez l’être extraordinaire qu’ils s’étaient proposé d’interroger. Pour chacun d’eux le château suédois agrandi comportait un spectacle gigantesque. Sur les gradins de ce colysée, monsieur Becker asseyait les grises légions du doute, ses sombres idées, ses vicieuses formules de dispute ; il y convoquait les différents mondes philosophiques et religieux qui se combattent, et qui tous apparaissent sous la forme d’un système décharné comme le temps configuré par l’homme. Wilfrid y conviait ses premières illusions et ses dernières espérances ; il y faisait siéger la destinée humaine et ses combats, la religion et ses dominations victorieuses. Minna y voyait confusément le ciel par une échappée, l’amour lui relevait un rideau brodé d’images mystérieuses, et les sons harmonieux qui arrivaient à ses oreilles redoublaient sa curiosité. Pour eux cette soirée était donc ce que le souper fut pour les trois pèlerins dans Emmaüs, ce que fut une vision pour Dante, une inspiration pour Homère ; pour eux, les trois formes du monde révélées, des voiles déchirés, des incertitudes dissipées, des ténèbres éclaircies. L’humanité dans tous ses modes et attendant la lumière ne pouvait être mieux représentée que par cette jeune fille, par cet homme et par ces deux vieillards, dont l’un était assez savant pour douter, dont l’autre était assez ignorant pour croire. Jamais aucune scène ne fut ni plus simple en apparence, ni plus vaste en réalité. Quand ils entrèrent, conduits par le vieux David, ils trouvèrent Séraphîta debout devant la table, sur laquelle étaient servies différentes choses dont se compose un thé, collation qui supplée dans le Nord aux joies du vin, réservées pour les pays méridionaux. Certes, rien n’annonçait en elle, ou en lui, cet être avait l’étrange pouvoir d’apparaître sous deux formes distinctes ; rien donc ne trahissait les différentes puissances dont elle disposait. Vulgairement occupée du bien-être de ses trois hôtes, Séraphîta recommandait à David de mettre du bois dans le poêle. Wilfrid lui demanda si elle avait souffert la veille. Elle répondit que cette souffrance lui plaisait ; elle était nécessaire pour sortir de la vie. Becker ne la croyait pas malade et lui demanda si elle avait peur de la mort. Elle répondit qu’il existait deux manières de mourir : aux uns la mort était une victoire, aux autres elle était une défaite. Elle ajouta que si elle n’avait pas la faculté de lire à travers leurs fronts le désir qui les amenait, serait-elle ce qu’ils croyaient qu’elle était ? Elle les enveloppa tous trois de son regard envahisseur, à la grande satisfaction de David qui se frotta les mains en s’en allant. – Ah ! reprit-elle après une pause, vous êtes venus animés tous d’une curiosité d’enfant. Vous vous êtes demandé, mon pauvre monsieur Becker, s’il est possible à une fille de dix-sept ans de savoir un des mille secrets que les savants cherchent, le nez en terre, au lieu de lever les yeux vers le ciel. Wilfrid admit qu’ils avaient comploté pour l’interroger.
Elle leur dit qu’ils étaient du côté le plus obscur du Doute ; ils ne croyaient pas en Dieu, et toute chose ici-bas devenait secondaire pour qui s’attaquait au principe des choses. L’univers Naturel des choses et des êtres se terminait en l’homme par l’univers Surnaturel des similitudes ou des différences qu’il apercevait entre les innombrables formes de la Nature. Quelque abstraite que l’homme la supposait, la relation qui liait deux choses entre elles comportait une empreinte. L’invisible univers moral et l’invisible univers physique constituaient une seule et même Matière. De quelque façon que l’on veuille mêler un Dieu infini à ce bloc de matière fini, Dieu ne saurait exister avec les attributs dont il est investi par l’homme ; en le demandant aux faits, il est nul ; en le demandant au raisonnement, il sera nul encore ; spirituellement et matériellement, Dieu devient impossible. En mettant Dieu face à face avec ce Grand Tout, il n’est entre eux que deux états possibles. La Matière et Dieu sont contemporains, ou Dieu préexistait seul à la Matière. En supposant la raison qui éclaire les races humaines depuis qu’elles vivent, amassée dans une seule tête, cette tête gigantesque ne saurait inventer une troisième façon d’être, à moins de supprimer Matière et Dieu. Séraphîta expliqua à Becker que supposons si était Dieu contemporain de la Matière ? Serait-ce être Dieu que de subir l’action ou la coexistence d’une substance étrangère à la sienne ? Dans ce système, Dieu ne devenait-il pas un agent secondaire obligé d’organiser la matière ? Qui l’avait contraint ? Entre sa grossière compagne et lui, qui fut l’arbitre ? Qui avait donc payé le salaire des Six journées imputées à ce Grand Artiste ? S’il s’était rencontré quelque force déterminante qui ne fût ni Dieu ni la Matière ; en voyant Dieu tenu de fabriquer la machine des mondes, il serait aussi ridicule de l’appeler Dieu que de nommer citoyen de Rome l’esclave envoyé pour tourner une meule. Si Dieu, forcé d’avoir créé le monde de toute éternité, semblait inexplicable, il l’était tout autant dans sa perpétuelle cohésion avec son œuvre. Dieu, contraint de vivre éternellement uni à sa création, était tout aussi ravalé que dans sa première condition d’ouvrier. Ainsi, dans la conception comme dans l’exécution des mondes, pour tout esprit de bonne foi, supposer la Matière contemporaine de Dieu, c’était vouloir nier Dieu. Si Dieu préexistait seul, le monde avait émané de lui, la Matière fut alors tirée de son essence. Donc, plus de Matière ! Comment croire que le Tout-Puissant, souverainement bon dans son essence et dans ses facultés, ait engendré des choses qui lui sont dissemblables, qu’il ne soit pas en tout et partout semblable à lui-même ? Comment alors supposer une intelligence omnipotente qui ne triomphe pas ? Pourquoi la mort ? pourquoi le génie du mal, ce roi de la terre, a-t-il été enfanté par un Dieu souverainement bon dans son essence et dans ses facultés, qui n’a rien dû produire que de conforme à lui-même ? Que devient la bonté divine en ne nous mettant pas immédiatement dans les régions heureuses, s’il en existe ? Que devient la prescience de Dieu, s’il ignore le résultat des épreuves auxquelles il nous soumet ? Qu’est cette alternative présentée à l’homme par toutes les religions d’aller bouillir dans une chaudière éternelle, ou de se promener en robe blanche, une palme à la main, la tête ceinte d’une auréole ? Séraphîta dit à Becker qu’il avait accusé ses pensées intimes : soit le dogme des deux principes, antagonisme où Dieu périt par cela même que tout-puissant il s’amuse à combattre ; soit l’absurde panthéisme où tout étant Dieu, Dieu n’est plus ; ces deux sources d’où découlent les religions au triomphe desquelles s’est employée la Terre, sont également pernicieuses. Monsieur Becker et Wilfrid regardèrent la Séraphîta avec une sorte d’effroi. – Croire, reprit Séraphîta de sa voix de Femme, car l’Homme venait de parler, croire est un don ! Croire, c’est sentir. Pour croire en Dieu, il faut sentir Dieu. Ce sens est une propriété lentement acquise par l’être, comme s’acquièrent les étonnants pouvoirs que vous admirez dans les grands hommes, chez les guerriers, les artistes et les savants, chez ceux qui savent, chez ceux qui produisent, chez ceux qui agissent. Pour elle, La Croyance, faisceau des vérités célestes, était une langue, mais aussi supérieure à la pensée que la pensée était supérieure à l’instinct. Cette langue s’apprenait. Le Doute n’était ni une impiété, ni un blasphème, ni un crime ; mais une transition d’où l’homme retournait sur ses pas dans les Ténèbres ou s’avançait vers la Lumière. Elle voulut leur faire comprendre qu’ensemble ils avaient également admis que la Matière et l’Esprit étaient deux créations qui ne se comprenaient point l’une l’autre, que le monde spirituel se composait de rapports infinis auxquels donnait lieu le monde matériel fini ; que si nul sur la terre n’avait pu s’identifier par la puissance de son esprit avec l’ensemble des créations terrestres, à plus forte raison nul ne pouvait s’élever à la connaissance des rapports que l’esprit aperçoit entre ces créations. Ainsi, déjà ils pourraient en finir d’un seul coup, en déniant la faculté de comprendre Dieu. Séraphîta employa la métaphore des mathématiques pour développer son argumentation. Dieu était une magnifique Unité qui n’avait rien de commun avec ses créations, et qui néanmoins les engendrait ! Becker ne pouvait qu’ignorer où commençait, où finissait le Nombre, aussi bien qu’il ignorait où commençait, où finissait l’Éternité créée. Pourquoi, si Becker croyait au Nombre, niait-il Dieu ? Pour Séraphîta, l’univers n’était que Nombre et Mouvement. Le Mouvement et le Nombre étaient engendrés par la Parole. L’Infini devait être partout semblable à lui-même, et il était nécessairement un. Dieu seul était infini, car certes il ne pouvait y avoir deux infinis. L’arithmétique, emploi du Nombre, organisait le monde moral. Mais pour Séraphîta, elle était purement relative, elle n’existait pas absolument, Becker ne pouvait donner aucune preuve de sa réalité. Cette Numération était habile à chiffrer les substances organisées, mais impuissante relativement aux forces organisantes, les unes étant finies et les autres étant infinies. L’homme qui concevait l’Infini par son intelligence, ne pouvait le manier dans son entier ; sans quoi, il aurait été Dieu. La Numération, appliquée aux choses finies et non à l’Infini, était donc vraie par rapport aux détails que l’homme percevait, mais fausse par rapport à l’ensemble qu’il ne percevait point. La nature n’était jamais semblable dans ses effets finis et donc on ne pouvait rencontrer nulle part dans la nature deux objets identiques. : dans l’Ordre Naturel, deux et deux ne pouvaent donc jamais faire quatre, car il faudrait assembler des unités exactement pareilles, et il était impossible de trouver deux feuilles semblables sur un même arbre, ni deux sujets semblables dans la même espèce d’arbre. La fraction n’existait pas non plus dans la Nature, où ce que l’homme nommait un fragment était une chose finie en soi. Si la fraction n’existait pas dans l’Ordre Naturel, elle existait encore bien moins dans l’Ordre Moral, où les idées et les sentiments pouvaient être variés comme les espèces de l’Ordre Végétal, mais étaient toujours entiers. La géométrie établissait que la ligne droite était le chemin le plus court d’un point à un autre, mais l’astronomie démontrait que Dieu n’avait procédé que par des courbes. Aucun savant n’avait tiré cette simple induction que la Courbe était la loi des mondes matériels, que la Droite était celle des mondes spirituels : l’une étant la théorie des créations finies, l’autre celle de la théorie de l’infini. Séraphîta reprochait à Becker de croire à la puissance de l’électricité fixée dans l’aimant, et de nier le pouvoir de celle que dégage l’âme. Selon Becker, la lune, dont l’influence sur les marées lui paraissait prouvée, n’en avait aucune sur les vents, ni sur la végétation, ni sur les hommes. Ainsi, la plupart des axiomes scientifiques, vrais par rapport à l’homme, étaient faux par rapport à l’ensemble. En toute chose, il était une apparence qui frappe les sens ; sous cette apparence, il se mouvait une âme : il y avait le corps et la faculté. Swedenborg avait deviné, sur la fin de ses jours, que tout était cause et effet réciproquement ; que les mondes visibles étaient coordonnés entre eux et soumis à des mondes invisibles. Il savait que la vie est produite par l’union de la chose avec son principe, que la mort ou l’inertie, qu’enfin la pesanteur est produite par une rupture entre un objet et le mouvement qui lui est propre ; alors il avait pressenti le craquement de ces mondes, abîmés si Dieu leur retirait sa Parole. Il s’était mis à chercher dans l’Apocalypse les traces de cette Parole ! Séraphîta affirma que Le Voyant et le Croyant trouvaient en eux des yeux plus perçants que ne l’étaient les yeux appliqués aux choses de la terre et apercevaient une Aurore. Elle conclut en disant : - vos sciences les plus exactes, vos méditations les plus hardies, vos plus belles Clartés sont des Nuées. Au-dessus, est le Sanctuaire d’où jaillit la vraie lumière.
Minna se dit que Séraphîtus était plus doux sur le Falberg. Séraphîta demanda à Becker qu’il lui raconte des Sagas. Wilfrid lui demanda pourquoi elle ne se mariait pas. Elle répondit que son mariage était préparé depuis sa naissance. Elle ajouta qu’elle le mènerait dans une voie où il obtiendrait toutes les grandeurs qu’il rêvait, et où l’amour serait vraiment infini si Wilfrid lui obéissait. Elle laissa Wilfrid pensif. Il se demanda si cette douce créature était bien la prophétesse qui venait de jeter des éclairs par les yeux, dont la parole avait tonné sur les mondes, dont la main avait manié contre leurs sciences la hache du doute. Séraphîtus dit à Minna de cesser de s’aventurer dans une région où elle ne trouverait ni sources, ni ombrages. Si naguère elle n’avait pu contempler l’abîme sans être brisée, elle devait garder ses forces pour qui l’aimerait. Il ajouta, pauvre qu’il avait sa fiancée.
Minna se leva et vint avec Séraphîtüs à la fenêtre où était Wilfrid. Les illusions étaient dissipées. Tous admirèrent la nature qui se dégageait de ses entraves et semblait répondre par un sublime accord à l’Esprit dont la voix venait de la réveiller. Lorsque les trois hôtes de cet être mystérieux le quittèrent, ils étaient remplis de ce sentiment vague qui n’est ni le sommeil, ni la torpeur, ni l’étonnement, mais qui tient de tout cela qui n’est ni le crépuscule, ni l’aurore, mais qui donne soif de la lumière. Becker commençait à croire que Séraphîta était un Esprit caché sous une forme humaine. Wilfrid, revenu chez lui, calme et convaincu, ne savait comment lutter avec des forces si divinement majestueuses. Minna se disait : – Pourquoi ne veut-il pas que je l’aime.
V
Les adieux
Il est en l’homme un phénomène désespérant pour les esprits méditatifs qui veulent trouver un sens à la marche des sociétés et donner des lois de progression au mouvement de l’intelligence.Le Doute couvre tout de ses vagues. Les Esprits préparés pour la foi parmi les êtres supérieurs aperçoivent seuls l’échelle mystique de Jacob. Après avoir entendu la réponse où Séraphîta, si sérieusement interrogée, avait déroulé l’Étendue divine, Wilfrid rentra chez lui tout épouvanté d’avoir vu le monde en ruines, et sur ces ruines des clartés inconnues, épanchées à flots par les mains de cette jeune fille. Le lendemain il y pensait encore, mais l’épouvante était calmée ; il ne se sentait ni détruit ni changé ; ses passions, ses idées se réveillèrent fraîches et vigoureuses. Il alla déjeuner chez monsieur Becker, et le trouva sérieusement plongé dans le Traité des Incantations, qu’il avait feuilleté depuis le matin pour rassurer son hôte. Jean Wier rapportait des preuves authentiques qui prouvaient la possibilité des événements arrivés la veille. À la cinquième tasse de thé que prirent ces deux philosophes, la mystérieuse soirée devint naturelle. Les vérités célestes furent des raisonnements plus ou moins forts et susceptibles d’examen. Séraphîta leur parut être une fille plus ou moins éloquente. Néanmoins, Wilfrid ne concevait pas comment une jeune fille de seize ans pouvait savoir tant de choses. Becker lui dit que d’autres cas similaires avaient existé dont une jeune Italienne qui, dès l’âge de douze ans, parlait quarante-deux langues. Pour Wilfrid Séraphîta devait être une femme divine à posséder.
La nature norvégienne fit les apprêts de sa parure pour ses noces d’un jour. Pendant ces moments où l’air adouci permettait de sortir, Séraphîta demeura dans la solitude. La passion de Wilfrid s’accrut ainsi par l’irritation que cause le voisinage d’une femme aimée qui ne se montre pas. Quand cet être inexprimable reçut Minna, Minna reconnut en lui les ravages d’un feu intérieur : sa voix était devenue profonde, son teint commençait à blondir. Minna dit à Wilfrid qu’ils allaient perdre Séraphîtus. Wilfrid lui répondit qu’elle ignorait quel serait son danger si sa jalousie était justement alarmée. Minna rétorqua que sa propre jalousie, si naturelle à l’amour, ne redoutait ici personne. Elle savait que Séraphîtus allait mourir. Wilfrid refusait de croire que Séraphîta était un jeune homme. Il voulait prouver à Minna son erreur. Il vit Séraphîta sortant du château suédois, suivie de David. Cette apparition calma son effervescence. David s’en alla sur un signe de sa maîtresse, au-devant de laquelle vinrent Wilfrid et Minna. Elle leur demanda de la suivre jusqu’aux chutes de la Sieg. Tous trois cheminèrent en silence le long de la grève. Jarvis était un point perdu dans ce paysage, dans cette immensité, sublime comme tout ce qui, n’ayant qu’une vie éphémère, offre une rapide image de la perfection. En haut de ce rocher, certes ces trois êtres pouvaient se croire seuls dans le monde. Pour la première fois, Wilfrid apercevant en Séraphîta les traces d’un sentiment terrestre, crut le moment favorable à l’expression de sa bouillante tendresse. Minna les avait laissés. Elle gravissait un rocher où elle avait aperçu des saxifrages bleues. Wilfrid demanda à Séraphîta d’être à lui pour le bonheur du monde qu’elle portait en son cœur. Pour qu’une voix céleste résonne à son oreille en lui inspirant le bien dans la grande entreprise qu’il avait résolue pour le bien-être des nations. Il avoua avoir voulu entamer la guerre, la répandre comme un incendie, dévorer l’Europe en criant liberté à ceux-ci, pillage à ceux-là, gloire à l’un, plaisir à l’autre ; mais en demeurant, lui, comme la figure du Destin, implacable et cruel. Il était tenté de traverser les steppes russes, d’arriver au bord de l’Asie, de la couvrir jusqu’au Gange de sa triomphante inondation humaine, et là il renverserait la puissance anglaise. Ses pieds couvriront un tiers du globe, comme ceux de Gengis-Kan. Il proposa à Séraphîta d’être sa reine. Elle lui répondit qu’elle avait déjà régné. Des êtres plus puissants qu’il ne l’était lui avaient offert davantage. De plus, elle se disait aimée d’un amour sans bornes. Wilfrid lui demanda par qui en s’avançant par un mouvement de frénésie vers Séraphîta pour la précipiter dans les cascades écumeuses de la Sieg. Elle lui montra Minna qui revenait et courut vers elle. Minna présenta son bouquet à l’être adoré. Elle lui dit qu’elle voulait souffrir en sa place... Séraphîtüs se dit qu’elle était la plus dangereuse des créatures. La voix de la Sieg accompagna les pensées de ces trois êtres qui demeurèrent pendant quelques moments réunis sur une plate-forme de rochers en saillie, mais séparés par des abîmes dans le Monde Spirituel. Minna demanda à Séraphîtus de lui apprendre ce qu’elle devait faire pour ne point l’aimer. Elle considérait l’amour comme une admiration qui ne se lasse jamais. Il lui répondit qu’on ne pouvait aimer ainsi qu’un seul être. Minna cria Au secours ! en voyant Séraphîtus se coucher. Puis il rassembla ses forces pour se lever et s’avança sur le bord du rocher. Il dit adieu au peuple sans patrie, aux terres sans peuples, aux saintes femmes blessées, aux pauvres, aux martyrs de la pensée, au granit, à la fleur, à la femme, qui serait souffrance ; à l’homme, qui serait croyance. Abattu par la fatigue, cet être inexpliqué s’appuya pour la première fois sur Wilfrid et sur Minna pour revenir à son logis. Wilfrid et Minna se sentirent alors atteints par une contagion inconnue. David se montra pleurant et porta Séraphîta au château.
VI
Le chemin pour aller au ciel
Le lendemain du jour où Séraphîta pressentit sa fin et fit ses adieux à la Terre comme un prisonnier regarde son cachot avant de le quitter à jamais, elle ressentit des douleurs qui l’obligèrent à demeurer dans la complète immobilité de ceux qui souffrent des maux extrêmes. Wilfrid et Minna vinrent la voir, et la trouvèrent couchée sur son divan. David pleurait en voyant souffrir sa maîtresse. Un jour elle demanda les deux êtres qu’elle avait affectionnés, en leur disant que ce jour était le dernier de ses mauvais jours. Wilfrid et Minna vinrent saisis de terreur, ils savaient qu’ils allaient la perdre. Séraphîta leur sourit à la manière de ceux qui s’en vont dans un monde meilleur. Minna demanda à Séraphîtus de la laisser le suivre. Il répondit qu’il aimait le Ciel, Dieu. Il aimait Minna car elle pouvait être à Dieu. Si Minna venait à Dieu, elle serait à Séraphîtus. Wilfrid demanda également à Séraphîta de partir avec elle. Séraphîta dit : « Ange, le ciel sera ton héritage ! »
Il se fit entre eux un grand silence après cette exclamation qui détona dans les âmes de Wilfrid et de Minna comme le premier accord de quelque musique céleste. Séraphîta leur expliqua qu’il leur serait nécessaire de quitter leur demeure, de renoncer à leurs projets, de dire adieu à leurs amis, à leur père, à sa mère, à leur sœur, et même au plus petit des frères qui crie, et leur dire des adieux éternels, car ils ne reviendraient pas plus que les martyrs en marche vers le bûcher ne retournaient au logis ; enfin, il faudrait qu’ils se dépouillent des sentiments et des choses auxquels tenaient les hommes, sans quoi ils ne seraient pas tout entiers à Dieu. Peu de créatures savaient choisir entre ces deux extrêmes : ou rester ou partir, ou la fange ou le ciel. Leur destination serait donc un secret entre eux et Dieu, comme l’amour est un secret entre deux cœurs. Ils seraient le trésor enfoui sur lequel passent les hommes affamés d’or, sans savoir que Wilfrid et Minna seraient là. Séraphîta leur expliqua que dans la vie Terrestre, l’amour passager se terminait par des tribulations constantes ; tandis que, dans la vie Spirituelle, les tribulations d’un jour se terminaient par des joies infinies. Leur âme serait incessamment joyeuse. Ils aimeraient, comme Dieu, les créatures d’un inextinguible amour. En eux s’opérerait la séparation nécessaire entre la Matière qui les avait si longtemps environnés de ses ténèbres, et l’Esprit qui naîtrait en eux et les illuminerait, car il ferait alors clair en leur âme. Leur cœur brisé recevrait alors la lumière, elle l’inonderait. Ils ne sentiraient plus alors des convictions en eux, mais d’éclatantes certitudes. La Prière leur donnerait la clef des cieux. La prière qui résultait de tant d’épreuves était la consommation de toutes les vérités, de toutes les puissances, de tous les sentiments. Elle reliait alors l’âme à Dieu, avec qui Wilfrid et Minna s’uniraient comme la racine des arbres s’unit à la terre. La prière ressuscitait partout la vertu, purifiait et sanctifiait tous les actes, peuplait la solitude, donnait un avant-goût des délices éternelles. La résignation était le fruit qui mûrissait à la porte du ciel.
Séraphîta se tut soudain pour rassembler ses dernières forces. Ni Wilfrid, ni Minna n’osèrent parler. Tout à coup, Séraphîta se dressa pour mourir. Elle dit : « Voici l’aube de la Vraie Lumière ! Pourquoi ne puis-je emmener mes amis ? Adieu, pauvre terre ! adieu ! »
VII
L’Assomption
La violence de la dernière prière de Séraphîta avait brisé les liens. Comme une blanche colombe, son âme demeura pendant un moment posée sur ce corps dont les substances épuisées allaient s’anéantir. L’aspiration de l’Âme vers le ciel fut si contagieuse, que Wilfrid et Minna ne s’aperçurent pas de la Mort en voyant les radieuses étincelles de la Vie. Ils étaient tombés à genoux quand il s’était dressé vers son orient, et partageaient son extase. Ils demeurèrent dans le crépuscule de l’Aurore Naissante dont les faibles lueurs les préparaient à voir la Vraie Lumière, à entendre la Parole Vive, sans en mourir. Ils commencèrent à concevoir les différences incommensurables qui séparent les choses de la Terre, des choses du Ciel. L’ESPRIT était au-dessus d’eux, il embaumait sans odeur, il était mélodieux sans le secours des sons. Ils n’osaient plus ni l’interroger ni le contempler, et se trouvaient dans son ombre comme on se trouve sous les ardents rayons du soleil des tropiques, sans qu’on se hasarde à lever les yeux de peur de perdre la vue. Ils se disaient : « – S’il nous touche, nous allons mourir ! » Mais l’ESPRIT était dans l’infini, et ils ignoraient que, ni le temps ni l’espace n’existent plus dans l’infini, qu’ils étaient séparés de lui par des abîmes, quoique en apparence près de lui. Ils ne virent donc que ce que leur nature, soutenue par la force de l’Esprit, leur permit de voir ; ils n’entendirent que ce qu’ils pouvaient entendre. Ils frissonnèrent quand éclata la VOIX de l’âme souffrante, le chant de l’ESPRIT qui attendait la vie et l’implorait par un cri.
L’ESPRIT frappait à la PORTE-SAINTE. – Que veux-tu ? répondit un CHŒUR dont l’interrogation retentit dans les mondes. – Aller à Dieu. – As-tu vaincu ? – J’ai vaincu la chair par l’abstinence, j’ai vaincu la fausse parole par le silence, j’ai vaincu la fausse science par l’humilité, j’ai vaincu l’orgueil par la charité, j’ai vaincu la terre par l’amour, j’ai payé mon tribut par la souffrance, je me suis purifié en brûlant dans la foi, j’ai souhaité la vie par la prière : j’attends en adorant, et suis résigné.
Tout à coup sonnèrent les trompettes de la Victoire remportée par l’ANGE dans cette dernière épreuve, les retentissements arrivèrent aux espaces comme un son dans l’écho, les remplirent et firent trembler l’univers que Wilfrid et Minna sentirent être petit sous leurs pieds. Ils tressaillirent, agités d’une angoisse causée par l’appréhension du mystère qui devait s’accomplir. Soudain les voiles se déchirèrent, ils virent dans le haut comme un astre incomparablement plus brillant que ne l’est le plus lumineux des astres matériels, qui se détacha, qui tomba comme la foudre en scintillant toujours comme l’éclair, et dont le passage faisait pâlir ce qu’ils avaient pris jusqu’alors pour la LUMIÈRE. C’était le Messager chargé d’annoncer la bonne nouvelle, et dont le casque avait pour panache une flamme de vie. Il avait une palme et une épée, il toucha l’ESPRIT de sa palme. L’ESPRIT se transfigura, ses ailes blanches se déployèrent sans bruit. La communication de la LUMIÈRE qui changeait l’ESPRIT en SÉRAPHIN, le revêtement de sa forme glorieuse, armure céleste, jetèrent de tels rayonnements, que les deux Voyants en furent foudroyés. Comme les trois apôtres aux yeux desquels Jésus se montra, Wilfrid et Minna ressentirent le poids de leurs corps qui s’opposait à une intuition complète et sans nuages de LA PAROLE et de LA VRAIE VIE. Ils comprirent la nudité de leurs âmes et purent en mesurer le peu de clarté par la comparaison qu’ils en firent avec l’auréole du Séraphin. Ils comprirent la nudité de leurs âmes et purent en mesurer le peu de clarté par la comparaison qu’ils en firent avec l’auréole du Séraphin. Cet Ange s’agenouilla devant le SANCTUAIRE qu’il pouvait enfin contempler face à face et dit en les désignant : – Permettez-leur de voir plus avant, ils aimeront le Seigneur et proclameront sa parole. À cette prière, un voile tomba. Soit que la force inconnue qui pesait sur les deux Voyants eût momentanément anéanti leurs formes corporelles, soit qu’elle eût fait surgir leur esprit au dehors, ils sentirent en eux comme un partage du pur et de l’impur. Wilfrid et Minna virent que depuis le plus petit des mondes jusqu’à la plus petite portion des êtres qui le composaient, tout était individuel, et néanmoins tout était un. Ils eurent la preuve de l’action des Mondes et des Êtres, la conscience de l’effort avec lequel ils tendent au résultat. Wilfrid et Minna comprirent alors quelques-unes des mystérieuses paroles de Celui qui sur la terre leur était apparu à chacun d’eux sous la forme qui le leur rendait compréhensible, à l’un Séraphîtüs, à l’autre Séraphîta, quand ils virent que là tout était homogène. La lumière enfantait la mélodie, la mélodie enfantait la lumière, les couleurs étaient lumière et mélodie, le mouvement était un Nombre doué de la Parole ; enfin, tout y était à la fois sonore, diaphane, mobile, en sorte que chaque chose se pénétrant l’une par l’autre, l’étendue était sans obstacle et pouvait être parcourue par les Anges dans la profondeur de l’infini. Le Séraphin replia légèrement ses ailes pour prendre son vol, et ne se tourna plus vers eux : il n’avait plus rien de commun avec la Terre. Wilfrid et Minna purent le voir emporté dans sa gloire, accompagné du joyeux archange. Ils comprirent les invisibles liens par lesquels les mondes matériels se rattachaient aux mondes spirituels. Arrivés par une exaltation inouïe de leurs facultés à un point sans nom dans le langage, ils purent jeter pendant un moment les yeux sur le Monde Divin. Là était la fête. Des myriades d’Anges accoururent tous du même vol, sans confusion, tous pareils, tous dissemblables, simples comme la rose des champs, immenses comme les mondes. Aux yeux de Wilfrid et de Minna, bientôt Séraphîta ne fut plus qu’un point de flamme qui s’avivait toujours et dont le mouvement se perdait dans la mélodieuse acclamation qui célébrait sa venue au ciel. Au sein du Sanctuaire elle reçut le don de vie éternelle. Les Anges fléchirent le genou pour célébrer sa gloire, les Esprits fléchirent le genou pour attester leur impatience ; on fléchissait le genou dans les abîmes en frémissant d’épouvante.
En rentrant dans les liens de la chair, dont leur esprit avait momentanément été dégagé par un sublime sommeil, Wilfrid et Minna se sentirent comme au matin d’une nuit remplie par de brillants rêves dont le souvenir voltige en l’âme, mais dont la conscience est refusée au corps, et que le langage humain ne saurait exprimer. Ils roulèrent dans les abîmes, rentrèrent dans la poussière des mondes inférieurs, virent tout à coup la Terre comme un lieu souterrain dont le spectacle leur fut éclairé par la lumière qu’ils rapportaient en leur âme. Ce spectacle était celui qui frappa jadis les yeux intérieurs des Prophètes. Ministres des religions diverses, toutes prétendues vraies, Rois tous consacrés par la Force et par la Terreur, Guerriers et Grands se partageant mutuellement les Peuples, Savants et Riches au-dessus d’une foule bruyante et souffrante qu’ils broyaient bruyamment sous leurs pieds. Mais ces richesses et ces splendeurs construites de sang furent comme de vieux haillons aux yeux de Wilfrid et de Minna. Wilfrid leur reprocha de conduire les nations à la mort.
Tout à coup, les deux amants se trouvèrent agenouillés devant un corps que le vieux David défendait contre la curiosité de tous, et qu’il voulut ensevelir lui-même. – Où allez-vous ? leur demanda monsieur Becker.
– Nous voulons aller à Dieu, dirent-ils, venez avec nous, mon père ?
.


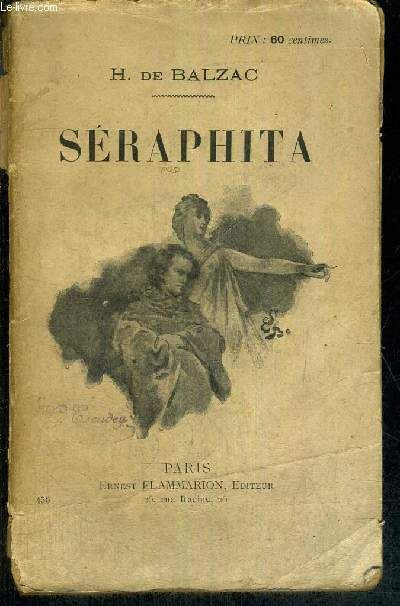


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)