Le père Goriot (Honoré de Balzac)
Avec Goriot, le thème presque obsessionnel de la paternité atteint son degré extrême de signifiance et de pathétique, les débuts de Rastignac à Paris déterminent une des lignes de force de la Comédie humaine, en même temps qu'apparaît Vautrin, qui dominera cet univers. Dans la préface du père Goriot, Balzac prétend avoir imaginé le « retour des personnages » pour échapper aux reproches de ses lectrices. La technique des personnages reparaissant intéressant la composition romanesque dans son ensemble, elle ne peut être mise en oeuvre sans une adaptation préalable des structures. Dans le Père Goriot, nous retrouvons le plan de la scène provinciale. Plan dynamique, difficile à mettre en formule, aisément reconnaissable toutefois. La pension de famille y fait pendant à la maison de Saumur dans Eugénie Grandet, les clients de maman Vauquer remplacent les habitués des soirées de Grandet. Par un « retour en arrière » on apprend le passé de Goriot comme on apprenait celui de l'avare tandis qu'à l'amour naissant d’Eugénie correspond l'ambition naissante de Rastignac.
Au centre du Père Goriot existe un puissant courant de destinées, au lieu du noeud dramatique classique. Derrière Rastignac, apparaît l'ombre immense de Vautrin, dont la révolte vient grossir le fleuve vivant qui traverse le roman. Un même mouvement anime alors les destinées des trois héros, bien que Vautrin ne soit rien pour Goriot, et que, s'il aime Rastignac, celui-ci échappe bientôt à son emprise.
Il se forme autour des personnages des zones dramatiques particulières, mais chacune demeure, pour ainsi dire, indépendante. Une intrigue policière autonome amène l'arrestation de Vautrin ; Rastignac trouve la porte de Mme de Restaud fermée, les filles de Goriot se disputent devant leur père mourant, Mme de Beauséant et la duchesse de Langeais se blessent à coups de propos mondains ambigus. Le retour des personnages permet d'éviter un long développement pour raconter l'histoire des Restaud, pour montrer la tragique condition d'Anastasie et la fatalité qui l'empêche de venir au chevet de son père agonisant car ce développement existe dans le Papa Gobseck. En effet, Balzac a repris l'héroïne de cette nouvelle pour en faire la fille de Goriot. Balzac imagine une vaste constellation de romans à travers lesquels chaque destinée pourrait s'accomplir comme dans la réalité ; c'est la première idée de la Comédie humaine. Aussi ose-t-il terminer le Père Goriot sur un défi de Rastignac à Paris, confiant son héros avide de vivre à la fortune incertaine d'une oeuvre qui n'existe pas encore.
Avec le Père Goriot, Balzac commence à donner sa physionomie caractéristique à la Comédie humaine, où nous lirons désormais un drame aux dimensions de la société. Il s'agira moins de nouer et de dénouer des intrigues que de jeter pêle-mêle des destinées qui s'ouvriront de roman en roman leur chemin. À l'origine le Père Goriot ne devait être que l'histoire d'un père dépouillé par ses filles. Sujet du Père Goriot : un brave homme, pension bourgeoise, 600 fr. de rente, s'étant dépouillé pour ses filles qui, toutes deux ont 50 000 fr. de rente, mourant comme un chien.
C'est dans une vision pleine de réminiscences de la Divine comédie que Balzac projette sur la foule hâve de l'enfer parisien l'image de l'humanité qu'il porte en lui. La population parisienne représentera la société tout entière, car elle est l'image tragique de la condition humaine.
L'or et le plaisir dominent à Paris, ce pays sans moeurs, sans croyance et sans aucun sentiment. C'est l'or qui transforme le travail en plaisir. Mais le plaisir n'est jamais à la mesure du désir et la société est condamnée à une irrémédiable déperdition d'énergie. Le premier cercle de Paris est celui des prolétaires insouciants de l'avenir et comptant sur leurs bras comme le peintre sur sa palette. La seconde sphère parisienne est celle des petits-bourgeois qui consument leur existence en escomptant la joie tardive que leur âme éteinte ne pourra plus leur donner. Le temps est leur tyran. Ils jettent leur or dans de terribles débauches, du plaisir à la mesure de leur fortune. Ce sont des gens laminés par les affaires et qui, s'ils arrivent à leur but, y arrivent tués. Tout s'explique, toujours, par l'or et le plaisir, tout se paye par la mort. Puis, c'est la sphère des artistes, société hors la société, enfer hors l'enfer. C'est le royaume de la pensée qui tue et des désirs exorbitants, du bonheur impossible. Nulle part plus de temps perdu à la poursuite du vent, et c'est en or encore que se paye ce néant.
La damnation de l'homme social, c'est d'être toujours inférieur à son désir.
Gobseck, l'usurier, épouse le parti de la fatalité. Il concentre entre ses mains la puissance. Il a deviné les lois sociales. Il sait que le plaisir se paye toujours plus cher que son poids d'or. De Marsay est un artiste. Il peut lire dans les coeurs mais il sait en outre qu'on ne domine pas seulement par la fortune. Il exploite et capitalise les rêves des autres. Il grossira sa fortune de l'immense pauvreté des vanités féminines. Son seul but, parvenir à tout prix.
Il a le crime désinvolte et les triomphes un peu faciles : rien ne lui résiste, ni les femmes, ni les lois, ni le hasard. La société qui s'abaisse jusqu'à lui devient une proie sans défense. De Marsay annonce l'ambition pathétique de Rastignac. Rastignac apprend en quelques jours l'art de parvenir. Il croit encore au bien et du mal. Il sait que le monde poursuit les meurtriers. Il sait aussi que l'on trouve à la source de chaque fortune un crime impuni. Vautrin lui offre le crime modèle, celui qui ne salit pas et qui satisfera son ambition. Rastignac devra peser l'or et la vertu en arpentant le jardin du Luxembourg. Rastignac jette à Paris du haut du Père-Lachaise un défi à lui-même. Chaque personnage du Père Goriot subit les lois de l'or, de la vanité et de la convoitise universelle. Goriot est l'incarnation du sacrifice passionné, le martyr, le Christ de la paternité. Il échappe à la vanité et à la convoitise mais il doit plier devant l'or. Il est né pour donner et vit de sa continuelle dépossession. Vautrin est le suppôt du diable. Il fait face à la société et la domine comme un demi-dieu.
Au grand et illustre Geoffroy Saint-Hilaire comme un témoignage d'admiration de ses travaux et de son génie (Honoré de Balzac).
Mme Vauquer, née de Conflans, était une vieille femme qui, depuis 40 ans, tenait à Paris une pension bourgeoise rue Neuve-Sainte-Geneviève. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, admettait également des hommes et des femmes sans que jamais la médisance ait attaqué les moeurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis 30 ans ne s'y était-il jamais vu de jeunes personnes. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. Dans le quartier de la pension, l'homme le plus insouciant s'y attristait comme tous les passants. Les maisons y étaient mornes et les murailles y sentaient la prison. Nul quartier de Paris n'était plus horrible la façade de la pension donnait sur un jardinet. On entrait dans cette pension par une porte bâtarde surmontée d'un écriteau sur lequel était écrit : Maison Vauquer pension bourgeoise des deux sexes et autres. Sous le couvert de tilleuls était plantée une table ronde peinte en vert et entourée de sièges. C'était là que durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café, venaient le savourer par une chaleur capable de faire éclore des oeufs. La façade de la pension, élevée de trois étages étaie surmontée de mansardes et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Derrière le bâtiment, il y avait une cour dans laquelle vivaient en bonne intelligence des cochons, des poules et des lapins.
Au rez-de-chaussée de la pension il y avait un salon et une salle à manger. Le panneau d'entre les croisées grillagées offrait aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans cette peinture excitait les plaisanteries des jeunes pensionnaires. Le salon sentait le renfermé, le moisi et donnait froid. Elle sentait l'hospice. La salle à manger était entièrement boisée. On y voyait des gravures exécrables qui ôtaient l'appétit. Il y avait une longue table couverte de toile cirée, des chaises estropiées et des chaufferettes misérables. Mme Vauquer était grassouillette, avait un nez à bec de perroquet et des petites mains potelées. Son corsage trop plein et qui flottait était en harmonie avec cette salle dans laquelle suintait le malheur et où s'était blottie la spéculation. Toute personne de Mme Vauquer expliquait la pension, comme la pension implique sa personne. Elle était âgée d'environ 50 ans. Elle ressemblait à toutes les femmes qui avaient eu des malheurs. Les pensionnaires la croyaient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Elle ne s'expliquait jamais son défunt mari. Il s'était mal conduit envers elle et ne lui avait laissé que cette maison pour vivre. Elle ne compatissait à aucune infortune car elle disait qu'elle avait souffert tout ce qu'il était possible de souffrir. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, s'empressait de servir le déjeuner des pensionnaires internes.
Généralement les pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au dîner qui coûtait 30 fr. par mois. Il n'y avait que sept internes. Au premier étage, il y avait Mme Vauquer et Mme Couture, veuve d'un commissaire-ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère. Au deuxième étage il y avait un vieillard nommé Poiret et un homme âgé d'environ 40 ans qui portait une perruque noire, se disait ancien négociant et s'appelait M. Vautrin. Le troisième étage se composait de quatre chambres dont deux étaient loués par une vieille fille nommée Mlle Michonneau et l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d'Italie, le père Goriot.
Les deux autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, ces infortunés étudiants qui ne pouvaient mettre que 45 fr. par mois à leur nourriture et à leur logement. Mme Vauquer souhaitait peu leur présence trouvant qu'ils mangeaient trop de pain. En ce moment, l'une de ces deux chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême à Paris pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer 1200 fr. par an. Eugène de Rastignac était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études, et les adaptant par avance aux mouvements futurs de la société, pour être les premiers à la pressurer.
Au grenier, il y avait deux mansardes dans lesquelles se trouvaient Christophe, un garçon de peine et la grosse Sylvie, la cuisinière. La salle contenait à dîner 18 personnes mais le matin, il ne s'y trouvait que sept locataires. Ces sept pensionnaires étaient les enfants gâtés de Mme Vauquer, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre de leurs pensions. Les deux locataires du second ne payaient que 72 fr. par mois. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action. La vieille demoiselle Michonneau était squelettique. Elle devait avoir été jolie. Expiait- elle les triomphes d'une jeunesse insolente au-devant de laquelle s'étaient rués les plaisirs par une vieillesse que fuyaient les passants ? Elle disait qu'elle avait pris soin d'un vieillard qui lui avait légué 1000 fr. de rente viagère. M. Poiret était une espèce de mécanique. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi ? Cet homme semblait avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social, l'un de ces hommes dont nous disons en les voyant : il en faut pourtant comme ça. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués. Victorine Taillefer était jeune et ses mouvements et sa voix étaient agiles. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimait cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen Âge. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une résignation chrétiennes. Elle était jolie par juxtaposition. Heureuse, elle eût été ravissante. Si l'amour avait ranimé ses yeux tristes, Victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître et refusait de la garder près de lui. Il ne lui accordait que 600 fr. par an. Mme Couture était une parente éloignée de la mère de Victorine. Elle prenait soin de l'orpheline comme de son enfant. Elle menait Victorine à la messe tous les dimanches afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse.
Victorine aimait son père bien que celui-ci gardait sa maison inexorablement fermée à sa fille.
Son frère, son unique médiateur, n'était pas venu la voir une seule fois en quatre ans et ne lui envoyait aucun secours. Elle suppliait Dieu de dessiller les yeux de son père et d'attendrir le coeur de son frère. Mme Couture et Mme Vauquer ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qualifier cette conduite barbare.
Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Ses manières dénotaient le fils d'une famille noble où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. Les jours ordinaires, il achevait d'user des vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois habillé comme l'est un jeune homme élégant. Ordinairement il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire mal nouée de l'étudiant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit : voilà un fameux gaillard ! Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Il était obligeant et rieur. Il connaissait tout, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait pas trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Mme Vauquer et a quelques pensionnaires ; mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre tant il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. Comme un juge sévère, son oeil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Il décampait toute la soirée pour rentrer vers minuit. Il était le seul à jouir d'une faveur de Mme Vauquer. Elle lui avait donné un passe-partout. Il était au mieux avec la veuve qu'il appelait maman en la saisissant par la taille. Il devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Souvent, il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. On supposait qu'il gardait rancune à l'état social et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui.
Mlle Taillefer était attirée, peut-être à son insu, par la force de Vautrin et par la beauté de Rastignac mais aucun d'eux ne semblait songer à elle. Les pensionnaires avaient les uns pour les autres une indifférence mêlée de défiance qui résultait de leurs situations respectives.
Ils écoutaient sans émotion le récit d'une infortune et semblaient voir dans la mort la solution d'un problème de misère qui les rendait froids à la plus terrible agonie. Le plus heureuse de ces âmes désolées était Mme Vauquer. Pour elle seule, ce petit jardin, que le silence et le froid faisaient vaste comme une steppe, était un riant bocage. Pour elle seule cette maison jaune et morne avait des délices. Elle exerçait sur ses pensionnaires une autorité respectée. Sans Mme Vauquer, les pensionnaires n'auraient pas trouvé dans Paris, au prix où elle les donnait, des aliments sains, suffisants et un appartement qu'ils étaient maîtres de rendre sinon élégant ou commode, du moins propre et salubre. Parmi les 18 convives il se rencontrait, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur sur qui pleuvaient les plaisanteries. C'était le père Goriot. Par quel hasard ce mépris à demi haineux, cette persécution mélangée de pitié, ce non-respect du malheur avait-il frappé le plus ancien pensionnaire ? Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout par humilité vraie. Le père Goriot, vieillard de 69 ans, s'était retiré chez Mme Vauquer en 1813 après avoir quitté les affaires. Il avait d'abord pris l'appartement occupé par Mme Couture et donné alors 1200 fr. de pension, en homme pour qui cinq louis de plus ou de moins était une bagatelle. À cette époque, le père Goriot était respectueusement nommé M. Goriot mais Mme Vauquer finit par le considérer comme un imbécile qui ne connaissait rien aux affaires. Il était arrivé muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se refuse rien en se retirant du commerce. Il possédait alors de l'argenterie, des bijoux en or et un gros diamant. Mme Vauquer avait bien vu, de son oeil de pie, quelques inscriptions sur le grand-livre de Goriot et avait calculé un revenu d'environ huit à 10 000 fr. Dès ce jour, Mme Vauquer qui avait alors 48 ans effectifs et n'en acceptait que 39, eut des idées. Elle trouva Goriot l'air agréable et comme il faut. Ce devait être une bête solidement bâtie, capable de dépenser tout son esprit en sentiments. Elle aurait voulu quitter le suaire de son défunt mari pour renaître en Goriot. Elle aurait voulu devenir une dame notable dans le quartier. Elle n'avait avoué à personne qu'elle possédait 40 000 fr. Pendant environ trois mois, la veuve Vauquer profita du coiffeur de M. Goriot et fit quelques frais de toilette. Elle s'intrigua beaucoup pour changer le personnel de ses pensionnaires en affichant la prétention de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous tous les rapports. Elle fit distribuer des prospectus vantant les mérites de la maison Vauquer. Cela lui amena Mme la comtesse de l'Ambermesnil, veuve d'un général. Mme Vauquer soigna sa table pendant près de six mois pour tenir les promesses de son prospectus. Elle approuva beaucoup les vues de son hôtesse sur Goriot. Elle trouvait que Goriot pouvait donner encore bien de l'agrément à une femme.
Elle lui conseilla de se mettre en harmonie avec ses prétentions et elles allèrent ensemble au Palais-Royal et au magasin de la Petite Jeannette pour choisir des vêtements. Mme Vauquer ressembla parfaitement à l'enseigne du Boeuf à la mode. Néanmoins elle se trouva à son avantage et se crut obligée de la comtesse alors elle lui offrit un chapeau de 20 fr. Et lui demanda le service de sonder Goriot et de la faire valoir auprès de lui. La comtesse accepta mais elle le trouva pudibond et sortit révoltée de sa grossièreté. Elle dit à Mme Vauquer que c'était un sot qui ne lui causerait que du désagrément. La comtesse s'en alla le lendemain à cause des griefs qu'elle avait envers M. Goriot. Elle partit en oubliant de payer six mois de pension et en laissant une défroque prisée cinq francs. Mme Vauquer parti à sa recherche sans trouver aucun renseignement dans Paris sur la comtesse de l'Ambermesnil. Elle parlait souvent de cette déplorable affaire mais elle ressemblait à beaucoup de personnes qui se défie de leurs proches et se livrent au premier venu. Peut-être certaines gens n'ont-ils plus rien à gagner auprès des personnes avec lesquelles ils vivent ; après leur avoir montré le vide de leur âme, ils se sentent secrètement jugés par elles avec une célérité méritée ; mais, éprouvant un invincible besoin de flatteries qui leur manquent, ou dévorés par l'envie de paraître posséder les qualités qu'ils n'ont pas, ils espèrent surprendre l'estime de ceux qui leur sont étrangers, au risque de déchoir un jour. Mme Vauquer était essentiellement mesquine, fausse et exécrable. Elle aimait à s'en prendre à autrui de ses propres fautes. Elle considéra donc Goriot comme le principe de son infortune et se dégrisa sur son compte. Sa haine envers lui ne fut pas en raison de son amour mais de ses espérances trompées. Si le coeur humain trouve des repos en montant les hauteurs de l'affection, il s'arrête rarement sur la pente rapide des sentiments haineux. La veuve employa sa malice de femme à inventer de sourdes persécutions contre sa victime. Mais il est bien difficile à Mme Vauquer de tourmenter son pensionnaire alors elle se mit à le déconsidérer et fit ainsi partager son aversion pour Goriot par ses pensionnaires. Vers la fin de la première année, la veuve en était venue à un tel degré de méfiance qu'elle se demandait pourquoi Goriot qui possédait une argenterie et de beaux bijoux demeurait chez elle en lui payant une pension si modique relativement à sa fortune. La première année, Goriot avait souvent dîné dehors puis, insensiblement, il en était arrivé à ne plus dîner en ville que deux fois par mois. À la fin de la deuxième année, M. Goriot justifia les bavardages dont il était objet en demandant à Mme Vauquer de passer au second étage et de réduire sa pension à 900 fr. La veuve voulut être payée d'avance. Dès lors elle nomma M. Goriot, le père Goriot. Ce négociant si distingué devint donc un fripon. Les bavardages allaient bon train à son encontre. Tantôt on en faisait un espion attaché à la haute police ; tantôt il était un homme qui allait à la Bourse. On en faisait tout ce que le vice, la honte, l'impuissance engendrent de plus mystérieux. Mais comme il payait sa pension l'aversion qu'il l'inspirait n'allait pas jusqu'à le faire bannir de la Maison Vauquer.
Puis, Goriot était utile, chacun essuyait sur lui sa bonne ou mauvaise humeur par des plaisanteries. L'opinion de Mme Vauquer fut généralement adoptée, le père Goriot était un libertin qui avait des goûts étranges. La veuve Vauquer appuyait ses calomnies parce qu'une femme jeune et légère était venue chez Goriot. La veuve et Sylvie avaient surpris plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite. Sylvie avait suivi M. Goriot qui reconduisait sa dame. Elle avait dit à sa maîtresse que la jeune femme devait être diantrement riche car elle était montée dans un superbe équipage. Le soir, Mme Vauquer fit allusion à la jeune femme en disant au père Goriot qu'il était aimé par des belles. Il répondit que c'était sa fille mais les pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui gardait les apparences.
La jeune femme revint un mois plus tard. Elle était habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires la croyaient beaucoup trop distinguée pour être la fille du père Goriot. Quelques jours après, une autre fille, grande et bien faite demanda M. Goriot. Mme Vauquer trouva tout naturel qu'un homme riche eût quatre ou cinq maîtresse et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. Seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la deuxième année, de l'appeler vieux matou. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les 900 fr. de pension, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison, en voyant descendre une de ces dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. Saisir la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses en montant au troisième étage et en se mettant à 45 fr. de pension par mois. Il congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. En le voyant ainsi, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise. Il avait les cheveux d'un gris sale et verdâtre. Les pensionnaires pensèrent que la couleur dégoûtante de ses cheveux provenait de ses excès et des drogues qu'il avait prises pour les continuer. Quand son trousseau fut usé, le père Goriot acheta du calicot pour remplacer son beau linge. Ses diamants et ses bijoux disparurent. Il devint progressivement maigre. Durant la quatrième année de son établissement chez Mme Vauquer, il ne se ressemblait plus. Il semblait être un septuagénaire hébété et vacillant. Aux uns, il faisait horreur ; aux autres, il faisait pitié. Un soir, après le dîner, Mme Vauquer le railla en lui disant que ses filles ne venaient plus le voir. Le père Goriot tressaillit comme si son hôtesse l'eût piqué avec un fer. Il répondit qu'elles venaient quelquefois, d'une voix émue.
Vers la fin du mois de novembre 1819, chacun dans la pension avait des idées bien arrêtées sur le pauvre vieillard. Les pensionnaires étaient persuadés qu'il n'avait jamais eu ni fille ni femme et que l'abus des plaisirs en faisait un colimaçon, un mollusque anthropomorphe.
La gêne de Rastignac, pendant sa première année de séjour à Paris, avait goûté les délices visibles du Paris matériel. Il voulut agrandir l'horizon de sa vie et finit par concevoir la superposition des couches humaines qui composaient la société. Il avait été reçu bachelier ès lettres et bacheliers en droit. Ses illusions d'enfance et ses idées de province avaient disparu. Son ambition exaltée lui fit voir juste au milieu du manoir paternel, au sein de la famille. Sa famille qui vivait sur la petite terre de Rastignac était soumise à l'incertitude qui régit le produit tout industriel de la vigne et néanmoins il fallait en extraire chaque année 1200 fr. pour lui. L'aspect de cette constante détresse qui lui était généreusement cachée et la comparaison qu'il fut forcé d'établir entre ses soeurs et les femmes de Paris décuplent vers son désir de parvenir et lui donnèrent soif des distinctions.
Comme il arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son mérite. Il voulut d'abord se jeter à corps perdu dans le travail. Bientôt il comprit la nécessité de se créer des relations, il remarqua combien les femmes ont d'influence sur la vie sociale. Il chercha à conquérir des protectrices. Il questionna sa tante, Mme de Marcillac qui avait autrefois été présentée à la cour et y avait connu les sommités aristocratiques. Elle lui conseilla de se présenter à Mme la vicomtesse de Beauséant. Elle écrivit donc à cette jeune femme une lettre dans l'ancien style et la remit à Eugène. Eugène envoya la lettre et reçut une réponse. Il était invité à un bal dès le lendemain. Il avait reconnu en Mme la vicomtesse de Beauséant l'une des reines de la mode à Paris et dont la maison passait pour être la plus agréable du faubourg Saint-Germain. Grâce à sa tante de Marcillac, Eugène avait été bien reçu dans cette maison, sans connaître l'étendue de cette faveur. Être admis dans ces salons dorés équivalait à un brevet de haute noblesse. Il avait conquis le droit d'aller partout. Au bal, parmi la foule, il avait distingué des déités parisiennes. Il avait remarqué la comtesse Anastasie de Restaud, grande et bien faite. Il avait pu lui parler pendant la première contredanse.
Il s'était présenté comme le cousin de Mme de Beauséant il fut invité par cette femme. Heureusement, le naïf étudiant tomba sur le marquis de Montriveau. C'était l'amant de la duchesse de Langeais, un général simple comme un enfant, qui lui apprit que la comtesse de Restaud demeurait rue du Helder. Il avait l'impression de donner un superbe coup de pied à la corde roide de sur laquelle il faut marcher avec l'assurance du sauteur qui ne tombera pas car il avait trouvé dans une charmante femme le meilleur des balanciers.
En rentrant à la Maison Vauquer, Eugène aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot. Il approcha son allié de la serrure et regarda dans la chambre. Le père Goriot était en train de faire fondre des objets en métal précieux pour les convertir en lingots.
Eugène se dit que Goriot était fou. Rastignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin. Eugène entendit la respiration de deux hommes qui montaient l'escalier. Il vit tout à coup une faible lueur au second étage, chez M. Vautrin. Mme Vauquer ouvrit la fenêtre de sa chambre et demanda qui était dans l'escalier. Eugène lui répondit qu'il venait de rentrer. Alors qu'il avait prévu de se mettre au travail, il finit par se coucher et par dormir. Il fallait avoir plus de 20 ans pour veiller. Le lendemain, Christophe discutait avec Sylvie dans la cuisine. Il parlait de M. Vautrin. Il l'avait vu avec deux personnes cette nuit. Vautrin lui avait donné 100 sous pour qu'il se taise. Sylvie avait vu sortir le père Goriot avec un paquet. Elle trouvait que c'était un brave homme. Surtout parce qu'il l'envoyait chez ses filles qui lui donnaient de fameux pourboires. Elle alla réveiller sa maîtresse. Elles discutèrent à propos des pensionnaires. Elles se demandèrent quel genre de trafic faisait le père Goriot. À ce moment-là, Vautrin rentra. Il dit à la veuve qu'il avait vu quelque chose de singulier. Il avait vu le père Goriot à 8:30 rue Dauphine chez l'orfèvre. Il lui avait vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage en vermeil. Après quoi, le père Goriot était entré dans la maison d'un usurier nommé Gobseck.
Le père Goriot rentra à la pension et demanda à Christophe de faire une course pour lui. Il s'agissait de transmettre une lettre à la comtesse Anastasie de Restaud. Vautrin en profita pour arracher des mains de Christophe la lettre et pour regarder ce qu'elle contenait. Il y avait un billet acquitté. Mlle Taillefer rentra elle aussi à la pension avec Mme Couture. Elles étaient allées prier. Vautrin leur dit que cela ne suffisait pas et qu'il leur faudrait un ami pour se charger de dire son fait au père de Victorine. Alors Victorine dite à Vautrin qu'elle prierait pour lui s'il trouvait un moyen d'arriver à son père. À ce moment-là, Goriot, Mlle Michonneau, Poiret et Rastignac descendirent pour déjeuner. Rastignac raconta sa soirée au bal chez Mme la vicomtesse de Beauséant. Et le matin même, il avait rencontré la divine comtesse, rue de Grès. Vautrin affirma que s'il fouillait le coeur des femmes à Paris, il pourrait y trouver l'usurier avant l'amant. Il savait qu'Anastasie demeurait rue du Helder il connaissait son nom. Goriot en fut surpris. Eugène avoua que la vicomtesse ne l'avait pas vu rue de Grès. Rastignac refusait de croire que la vicomtesse appartenait au père Goriot. Mais Vautrin répondit qu'il existait à Paris des hommes à passion. Le père Goriot était un de ces gens-là. Vautrin pensait que la vicomtesse l'exploitait. Vautrin expliqua avoir vu le matin même Goriot chez Gobseck. Il parla également de la lettre que Christophe avait portée avec le billet acquitté. Il était clair que si la comtesse allait aussi chez Gobseck, il y avait urgence. Rastignac avait une furieuse envie de savoir la vérité. Il irait demander à Mme de Restaud de quoi il retournait. Eugène raconta avoir surpris le père Goriot en train de fondre son déjeuner de vermeil. Mme Vauquer savait que le père Goriot y tenait comme à sa vie car c'était un cadeau de sa défunte femme. À quatre heures du soir, quand Goriot rentra, il vit Victorine dans les yeux étaie rouges. La visite qu'elle avait faite à son père avait été infructueuse.
Le père de Victorine avec dit à Mme Couture que Mlle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant et que la mère de Victorine ayant été épousée sans fortune n'avait rien à prétendre. Victorine s'était jetée alors aux pieds de son père pour lui dire qu'elle obéirait à ses volontés qui qu'elle le suppliait de lire le testament de sa pauvre mère. Mais le père de Victorine jeta la lettre dans la cheminée. Le frère de Victorine arriva à ce moment-là sans saluer sa soeur.
Les pensionnaires internes et externes arrivèrent les uns après les autres en se souhaitant mutuellement le bonjour et se disant de ces riens qui constituent chez certaines classes parisiennes, un esprit drolatique dans lequel la bêtise entre comme élément principal. Le père Goriot ne comprenait pas les plaisanteries et regardait les convives d'un air niais, comme un homme qui tâche de comprendre une langue étrangère. Vautrin s'amusa à enfoncer le chapeau de Goriot jusque sur ses yeux. Le père Goriot le traita de mauvais plaisants et lui dit qu'il pourrait payer cela bien cher quelque jour.
Le lendemain Rastignac s'habilla fort élégamment pour se rendre chez Mme de Restaud dans l'après-midi. En marchant, il pensait à ce qu'il dirait à Mme de Restaud et préparait ses phrases à la Talleyrand. Quand il demanda la comtesse, il reçut le coup d'oeil méprisant des gens qui l'avaient vu traversant la cour à pied, sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte. Il reçut ce coup d'oeil avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour. Le valet demanda à Rastignac de passer au salon pour attendre. Une porte s'ouvrit au fond du long corridor éclairé par une petite lampe et Rastignac entendit à la fois la voix de Mme de Restaud et celle du père Goriot et le bruit d'un baiser. Rastignac put voir le père Goriot sortir. La comtesse apparut coquettement vêtue d'un peignoir en cachemire blanc. Elle était accompagnée d'un certain Maxime. Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme. Le spirituel enfant de la Charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy mince et grand. La comtesse se sauva dans l'autre salon et Maxime la suivit. Eugène furieux suivit Maxime et la comtesse. Il voulait gêner le dandy. Il comprit que Maxime était son rival.
Le compte Maxime de Trailles se laissait insulter puis tirait le premier pour tuer son homme. Il dit à la comtesse qu'il avait hâte de la voir mais à ce moment-là M. de Restaud entra. La comtesse présente à son mari à Eugène. Puis elle présenta Eugène à son mari comme parent de Mme la vicomtesse de Beauséant. Ces paroles eurent un effet magique car le comte quitta son air froidement cérémonieux et salua Eugène. Le comte Maxime de Trailles lui-même jeta sur Eugène un regard inquiet et quitta tout à coup son air impertinent. Cela rendit à Eugène l'esprit qu'il avait préparé. Il détailla brièvement au comte de Trailles sa généalogie. Puis la comtesse entraîna Maxime pour laisser Eugène discuter avec son mari. Puis elle revint promptement seule. Rastignac embarqua le comte de Trailles dans des discussions afin de revoir la comtesse et de savoir quelles étaient ses relations avec le père Goriot. Il voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment Parisienne. Eugène dit à la comtesse qu'il habitait dans la même pension que le père Goriot. Le comte de Trailles lui reprocha d'avoir employé ce terme car il aurait dû dire M. Goriot. La comtesse paraissait embarrassée et voulut changer de sujet de conversation. En prononçant le nom du père Goriot, Eugène avait donné un coup de baguette magique, mais dont l'effet était l'inverse de celui qu'avaient frappé ces mots : parent de Mme de Beauséant. Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. Alors Eugène salua profondément le couple et sortit accompagné par M. de Restaud. Après le départ de Rastignac, il dit à son valet que toutes les fois où M. de Rastignac se présenterait il faudrait lui dire que ni lui ni la comtesse ne seraient présents.
Il pleuvait. Eugène savait qu'il avait été coupable d'une gaucherie dont il ignorait la cause et la portée. Il se demandait s'il pouvait aller dans le monde quand, pour y manoeuvrer convenablement, il fallait un tas de cabriolets, des bottes cirées et des agrès indispensables.
Un cocher lui proposa de monter dans sa voiture de louage. Eugène accepta alors qu'il n'avait que 22 sous dans sa poche. Il demanda à être conduit à l'hôtel de Beauséant. Le cocher lui demanda lequel. Eugène ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de Beauséant. Alors il dit qu'il fallait se rendre chez le vicomte de Beauséant. Il avait l'intention de raconter à sa cousine son aventure en espérant qu'il pourrait la faire rire. Il se disait qu'il valait mieux plaire à sa cousine que de se cogner contre Mme de Restaud, cette femme immorale. À présent, il devait s'adresser en haut. Se disant que quand on s'attaque à quelque chose dans le ciel, il faut viser Dieu. Quand il arriva, Eugène entendit trois ou quatre valets qui plaisantaient sur cet équipage de mariés vulgaires duquel il descendait. Il y avait dans la cour un équipage que 30 000 fr. n'auraient pas payé. Eugène se demanda qui pouvait être chez sa cousine. Il monta le perron la mort dans l'âme. N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, de faire une visite à sa cousine, Eugène n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de Mme de Beauséant. Eugène, qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes, fut conduit par un grand escalier plein de fleurs. La vicomtesse était liée depuis trois ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Adjuda-Pinto. C'était une relation innocente. Aussi le vicomte de Beauséant avait-il donné lui-même l'exemple en respectant, bon gré, mal gré, cette union. À Paris, on savait qu'on gênait Mme de Beauséant en venant la voir entre eux 14:00 et 16:00. Le marquis portugais allait bientôt se marier. La vicomtesse était la seule à l'ignorer. Le marquis avait été incapable de le lui dire. Certains hommes se trouvent plus à l'aise, sur le terrain, devant un homme qui leur menace le coeur avec une épée, que devant une femme qui, après avoir débité ses élégies pendant deux heures, fait la morte et demande des sels. Quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça M. Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le marquis d'Adjunda-Pinto. Mme de Beauséant surprit ce tressaillement involontaire. Eugène ignorait qu'on ne doit jamais se présenter chez qui que ce soit à Paris sans s'être fait conter par les amis de la maison l'histoire du mari, celle de la femme ou des enfants, afin de ne commettre aucune de ces balourdises qui vous font atteler cinq boeufs à votre char. Après s'être embourbé chez Mme de Restaud, Eugène seul était capable de recommencer son métier de bouvier. Mais s'il avait horriblement gêné Mme de Restaud et M. de Trailles, il allait tirer d'embarras M. d'Ajuda. Le portugais s'empressa de gagner la porte. Eugène ne savait où se fourrer en se trouvant en présence de cette femme sans être remarqué par elle. La vicomtesse leva l'index de sa main droite pour désigner au marquis une place devant elle. Par ce simple geste, elle avait montré un si violent despotisme de passion que le marquis renonça à s'en aller. Eugène comprit que le marquis était l'homme qui possédait le riche équipage. Il se demanda s'il fallait être aussi riche pour obtenir le regard d'une femme de Paris. La soif de l'or lui sécha la gorge. Mais le marquis prétendit qu'il devait dîner chez l'ambassadeur d'Angleterre et s'en alla pour de bon cette fois. Mme de Beauséant se précipita dans la galerie et accourut à la fenêtre. Elle put entendre ce que le marquis avait dit à son cocher. Il avait ordonné d'être mené chez M. de Rochefide. Elle entra dans sa chambre et se mit à table pour écrire. Elle exigeait du marquis une explication.
Elle donna ce billet à son valet de chambre et lui demanda de se rendre chez M. de Rochefide pour y demander le marquis d’Adjuda. Dans le cas où le marquis n'yserait pas, le valet n'aurait qu'à rapporter la lettre. Puis elle se rendit au salon pour accueillir Eugène. Eugène appela la vicomtesse sa cousine et lui répondit par un « Hein ? ». En rougissant, il lui demanda pardon et lui expliqua qu'il avait besoin de tant de protection qu'un bout de parenté n'aurait rien gâté.
Cela fit rire la vicomtesse. Elle lui demanda en quoi elle pouvait lui être bonne. Il répondit qu'il voulait être accepté comme un pauvre enfant qui désirait se coudre à sa jupe et qui saurait mourir pour elle. La vicomtesse s'intéressa vivement à l'étudiant pour une réponse d'ambitieux. Eugène en était à son premier calcul. Ses trois années de droit parisien constituaient une autre jurisprudence sociale menant à tout. Eugène avoua qu'il était allé chez Mme de Restaud. Il se savait ignorant et avoua qu'il cherchait une femme capable de lui apprendre la vie. Il était sur le point de raconter son aventure chez Mme de Restaud quand le valet l'interrompit. Eugène fit le geste d'un homme violemment contrarié. Alors la vicomtesse lui expliqua que s'il voulait réussir il devait d'abord ne pas être aussi démonstratif. Le valet introduisit la duchesse de Langeais.
Rastignac remarqua que les deux femmes semblaient être de bonnes amies et pensait qu'il aurait avec elles deux protectrices. La duchesse annonça à son amie qu'elle avait vu M. d'Ajuda-Pinto entré chez M. de Rochefide. Mme de Beauséant ne se pinça pas les lèvres et ne rougit pas. Son regard resta le même. Mme de Beauséant présenta Eugène à la duchesse. Puis elle lui demanda des nouvelles du général Montriveau car la duchesse passait pour être abandonnée par M. de Montriveau dont elle était éperdument éprise. La duchesse sentit au coeur la pointe de cette question et rougit. Alors elle dit à son amie que les bans de M. d'Adjuda-Pinto allaient être publiés le lendemain. Ce coup était trop violent et la vicomtesse pâlit et répondit que c'était un de ces bruits dont s'amusaient les sots. Alors la duchesse rétorqua que la future épouse d'Ajuda-Pinto réunirait 200 000 livres de rente. La duchesse tourna sur Eugène un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme de ces pieds à la tête, l'aplatissent, et le mettent à l'état de zéro. Eugène lui dit qu'il avait sans le savoir plongé un poignard dans le coeur de Mme de Restaud. Il avait découvert les mordantes épigrammes cachées sous les phrases affectueuses de ces deux femmes. Il expliqua que celui qui blessait en ignorant la profondeur de sa blessure était regardé comme un sot, un maladroit ne savant profiter de rien et que chacun méprisait. Tandis que les gens qui étaient dans le secret du mal qu'ils faisaient aux autres étaient craints. Mme de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes peuvent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Il expliqua à la duchesse qu'il n'était encore qu'un pauvre diable d'étudiants, bien seul, bien pauvre. Puis il Rastignac raconta son aventure chez Mme de Restaud. Les deux femmes voulurent savoir qui était l'homme qu'il avait rencontré au fond d'un couloir et avait vu embrasser la comtesse. Eugène répondit que c'était un vieillard que l'on appelait le père Goriot. La duchesse expliqua à Eugène que Mme de Restaud était la fille de M. Goriot. En apprenant cela, Eugène fit un geste d'horreur. La duchesse expliqua à Eugène que M. Goriot avait deux filles dont il était quasi fou alors que ses filles l'avaient à peu près renié. L'autre fille de M. Goriot était mariée un banquier, le baron de Nucingen. La vicomtesse dit à Eugène que M. Goriot avait donné 600 000 fr. à ses filles pour faire leur bonheur. Il ne s'était réservé que 8 à 10 000 livres de rente pour lui. Il avait espéré qu'il serait adoré et choyé par ses filles et leurs belles familles. Mais ses gendres l'avaient banni de leur société comme le dernier des misérables.
Quelques larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène. Il n'en était qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne. Mme de Langeais commença par reconnaître que cela semblait bien horrible. Puis elle expliqua à Rastignac que M. Goriot avait été président de sa section pendant la Révolution et avait fait fortune en profitant de la disette pour vendre sa farine 10 fois plus qu'elle ne lui coûtait. Cela avait gêné M. de Restaud et plus encore Nucingen. Goriot s'était rendu compte que ses filles avaient honte de lui. Alors il s'était banni de lui-même. En voyant ses filles contentes, il comprit qu'il avait bien fait. Le père Goriot avait donné pendant 20 ans son amour à ses filles et sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses filles avaient laissé le reste au coin des rues.
La duchesse s'en alla après avoir embrassé son amie et légèrement incliné la tête en regardant Rastignac. La vicomtesse dit que le monde était infâme et méchant. Elle pensait qu'aussitôt qu'un malheur nous arrivait, il se rencontrait toujours un ami prêt à venir nous le dire. Elle dit à Eugène qu'elle l’aiderait. Il sonderait combien était profonde la corruption féminine et toiserait la largeur de la misérable vanité des hommes. Elle lui conseilla de calculer froidement s'il voulait réussir. Et de frapper sans pitié pour être craint. Elle lui dit de n'accepter les hommes et les femmes que comme des chevaux de poste qu'il laisserait crever à chaque relais pour arriver ainsi au faîte de ses désirs. Mais il ne serait rien s'il n'avait pas une femme qui s'intéressait à lui. Il devait en trouver une jeune et riche. S'il avait un sentiment vrai, elle lui conseillait de le cacher comme un trésor. Sinon il ne serait plus le bourreau mais deviendrait la victime. Elle expliqua à Eugène que Delphine de Nucingen était jalouse de sa soeur. Les deux soeurs s'étaient reniées comme elles avaient renié leur père. Alors elle conseilla à Eugène de séduire Delphine. Elle lui expliqua qu'il s'était fermé la porte de la comtesse de Restaud pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Alors Delphine serait pour lui un enseignant. Les rivales et les amies de Delphine auraient du désir pour lui. Elle lui dit qu'à Paris, le succès était tout, c'était la clé du pouvoir.
Si les femmes lui trouvaient de l'esprit, du talent, alors les hommes le croiraient. Eugène pourrait alors tout vouloir. Elle pensait que le monde n'était qu'une réunion de dupes et de fripons. La vicomtesse acceptait de lui donner son nom comme un fil d'Ariane pour rentrer dans ce labyrinthe. Elle lui demanda seulement de ne pas la compromettre.
Eugène lui répondit que si elle cherchait un homme de bonne volonté pour aller mettre le feu à une mine, il serait celui-là. Elle sourit et il répondit à son sourire. Puis il s'en alla. Il était accablé par ces mots : vous vous êtes fermé la porte de la comtesse. Mais il espérait que Mme de Restaud le trouverait dans tous les salons où il irait. Il voulait apprendre à tirer le pistolet pour tuer Maxime. Eugène voyait le monde comme il était : les lois et la morale impuissantes chez les riches. Il voyait aussi dans la fortune l'ultime raison du monde. Il pensait que Vautrin avait raison de dire que la fortune était la vertu.
En rentrant à la pension pour dîner, le spectacle de ces misères et l'aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était trop brusque pour ne pas nourrir chez lui le sentiment de l'ambition. Rastignac résolut d'ouvrir deux tranchées pour arriver à la fortune, de s'appuyer sur la science et sur l'amour, d'être un savant docteur et un homme à la mode. Il était encore bien enfant ! Car ces deux lignes sont des asymptotes qui ne peuvent jamais se rejoindre. Pour se moquer de lui, Vautrin l'appela M. le marquis et Rastignac lui répondit qu'il n'était plus disposé à souffrir les plaisanteries de ceux qui l'appelaient ainsi. Vautrin le regarda d'un air paternel et méprisant. Puis il lui dit : « vous est de mauvaise humeur, parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Restaud ». Rastignac répondit qu'elle lui avait fermé sa porte parce qu'il lui avait dit que son père mangeait à la pension. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer.
Alors Eugène annonça que ceux qui vexeraient le père Goriot s'attaqueraient désormais à lui-même. Il dit que le père Goriot valait mieux qu’eux tous. Cette phrase fut un dénouement, Eugène l'avait prononcée d'un air qui imposa silence aux convives. Mais Vautrin rétorqua que s'il voulait protéger Goriot, il faudrait savoir bien tenir l'épée et bien tirer le pistolet. Eugène en avait bien l'intention. Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot n'avait pas compris que les dispositions des esprits étaient changées à son égard et qu'un jeune homme en état d'imposer silence à la persécution avait pris sa défense. Mme Vauquer demanda si c'était vrai que le père Goriot était le père d'une comtesse. Rastignac ajouta qu'il était aussi le père d'une baronne. Les convives laissèrent Rastignac et Goriot seuls. Le père Goriot demanda au jeune homme s'il avait donc vu sa fille. Rastignac lui dit qu'il était un brave et digne homme. Puis Eugène se retira dans sa chambre pour écrire à sa mère. Il lui réclama 1200 fr. Il en profita pour lui annoncer que la vicomtesse de Beauséant l'avait pris sous sa protection. Il devait aller dans le monde et n'avait pas un sou pour avoir des gants propres.
Il écrivit aussi à chacune de ses soeurs en leur demandant leurs économies. Il savait que ces effroyables sacrifices allaient lui servir d'échelons pour arriver à Delphine de Nucingen et quelques larmes lui sortirent des yeux. C'est à ce moment-là que le père Goriot entra dans sa chambre. Eugène lui dit qu’il l'avait raison de trembler pour la comtesse Anastasie car elle était avec Maxime de Trailles et que celui-ci la perdrait.
Alors le père Goriot se retira en balbutiant quelques paroles incompréhensibles. Le lendemain, Rastignac hésita jusqu'au dernier moment puis il jeta ses lettres à la poste. Il retourna chez Mme de Restaud et ne fut pas reçu. Trois fois il y retourna, trois fois il trouva la porte close. La vicomtesse avait eu raison. Il réserva ses études pour le moment où il s'agirait de passer ses examens. Il voulait se réserver 15 mois de loisirs pour naviguer sur l'océan de Paris. Il retourna chez Mme de Beauséant, chez laquelle il n'allait qu'au moment où sortait la voiture du marquis d'Adjuda. Elle réussit à suspendre le mariage de Mlle de Rochefide avec le marquis. La vicomtesse portait une sorte d'affection superstitieuse envers Eugène. Eugène recueillit des renseignements certains sur le père Goriot. Celui-ci, avant la Révolution, avait été un simple ouvrier vermicellier il avait été assez économe pour acheter le fonds de son maître. Il s'était établi près de la Halle-aux-blés et il avait accepté la présidence de sa section pour protéger son commerce. Cette sagesse avait été l'origine de sa fortune qui commença dans la disette. Le commerce de grain semblait avoir absorbé toute son intelligence. Il avait été patient, actif, énergique et rapide dans ses expéditions. Mais sorti de sa spécialité, il redevenait l'ouvrier stupide et grossier, l'homme incapable de comprendre un raisonnement. Il était animé de deux sentiments exclusifs : sa femme, fille unique d'un riche fermier de la Brie qu'il perdit après sept ans de bonheur sans nuages. Alors le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Il reporta ses affections sur ses deux filles. Il voulut rester veuf pour ne pas faire d'infidélité à sa femme. Les gens de la Halle, incapables de comprendre cette sublime folie donnèrent à Goriot quelque grotesque sobriquet. Il voulut satisfaire les fantaisies de ses filles qui vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. Il leur suffisait d'exprimer les plus coûteux désirs pour voir leur père s'empressant de les combler. Le père Goriot avait mis ses filles au rang des anges et nécessairement au-dessus de lui. Il aimait jusqu'au mal qu'elles lui faisaient. Anastasie avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à quitter la maison paternelle pour s'élancer dans les hautes sphères sociales. Delphine aimait l'argent et épousa Nucingen, banquier d'origine allemande devenu baron du Saint-Empire.
Après avoir subi pendant cinq ans les instances de ses gendres, Goriot consentit à se retirer avec le produit de son fonds. Goriot s'était jeté dans la pension Vauquer par suite du désespoir qui l'avait saisi en voyant ses deux filles obligées par leurs maris de refuser non seulement de le prendre chez elles, mais encore de l'y recevoir ostensiblement. Les suppositions que Rastignac avait entendu faire par la duchesse de Langeais se trouvaient ainsi confirmées. À la fin de la première semaine du mois de décembre, Rastignac reçut une lettre de sa mère et une de sa soeur aînée. Il trembla de peur car ces deux frêles papiers contenaient un arrêt de vie ou de mort sur ses espérances. Sa mère avait accepté de lui donner l'argent demandé. Elle lui demandait simplement de faire bon emploi de celui-ci. La lettre de son fils lui avait causé une impression douloureuse. Elle lui demandait dans quelle carrière il allait s'engager. Elle pensait que son bonheur et sa vie semblaient attachés à paraître ce qu'il n'était pas. Elle pensait qu'il pouvait perdre un temps précieux pour ses études. Elle lui disait que les voies tortueuses ne menaient à rien de grand. Mais elle savait combien le coeur de son fils était pur et combien ses intentions étaient excellentes. Elle l'encourageait dans ses projets. Elle voulait qu'il soit sage car les destinées de sa famille reposaient sur sa tête. Elle recommanda de bien aimer sa tante et lui dirait ce que celle-ci avait fait pour lui quand il aurait réussi. Elle voulait qu'il réussisse car Eugène lui avait fait connaître une douleur trop vive pour en connaître une autre. Elle avait su ce que c'était d'être pauvre en désirant la fortune pour la donner à son enfant. Après avoir lu la lettre, Eugène était en pleurs. Cette lettre lui avait fait penser au père Goriot tordant son vermeil et le vendant pour aller payer la lettre de change de sa fille. Il comprenait qu'il venait d'imiter Anastasie et se demanda s'il valait mieux qu'elle. Un instant, il voulut renoncer au monde et ne pas prendre cet argent. Laure, sa soeur aînée, lui donnait des nouvelles de la famille. Agathe, son autre soeur avait sauté de joie en apprenant qu'elle pourrait employer son argent à aider Eugène. Les deux soeurs lui offraient 200 fr. et 50 écus. L'aure avait proposé dans sa lettre de fabriquer pour son frère de belles chemises. Elle avait raison car Eugène avait que des chemises de grosse toile. Il se disait que pour le bonheur d'un autre, une jeune fille devenait rusée autant qu'un voleur. Il avait donc obtenu 1500 fr. Le monde était à lui ! Il convoqua un tailleur qui se considérait comme un trait d'union entre le présent et l'avenir des jeunes gens. Quand Vautrin apprit que Rastignac avait obtenu de l'argent, il lui dit qu'il aurait de quoi payer des leçons d'armes et des séances au tir. Rastignac voulut donner pourboire au facteur qui venait de lui livrer l'argent. Mais il n'avait rien dans sa poche alors Vautrin jeta vingt sous à l'homme. Rastignac fut forcé de le remercier quoi que cet homme lui fût insupportable. Il ne pouvait pas demeurer longtemps sous le feu des batteries de Vautrin sans savoir si cet homme était son ami ou son ennemi. Il lui semblait que ce singulier personnage pénétrait ses passions et lisait dans son coeur, tandis que chez lui tout était si bien clos qu'il semblait avoir la profondeur immobile d'un sphinx qui sait tout et ne dit rien. Eugène défit promptement un sac. Il donna 140 fr. à Mme Vauquer pour sa pension. Il rendit ses 100 sous à Vautrin. Vautrin avait compris que Rastignac avait peur de lui devoir quelque chose. Il dit à Eugène qu'il n'était pas très poli en l'affublant d'un sobriquet alors Eugène lui dit encore une fois qu'il n'était pas marquis et qu'il ne supportait plus d'être appelé ainsi. Rastignac entraîna Vautrin dans le jardin. Victorine implora Vautrin de ne pas tuer Eugène. Vautrin comprit que Victorine avait des sentiments pour le jeune homme et se moqua de la jeune fille. Alors Mme Couture entraîna Victorine avec elle. Vautrin rassura la veuve Vauquer en lui disant qu'il comptait emmener Eugène loin de la pension. Il dit à Rastignac qu'il avait l'air d'être un peu rageur et que rien ne pourrait lui faire ôter son courage. Il voulut rassurer Rastignac en lui disant qu'il était un bon petit jeune homme auquel il ne voulait pas de mal et il avait l'intention de lui parler. Alors Rastignac posa son argent sur la table et s'assit en proie à une curiosité que développa chez lui au plus haut degré le changement soudain opéré dans les manières de cet homme, qui, après avoir parlé de le tuer, se posait comme son protecteur. Il dit à Eugène qu'il avait eu des malheurs mais qu'il était bon avec ceux qui lui faisaient du bien ou dont le coeur parlait au sien. Mais il était méchant comme le diable avec ceux qui le tracassaient.
Il dit à Rastignac que le duel était un jeu d'enfant, une sottise. Il fallait être imbécile pour s'en remettre au hasard. Vautrin était capable de mettre cinq balles de suite dans un as de pique à 35 pas et pourtant il avait tiré sur un homme à 20 pas et il l'avait manqué. Son rival qui n'avait jamais manié de sa vie un pistolet l'avait blessé à la poitrine. Vautrin montra la blessure à Rastignac. Vautrin expliqua que lui aussi a 20 ans croyait encore à l'amour d'une femme et un tas de bêtises dans lesquelles Eugène allait s'embarbouiller. Il voulut que Rastignac comprenne qu'il n'y avait que deux parties à prendre : ou une stupide obéissance ou la révolte. Vautrin avait choisi de n'obéir à rien. Il dit à Rastignac qu'il lui fallait 1 million et promptement. Et ce million, Vautrin voulait le donner à Rastignac. Vautrin savait tout sur la famille de Rastignac. Il ne blâmait pas l'ambition de Rastignac. Avoir de l'ambition, ce n'était pas donné à tout le monde. Il affirmait que les femmes recherchaient les ambitieux. Il était persuadé que les femmes préféraient les hommes dont la force était énorme fussent-elles en danger d'être brisées par ces hommes-là. Après quoi, Vautrin fit l'inventaire des désirs d'Eugène. Il avait d'abord le Code à manger, ce n'était pas amusant et cela n'apprenait rien ; mais il le fallait. Eugène devait devenir avocat pour devenir ensuite président d'une cour d'assises. Eugène devrait donc aboyer après les voleurs, plaider pour les riches et faire guillotiner les gens de coeur. Sans protection, il pourrirait dans un tribunal de province. Vers 30 ans, Eugène serait juge à 1200 fr. par an. Quand il aurait 40 ans, il épouserait quelque fille de meunier, riche d'environ 6000 livres de rente. Avec des protections, Eugène pourrait devenir procureur du roi à 30 ans et épouser la fille du maire. À 40 ans, il deviendrait procureur général puis député. Vautrin fit remarquer à Rastignac qu'il n'y avait que 20 procureurs généraux en France pour 20 000 aspirants au grade. Pour devenir avocat, il fallait pâtir pendant 10 ans, dépenser 1000 fr. par mois, avoir une bibliothèque, un cabinet, aller dans le monde, baiser la robe d'un avoué pour avoir des causes et balayer le palais avec sa langue. Vautrin affirma qu'il n'y avait pas dans Paris cinq avocats qui, à 50 ans, gagnaient plus de 50 000 fr. par an. Si Rastignac se mariait, cela mettrait une pierre à son cou. Se marier pour de l'argent revenait à abandonner ses sentiments d'honneur et sa noblesse. Vautrin savait que Rastignac avait déjà choisi puisqu'il était allé chez M. de Beauséant et y avait flairé le luxe. Il était allé aussi chez Mme de Restaud et y avait flairé la Parisienne. Vautrin avait compris que Rastignac était revenu de chez Mme de Restaud avec le mot « parvenir ! » écrit sur son front. Cela avait plus à Vautrin. Il voulut expliquer à Rastignac qu'une rapide fortune était le problème que se proposaient de résoudre 50 000 jeunes gens qui se trouvaient tous dans sa position. Pour faire son chemin, Rastignac devrait donc avoir l'éclat du génie ou l'adresse de la corruption. L'honnêteté ne servait à rien. On pliait devant le génie si celui-ci persistait. La corruption était l'arme de la médiocrité. Vautrin était prêt à parier que Rastignac tomberait dans un guêpier chez la première femme qui lui plairait. Vautrin pensait que l'honnête homme à Paris était celui qui se taisait et refusait de partager. Vautrin dit à Rastignac que s'il voulait promptement la fortune, il fallait être déjà riche ou le paraître. Vautrin pensait que l'homme était le même en haut, en bas, au milieu. Il conseilla à Rastignac d'aller en droite ligne et la tête haute. Il lui faudrait lutter contre l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre tout le monde. Vautrin possédait 50 000 fr. Il désirait partir aux États-Unis pour satisfaire son goût pour la vie patriarcale. Il proposa à Rastignac de lui procurer une dot d'un million en échange de 200 000 fr. Il n'aurait qu'à réclamer 200 000 fr. à sa future femme. Vautrin pensait qu'une jeune femme ne refusait pas sa bourse à celui qui lui prenait le coeur. Alors Rastignac demanda à Vautrin ce qu'il devait faire. Vautrin répondit qu'il n'aurait presque rien à faire. Il lui expliqua que le coeur d'une pauvre fille malheureuse et misérable était l'éponge la plus avide à se remplir d'amour. Faire la cour à une jeune personne qui se rencontrait dans des conditions de solitude, de désespoir et de pauvreté sans que celle-ci se doute de sa fortune à venir revenait à connaître les numéros à la loterie. Rastignac avait affaire à la ville la plus complaisante qui soit dans le monde. Rastignac demanda où il pourrait trouver une fille. Vautrin lui répondait que l'était devant lui, c'était Victorine. Eugène fut surpris car Victorine n'avait pas un sou. Vautrin lui expliqua que le père de Victorine était un vieux coquin qui passait pour avoir assassiné l'un de ses amis pendant la révolution. C'était un banquier qui avait un fils unique auquel il voulait laisser son bien au détriment de Victorine. Vautrin affirma ne pas aimer ces injustices-là. Il voulait donc prendre la défense du faible contre le fort. Taillefer reprendrait donc sa fille si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils. Victorine pourrait donc bientôt entortiller son père et le faire tourner comme une toupie avec le fouet du sentiment. Rastignac épouserait Victorine et Vautrin se chargerait du rôle de la Providence. Il lui donna encore un conseil, de ne pas plus tenir à ses opinions qu'à ses paroles. Pour Vautrin, il n'y avait pas de principes, il n'y avait que des événements ; il n'y avait pas de lois, il n'y avait que des circonstances. L'homme supérieur épousait les événements et les circonstances pour les conduire. Vautrin disposait d'un colonel de l'armée de la Loire qui exécutait ses basques oeuvres. Il l'enverrait chercher querelle au père de Victorine. Rastignac fut horrifié. Il croyait que Vautrin plaisantait. Vautrin comprenait ce que Rastignac ressentait car c'était de son âge. Il lui dit que la vertu ne se scinde pas, elle est ou n'est pas. Il dit à Eugène qu'un jour il ferait pis.
Vautrin pensait que le secret des grandes fortunes sans cause apparente était un crime oublié, parce que ce crime avait été proprement fait. Rastignac refusait d'en entendre plus car en ce moment, le sentiment était toute sa science. Vautrin n'insista pas mais lui proposa d'y réfléchir encore 15 jours. Après le départ de Vautrin, Rastignac pensa que cet homme lui en avait dit plus sur la vertu que ce qu'il avait pu en apprendre dans les livres. Si la vertu ne souffrait pas de capitulation alors il avait donc volé ses soeurs. Rastignac plongea dans une étourdissante méditation. Il savait que vouloir être grand et riche revenait à mentir, à flatter, à dissimuler. Il voulait travailler noblement jour et nuit et ne devoir sa fortune qu'à son labeur. Il voulait encore croire que le coeur était un bon guide. À ce moment-là, le tailleur arriva. Il essaya ses nouveaux habits. Il était content d'avoir l'air d'un gentilhomme. Puis ce fut au tour du père Goriot d'entrer dans la chambre d'Eugène. Goriot lui dit qu'il savait ou se rendait Mme de Nucingen. Le lundi suivant, elle se rendrait au bal du maréchal Carigliano. Le père Goriot savait tout ce que faisaient ses filles grâce à leurs femmes de chambre Thérèse et Constance. Eugène avait l'intention d'aller chez Mme de Beauséant pour lui demander si elle pouvait le présenter à la maréchale. En se voyant bien habillé, Rastignac oublia sa vertueuse résolution. La jeunesse n'ose pas se regarder au miroir de la conscience quand elle verse du côté de l'injustice. Le père Goriot avait flairé la compassion d'Eugène. Cependant cette union naissante n'avait encore amené aucune confidence. Goriot demanda à Eugène de lui dire laquelle de ses deux filles il préférerait quand il les aurait vues.
Eugène parti se promener aux Tuileries et quelques femmes le remarquèrent. Il était si beau, si jeune et d'une élégance de si bon goût. En se voyant l'objet d'une attention presque admirative, Eugène ne pensa plus à ses soeurs ni à sa tante dépouillées, ni à ses vertueuses répugnances. Il se présenta chez Mme de Beauséant et y reçut un de ces coups terribles contre lesquels les coeurs jeunes sont sans armes. Elle refusa de le voir car elle était en affaire. Eugène aperçut la main de fer sous le gant de velours ; la personnalité, l'égoïsme, sous les manières. Rastignac voulait arriver au bal de la duchesse de Carigliano, il dévora cette bourrasque. Il demanda donc à Mme de Beauséant de le recevoir plus tard. Elle répondit un peu confuse de la dureté qu'elle avait mise dans ses paroles car c'était une femme aussi bonne que grande. Elle acceptait de dîner avec Eugène. Eugène commençait à penser à ce que lui avait dit Vautrin. Chacun pour soi, donc. Il avait tort d'avoir besoin de Mme de Beauséant. Il devait, comme sur un champ de bataille, tuer pour ne pas être tué, tromper pour ne pas être trompé.
Quand il retourna chez la vicomtesse, il la trouva pleine de cette bonté gracieuse qu'elle lui avait toujours témoignée. Eugène ne voulait rien dire en présence du vicomte alors la vicomtesse demanda à son mari s'il comptait la mener aux Italiens. Le vicomte répondit qu'il devait déjà rejoindre quelqu'un aux Variétés. Le vicomte fut surpris qu'elle ne rencontre pas d'Ajuda ce soir-là. Alors il lui proposa de sortir avec M. de Rastignac. Eugène accepta. Il fut conduit par la vicomtesse dans une loge de ce théâtre à la mode. Il remarqua qu'il était le but de toutes les lorgnettes. Il marchait d'enchantements en enchantements. La vicomtesse lui montra où se trouvait Mme de Nucingen. La vicomtesse chercha Mlle de Rochefide et d'Adjuda mais ne les trouva pas. Sa figure prit un éclat extraordinaire. Eugène trouva Mme de Nucingen charmante. La vicomtesse chercha à le contredire. Mme de Nucingen remarqua que Rastignac la regardait. Elle était flattée. La vicomtesse conseilla à Eugène d'arrêter de regarder Delphine pour éviter le scandale. Alors il lui demanda un service : qu'elle lui arrange un rendez-vous chez la duchesse de Carigliano pour y rencontrer Delphine. À ce moment-là, d'Adjuda se présenta dans la loge de Mme de Beauséant. Les rayonnements du visage de la vicomtesse apprirent à Eugène à reconnaître les expressions d'un véritable amour et à ne pas les confondre avec les simagrées de la coquetterie parisienne. Il céda sa place à M. d'Ajuda en se demandant comment celui-ci pouvait trahir la vicomtesse. Eugène était humilié d'être dans ce grand musée de la beauté sans son tableau, c'est-à-dire sans une maîtresse. C'était le signe de la puissance. Il regarda Mme de Nucingen comme un homme insulté regarde son adversaire. La vicomtesse demanda au marquis d'Adjuda de présenter Rastignac à Mme de Nucingen. Le beau Portugais pris le bras de l'étudiant et l'emmena voir Delphine. Il présenta Eugène comme le chevalier de Rastignac, cousin de la vicomtesse de Beauséant. Elle proposa à Eugène la place de son mari qui venait de s'en aller. Eugène lui dit qu'il avait parlé d'elle avec sa cousine en soulignant la distinction de toute sa personne. Le marquis se retira. Delphine dit à Eugène que Mme de Restaud lui avait déjà donné le plus vif désir de le voir. Eugène était surpris car Mme de Restaud lui avait fait consigner sa porte. Il lui en expliqua la raison. Il ajouta que sa cousine et la duchesse de Langeais s'étaient moquées de lui à ce propos. Puis Eugène parla de M. Goriot en précisant qu'il adorait passionnément sa fille Delphine. Il affirma que M. Goriot lui avait parlé de sa fille pendant deux heures le matin même. Delphine lui répondit qu'ils allaient être bientôt de vieux amis. Eugène rétorqua qu'il ne voulait pas être son ami. Mme de Nucingen trouva Rastignac charmant. Mais Delphine détourna la conversation en parlant de son père regrettant que sa soeur se conduise mal avec lui. Il avait fallu que son mari lui ordonne positivement de ne pas voir son père en dehors du matin pour qu'elle renonce à le voir davantage. Il prétendit que cela l'avait fait pleurer. Elle affirma qu'elle était la femme la plus malheureuse de Paris. Eugène lui dit qu'il arrivait du fond d'une province, entièrement neuf et qu'il comptait rester sans amour. Puis sa cousine lui avait fait deviner les 1000 trésors de la passion et depuis il se disait l'amant de toutes les femmes en attendant de se dévouer à une seule d'entre elles. Mme de Nucingen encourage Eugène dans ses compliments. Puis Eugène quitta Delphine quand son mari revint pour la chercher. Eugène eut le temps de lui dire qu'il allait se rendre au bal de la duchesse de Carigliano. Le mari de Delphine lui assura qu'il y serait bien reçu et Eugène remarqua son fort accent alsacien. Eugène avait l'impression d'avoir mis le mors à la bête. La vicomtesse se retira avec d'Adjuda. Eugène accompagna la vicomtesse jusqu'au péristyle. Quand Eugène s'éloigna, le marquis dit à la vicomtesse que Rastignac allait faire sauter la banque car il était souple comme une anguille et le marquis pensait que l'étudiant irait loin. Eugène rentra à pied en faisant les plus doux projets. Il avait remarqué que Mme de Restaud l'avait examiné quand il était dans la loge de la vicomtesse mais aussi dans celle de Mme de Nucingen. Il espérait que la porte de la comtesse ne lui serait plus fermée. Il envisageait d'apprendre à Delphine à gouverner son mari. Ses pensées n'avaient peut-être pas l'âpreté de celles de Vautrin et si elles avaient été soumises au creuset de la conscience, elles n'auraient rien donné de biens purs. Arrivé à la pension, Eugène alla trouver le père Goriot pour lui dire qu'il venait de voir sa fille Delphine. Rastignac ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge ou vivait le père, après avoir admiré la toilette de la fille. La fenêtre était sans rideaux ; le papier de tenture collé sur les murailles s'en détachait. Le père Goriot gisait sur un mauvais lit avec une maigre couverture. Le mobilier était misérable. La chambre du père Goriot ressemblait aux plus tristes logements d'une prison. Heureusement Goriot ne vit pas l'expression qui se peignit sur la physionomie d'Eugène quand celui-ci posa sa chandelle sur la table de nuit.
Goriot lui demanda laquelle de ses filles Eugène préférait. Eugène répondit qu'il préférait Delphine car celle-ci était celle qui aimait le mieux son père. Le père Goriot remercia Eugène et lui serra la main. Eugène répéta les paroles de Delphine en les embellissant et le père Goriot l'écouta comme s'il eût entendu la parole de Dieu. Il expliqua à l'étudiant que ses deux filles se jalousaient. Il pensait que Mme de Restaud l'aimait bien aussi. Il regrettait simplement de n'avoir pas eu de bons gendres. Le père Goriot demanda des détails sur leur robe. Rastignac le assura sur l'élégance de ses deux filles. Puis il demanda au père Goriot comment, en ayant des filles aussi richement établies, il pouvait demeurer dans un taudis pareil. Le père Goriot répondit que cela ne lui servirait à rien d'être mieux établi. Sa vie à lui était dans ses deux filles. Du moment qu'elles étaient heureuses, il lui importait peu d'être bien logé et bien habillé. Il affirma qu'il ne s'ennuyait jamais si ses filles riaient. Il expliqua à Rastignac qu'un jour il saurait que l'on est bien plus heureux du bonheur de ses enfants que du sien propre. Goriot espérait qu'un homme rendrait sa petite Delphine aussi heureuse qu'une femme l'est quand elle est bien aimée et alors il aurait accepté de cirer les bottes de celui qui aurait rendu Delphine heureuse. Il avait su par la femme de chambre de Delphine que M. de Marsay était un mauvais chien et il ne comprenait pas pourquoi Delphine avait épousé cette grosse souche d'Alsacien. Quand il parlait de ses filles, le père Goriot était sublime. Eugène lui apprit que Delphine comptait bientôt rompre avec M. de Marsay. Il a voir au père Goriot qu'il était tombé amoureux de Delphine. Le père Goriot lui répondit que s'il arrivait à plaire à sa fille, alors il se mettrait à l'aimer lui aussi. Mais si Eugène trahissait Delphine alors le père Goriot lui couperait le cou. Après cette conversation, le père Goriot vit dans son voisin un confident inespéré, un ami. Le lendemain matin, au déjeuner, l'affectation avec laquelle le père Goriot regarda Eugène et les quelques paroles qu'il lui dit, surprirent les pensionnaires.
Victorine ne manqua pas de trouver Eugène charmant dans sa nouvelle tenue. Mais Eugène pensa que sa passion de commande pour Mme de Nucingen était l'antidote de ses mauvaises pensées involontaires. Eugène demanda à Goriot de dire à Delphine qu'il l'aimait trop pour ne pas penser à lui procurer satisfaction car il savait le désir de Delphine de se rendre chez la vicomtesse de Beauséant. Puis Rastignac s'en alla promptement à l'école de droit car il voulait rester le moins de temps possible dans cette odieuse maison. Il rencontra son ami Bianchon dans le jardin du Luxembourg. Eugène avoua à son ami qu'il était prêt à tuer pour s'enrichir. Bianchon se disait heureux de la petite existence qu'il allait bientôt pouvoir se créer en province et avait du mal à comprendre les ambitions de son ami. Bianchon dit à Eugène qu'il avait aperçu Michonneau et Poiret au Jardin des Plantes. Tous les deux causaient sur un banc avec Monsieur. Quand Eugène revint à la pension, le père Goriot l'attendait. Il voulait lui montrer une lettre de Delphine. Dans sa lettre, médecine invitait Eugène dans sa loge pour écouter de la musique italienne. Eugène pensa qu'une femme ne se jetait pas ainsi à la tête d'un homme. Il pensait que Delphine voulait se servir de lui pour ramener de Marsay. Eugène ne savait pas qu'à cette époque, la mode commençait à mettre au-dessus de toutes les femmes celles qui étaient admises dans la société du faubourg Saint-Germain parmi lesquelles Mme de Beauséant, la duchesse de Langeais et la duchesse de Maufrigneuse tenaient le premier rang. Mais sa défiance servit bien Eugène car elle lui donna de la froideur et le triste pouvoir de poser des conditions au lieu d'en recevoir.
Eugène irait chez Delphine attiré par la curiosité, peut-être y aurait-il été conduit par la passion si cette femme l'eût dédaigné. Pour un jeune homme, il existe dans sa première intrigue autant de charmes peut-être qu'il s'en rencontre dans un premier amour. Il arrangea ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires. Il descendit, les pensionnaires étaient à table et il reçut gaiement le hourra de sottises que sa tenue élégante excita. Mlle Michonneau fit remarquer que Rastignac allait en conquête. Vautrin fit un discours comique. Eugène leur expliqua qu'il se rendait chez la baronne de Nucingen. Le père Goriot contempla Eugène avec une sorte d'envie. La maison de Nucingen était une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses. La baronne était triste. Rastignac croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et il la trouvait au désespoir. Cela piqua son amour-propre. Elle lui dit que son mari était en ville et qu'elle avait besoin de distraction. Elle ne voulait pas lui dire quelle était la raison de sa tristesse. Elle lui dit simplement que les chaînes d'or étaient les plus pesantes. Elle lui demanda comment il la trouvait et il répondit qu'il voulait qu'elle fût toute à lui. Mais elle pensait que ses chagrins la rendraient laide. Eugène lui prit la main et lui dit que si elle avait des chagrins, elle devait les lui confier. Alors elle lui demanda de venir avec elle dans le coupé de M. de Nucingen. Ils se rendirent au Palais-Royal. Elle lui demanda s'il ne penserait rien de mal sur elle quoiqu'elle puisse lui demander. Il la rassura. Elle voulut savoir s'il était disposé à lui obéir. Il acquiesça. Après quoi, elle lui donnera 100 fr. et lui demanda d'aller les jouer à la roulette. Elle lui dirait ses chagrins à son retour. Eugène pensa qu'elle se compromettait avec lui et qu'elle n'aurait rien à lui refuser. Il se rendit dans une maison de jeu. Il demanda à jouer à la roulette et voulut savoir où il fallait mettre l'enjeu. Un vieillard respectable lui expliqua la règle. Eugène jeta les 100 fr. sur le chiffre de son âge, 21. Il gagna. Le vieillard lui conseilla de prendre son argent car on ne gagne pas deux fois dans ce système-là. Eugène venait de gagner 3600 fr. Mais il décida de les placer sur le rouge. Il gagna encore. Il donna 10 louis au vieillard et descendit avec les 7000 fr., stupéfié de son bonheur. Il rapporta l'argent à Delphine.
Delphine le serra pas une étreinte folle et l'embrassa vivement car Eugène venait de la sauver. Elle lui expliqua que Nucingen ne la laissait pas disposer d'un sou et il la réduisait à une misère secrète par calcul. Elle avait été riche de 700 000 fr. mais s'était laissé dépouiller par son mari. Elle avait souffert le martyre quand elle avait dû déclarer ses dettes à son mari. Nucingen s'était emporté mais il avait payé les dettes. Après quoi, il avait attribué à Delphine une pension à laquelle elle s'était résignée afin d'avoir la paix. Delphine enrageait que Nucingen lui refuse 6000 fr. alors qu'il les donnait tous les mois à sa maîtresse, une fille de l'Opéra. Elle dit à Eugène que la vie de la moitié des femmes de Paris était : un luxe extérieur, des soucis cruels dans l'âme. Elle pensait qu'Eugène ne pourrait pas l'aimer car elle savait que mêler l'argent aux sentiments était horrible. Eugène trouva Delphine naïvement imprudente dans son cri de douleur. Elle lui fit promettre de ne pas utiliser ses confidences contre elle-même. Sur les 7000 fr., elle en garda 6000 pour elle et donna le reste à Eugène. Il lui dit que ce serait une mise de fonds en cas de malheur. Mais elle lui fit jurer de ne jamais retourner au jeu. Elle ne voulait pas le corrompre. Eugène était étourdi par ce contraste de misère et d'opulence. Une fois revenue chez elle, Delphine demanda conseil à Eugène car elle avait une lettre à écrire. C'était à propos de sa dette. Eugène lui conseilla d'envelopper les billets et de les faire envoyer par sa femme de chambre sans écrire un mot. Elle en fut ravie. Delphine envoya Thérèse, sa femme de chambre chez M. de Marsay avec les 6000 fr. Après quoi, Delphine demanda à Eugène de venir dîner avec elle les jours d'Italiens. Après le dîner, Delphine emmena Rastignac au théâtre. Après quoi, Delphine raccompagna Eugène jusqu'au Pont-Neuf. Eugène était à la fois heureux et mécontent : heureux d'une aventure dont le dénouement probable lui donnait une des plus jolies et des plus élégantes femmes de Paris, objet de ses désirs ; mécontent de voir ses projets de fortune renversé. Plus il jouissait de la vie parisienne, moins il voulait demeurer obscure et pauvre. À la pension Vauquer, le père Goriot avait laissé sa porte ouverte et sa chandelle allumée afin que l'étudiant n'oublie pas de lui raconter sa soirée. Eugène ne lui cacha rien. Le père Goriot demanda à Eugène pourquoi il n'était pas venu rapporter plutôt son embarras plutôt que de risquer au jeu ses pauvres petits 100 fr. Il restait encore 1300 livres de rente il était prêt à les sacrifier pour Delphine. Eugène donna les 1000 fr. au père Goriot. Goriot versa une larme. Le père Goriot dit à Rastignac qu'il réussirait dans la vie. En se couchant, Eugène se dit qu'il serait honnête homme toute sa vie car il y avait du plaisir à suivre les inspirations de sa conscience. Le lendemain, Rastignac alla chez Mme de Beauséant qui l'emmena pour le présenter à la duchesse de Carigliano. Il y retrouva Mme de Nucingen. Pendant cette fête, Rastignac mesura tout à coup la portée de sa position et comprit qu'il avait un état dans le monde en étant cousin avoué de Mme de Beauséant. La conquête de Delphine le mettait si bien en relief que tous les jeunes gens lui jetaient des regards d'envie. Les femmes lui prédisaient toutes des succès. Delphine, craignant de le perdre, lui promit de ne pas lui refuser le soir le baiser qu'elle s'était tant défendue d'accorder l'avant-veille. Rastignac reçut plusieurs engagements. Cette soirée eût donc pour lui les charmes d'un brillant début et il devait s'en souvenir jusque dans ses vieux jours comme une jeune fille se souvient du bal où elle a eu des triomphes. Le lendemain, quand, en déjeunant, il raconta ses succès au père Goriot devant les pensionnaires, Vautrin se prit à sourire d'une façon diabolique. Vautrin expliqua à Rastignac d'un air paternellement railleur que s'il voulait faire figure à Paris, il lui faudrait trois chevaux et un tilbury pour le matin, un coupé pour le soir. Il dit à Eugène qu'il aurait besoin de 25 000 fr. par an s'il ne voulait pas être destitué de son avenir et de son succès. Plusieurs jours se passèrent pendant lesquels Rastignac mena la vie la plus dissipée en dînant presque tous les jours avec Mme de Nucingen. Il jouait gros jeu, perdait ou gagnait beaucoup et finit par s'habituer à la vie exorbitante des jeunes gens de Paris. Sur ses premiers gains, il remboursa sa mère et ses soeurs en accompagnant sa restitution de jolis présents. Mais il ne savait pas comment sortir de la pension Vauquer. La bourse de Rastignac était toujours vide pour Mme Vauquer et pleine pour les exigences de la vanité. Rastignac s'était endetté. Il commençait à comprendre qu'il lui serait impossible de continuer cette existence sans avoir des ressources fixes. Mais il se sentait incapable de renoncer aux jouissances excessives de cette vie. Il s'était aperçu que, pour convertir l'amour en instrument de fortune, il fallait avoir bu toute honte, et renoncer aux nobles idées qui sont l'absolution des fautes de la jeunesse.
Pour la première fois depuis longtemps, Eugène avait dîné à la pension. Il s'était montré pensif pendant le repas. Frappé de la préoccupation à laquelle Eugène était en proie, Vautrin resta dans la salle à manger. Il avait lu dans l'âme de l'étudiant et pressentait un symptôme décisif. Après s'être compromise aux yeux du public pour fixer près d'elle le cousin de Mme de Beauséant, Delphine hésitait à lui donner réellement les droits dont il paraissait jouir. Depuis un mois, Delphine irritait si bien les sens d'Eugène, qu'elle avait fini par attaquer le coeur. Elle était devenue la plus forte dans leur relation. Toutes les espérances des Delphine avaient été trahies une première fois, et sa fidélité pour un jeune égoïste venait d'être méconnue. Elle pouvait être défiante à bon droit. Elle désirait sans doute paraître imposante à un homme de cet âge et elle se trouvait grande devant lui après avoir été longtemps si petite devant celui par qui elle était abandonnée. Elle ne voulait pas qu'Eugène la crût une facile conquête, précisément parce qu'il savait qu'elle avait appartenu à de Marsay. Le véritable amour payait pour le mauvais. Delphine se jouait de Rastignac parce qu'elle se savait aimée et sûre de faire cesser les chagrins de son amant. Eugène ne voulait pas que son premier combat se termine par une défaite il persistait dans sa poursuite. Parfois, Eugène, malgré la voix de sa conscience, pensait aux chances de fortune dont Vautrin lui avait démontré la possibilité par un mariage avec Mlle Taillefer. Alors il regarda Victorine d'une manière assez tendre pour lui faire baisser les yeux. Elle lui demanda s'il avait des chagrins. Il se confia à Victorine. Rastignac lui demanda si elle aimerait encore le jeune homme pauvre qui lui aurait plu durant ses jours de détresse après être devenue riche. Vautrin s'immisce dans la conversation. Vautrin venait de causer la plus cruelle émotion qu'Eugène avait jamais ressentie. Mme Couture ordonna à Victorine de remonter dans sa chambre. Vautrin conseilla à Eugène de ne pas décider dans ce moment car il sentait qu'Eugène n'était pas dans son assiette ordinaire. Il ne voulait pas que Rastignac soit déterminé par la passion et le désespoir mais que ce soit la raison qui le guide vers lui. Vautrin lui proposa alors de l'argent. Eugène était dans la plus cruelle des situations. Il devait au marquis d'Adjuda et au comte de Trailles cent louis perdus sur parole. Il n'osait pas passer la soirée chez Mme de Restaud où il était attendu. Rastignac avoua à Vautrin qu'il lui était impossible de lui avoir des obligations. Alors Vautrin lui proposa 3500 fr. payables en un an. Il avait ajouté un intérêt assez fort pour ôter à Eugène tout scrupule. Il permit même à Eugène de le mépriser encore car il était sûr que plus tard Rastignac l'aimerait.
Eugène signa la traite. Vautrin lui promit de l'aider s'il devenait riche en Amérique. Vautrin prétendit avoir la passion de se dévouer pour un autre.
Vautrin considérait les actions comme des moyens et ne voyait que le but. Il déclara à Rastignac qu'il n'existait qu'un seul sentiment réel, une amitié d'homme à homme. Mais quand Vautrin partit, Eugène se dit qu'il n'épouserait jamais Mlle Taillefer. Il se rendit chez Mme de Restaud. Il paya Messieurs de Trailles et d'Adjuda. Il joua au whist et regagna ce qu'il avait perdu. Il voulut voir dans son bonheur une récompense du ciel pour sa persévérance à rester dans le bon chemin. Le lendemain, il rendit les 3000 fr. qu'il devait à Vautrin en manifestant un plaisir assez naturel. Il ne voulait pas être son complice. Deux jours plus tard, Poiret et Mlle Michonneau se trouvaient assis sur un banc du Jardin des Plantes et causaient avec le monsieur qui paraissait à bon droit suspect à Bianchon. Le monsieur s'appelait Gondureau. Gondureau avait distingué Poiret comme un de ces niais bureaucratiques à qui le nom Son excellence fait faire n'importe quoi. Gondureau dit à Poiret que Son Excellence avait maintenant la certitude la plus complète que le prétendu Vautrin était un forçat évadé du bagne de Toulon où il était connu sous le nom de Trompe-la-mort. Vautrin avait consenti à prendre sur son compte le crime d'un autre, un faux commis par un très beau jeune homme qu'il aimait beaucoup, un jeune Italien assez joueur. Mlle Michonneau se demandait pourquoi son excellence le ministre de la police avait besoin d'elle. Gondureau expliqua à Poiret et à Mlle Michonneau que Vautrin recevait les capitaux de Messieurs les forçats et les tenait à la disposition des bannières qui voulaient s'évader. Gondureau pensait que Vautrin recelait l'argent de ses camarades et aussi celui qui provenait de la Société des Dix-Mille. C'était une association de voleurs qui ne se mêlaient pas d'une affaire où il n'y avait pas 10 000 fr. à gagner. Collin était l'homme de confiance de cette société. Collin avait su se créer une police à lui et des relations fort étendues. La police était donc à la recherche de Trompe-la-Mort. C'était devenu une affaire d'État. Mlle Michonneau demanda pourquoi Trompe-la-Mort ne s'en allait-il pas avec la caisse. L'agent lui expliqua que si Collin/ Trompe-la-Mort tentait de voler le bagne, il serait suivi d'un homme chargé de le tuer. L'agent estimait que Trompe-la-Mort avait chaussé la peau d'un honnête homme et s'était fait bon bourgeois de Paris. Il devait loger dans une pension sans apparence. Mais le ministre ne voulait pas risquer de faire une erreur en arrêtant Vautrin. S'il y avait erreur, ceux qui voulaient sa place profiteraient des criailleries libérales pour le faire sauter. L'agent pensait que Trompe-la-Mort n'aimait pas les femmes. Ce subterfuge ne pouvait donc pas être tenté. Mlle Michonneau demanda alors à l'agent en quoi elle pouvait lui être utile et il répondit qu'il lui remettrait un flacon contenant une liqueur simulant une crise d'apoplexie. Alors Mlle Michonneau n'aurait plus qu'à transporter Vautrin sur un lit et le déshabiller et le fouiller. Mlle Michonneau accepta. Elle recevrait 2000 fr. si la mission réussissait et 500 fr. d'indemnités en cas d'échec. Mlle Michonneau négocia pour obtenir 3000 fr. en cas de réussite et rien du tout si Vautrin était un simple bourgeois. Gondureau accepta. Mais l'affaire devait être résolue dès le lendemain. Bianchon qui revenait du cours de Cuvier entendit le mot assez original de Trompe-la-Mort. Et entendit également le « ça va » du célèbre chef de la police de sûreté. Quand Mlle Michonneau et Poiret rentrèrent à la maison Vauquer, ils aperçurent Rastignac engagé avec Mlle Taillefer dans une intime causerie. Mlle Michonneau n'en fut pas surprise. Eugène avait été, pendant la matinée, réduit au désespoir par Mme de Nucingen. Il s'était abandonné complètement à Vautrin et venait d'échanger les plus douces promesses avec Mlle Taillefer. Heureusement pour Rastignac, le miracle eut lieu : Vautrin entra joyeusement et Victorine se sauva. Vautrin annonça à Rastignac que l'affaire était faite. Le père de Victorine serait assassiné et Victorine deviendrait riche. Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. Vautrin lui dit qu'il était fort, carré et lui donna son estime. Quand Vautrin voulut lui prendre la main, Rastignac retira vivement la sienne en pâlissant ; il croyait voir une mare de sang devant lui. Mais Vautrin parla des 3 millions de rentes qu'il obtiendrait de Victorine. Rastignac n'hésita plus. Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée le père et le frère de Victorine. Après quoi, le père Goriot remarqua la tristesse d'Eugène et ils allèrent dans la chambre de Rastignac. Le père Goriot expliqua à Eugène que si Delphine l'avait chassé le matin c'est parce qu'elle avait rendez-vous avec son père. Le père Goriot révéla à Eugène que Delphine venait d'arranger un appartement pour Rastignac. Ce serait rue d'Artois. Le père Goriot avait fait bien des choses depuis un mois sans rien dire à Rastignac. Sa fille aurait 36 000 fr. par an et il allait faire exiger le placement de ses 800 000 fr. en bons bien au soleil.
Le père Goriot profita d'un moment où l'étudiant lui tournait le dos pour mettre sur la cheminée une boîte en maroquin rouge sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. Le père Goriot s'était mis dans tout cela jusqu'au cou car il était intéressé de voir Rastignac changer de quartier. Il demanda quelque chose en échange à l'étudiant. Il voulait occuper la chambre qui était au-dessus de celle où Rastignac logerait. Il voulait également que Rastignac lui parle de ses filles tous les soirs. Le père Goriot proposa à Eugène de lui rendre les services qu'il demanderait. Il aurait voulu que le mari de sa fille meure et que Rastignac devienne son gendre. Delphine avait beaucoup parlé de Rastignac au père Goriot dans la matinée. Eugène était abasourdi car il pensait au duel annoncé par Vautrin pour le lendemain. Cela contrastait avec la réalisation de ses plus chères espérances. Il aperçut la petite boîte carrée et l'ouvrit . Il trouva dedans un papier qui couvrait une montre de Breguet. Sur le papier étaient écrits ces mots : « je veux que vous pensiez à moi à toute heure, parce que… Delphine. »
Eugène fut attendri par le mot. Il regarda à l'intérieur de la boîte. Les dessins répondaient à tous ses voeux. Le père Goriot était radieux. Le père Goriot aimait déjà Rastignac et pour sa fille et pour lui-même. Il dit à Eugène que Delphine l'attendait dans la soirée. Rastignac accepta la demande du père Goriot. Le père Goriot l'embrassa. Puis Rastignac demanda au père Goriot de se rendre chez M. Taillefer et de lui dire de donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance. Le père Goriot avait entendu les rumeurs sur une possible liaison entre Rastignac et Victorine. Il menaça de frapper Eugène mais l'étudiant lui jura qu'il n'aimait pas Victorine. Il expliqua au père Goriot que le fils de Taillefer allait se battre le lendemain. Il lui explique aussi qu'il fallait dire au père Taillefer d'empêcher son fils de se rendre au rendez-vous. Vautrin arriva à ce moment-là et ils descendirent avec lui pour dîner. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner. Malgré cela Vautrin multiplia les saillies. Ce sang-froid consternait Eugène. Vautrin offrit une bouteille de Bordeaux aux pensionnaires. Mais le vin était bouchonné alors Rastignac offrit le champagne. Vautrin fit apporter d'autres bouteilles de Bordeaux. Les convives s'animèrent. Vautrin conduisait comme un chef d'orchestre, en surveillant Eugène et le père Goriot qui semblaient déjà ivres. Quand les yeux de Rastignac vacillèrent, Vautrin se pencha à l'oreille de l'étudiant pour lui dire : « mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusé pour lutter avec votre papa Vautrin et il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises »
Vautrin avait appris qu'Eugène comptait prévenir le père Taillefer. Pendant que Rastignac serait assoupi le colonel Franchessini ouvrirait la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée et en héritant de son frère, Victorine aurait 15 000 fr. de rente. Rastignac s'était endormi et Vautrin demanda à Victorine de rester pour le soigner en lui prédisant qu'il serait son mari. Puis Sylvie emmena le père Goriot dans sa chambre. Victorine passa sa main dans les cheveux de Rastignac. Mme Couture était restée pour la surveiller. Puis Vautrin dit à Mme Couture que ce qui l'attachait à ce jeune homme était de savoir la beauté de son âme en harmonie avec celle de sa figure et il prit la main de Victorine en prétendant connaître la chiromancie. Il affirma que Victorine serait bientôt l'une des plus riches héritières de Paris et qu'elle comblerait de bonheur celui qu'elle aimerait. Son père l'appellerait et elle se marierait avec un homme, jeune, beau qui l'adorerait. Il s'en alla au théâtre avec Mme Vauquer. Après leur départ, Victorine dit à Mme couture qu'elle espérait voir se réaliser les prédictions de Vautrin. Mme Couture répondit qu'une seule chose suffisait pour cela, que son monstre de frère tombe de cheval. Victorine lui dit que son bonheur lui serait souvent pénible à porter s'il devait coûter la vie à quelqu'un. Victorine, Mme Couture et Sylvie transportèrent Eugène dans sa chambre et le couchèrent sur son lit. Avant de partir, quand sa protectrice eut le de tourner, Victorine mit un baiser sur le front d'Eugène. Le festoiement à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé décida la perte de cet homme. Bianchon oublia de questionner Mlle Michonneau sur Trompe-la-Mort. Si Bianchon avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin, ou, pour lui rendre son vrai nom, de Jacques Colin, l'une des célébrités du bagne.
Mlle Michonneau, accompagné de Poiret, alla trouver le fameux chef de la police de sûreté, Gondureau. Le policier lui confia une fiole contenant une drogue. Mme Michonneau comprit qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat. Elle pensait que la police espérait mettre la main sur des valeurs considérables. Mais Gondureau voulut détourner les soupçons de la vieille fille. Il lui dit espérer pouvoir éliminer Collin dès le lendemain matin. Ainsi la police pourrait empêcher une centaine de crimes et éviter la corruption de 50 mauvais sujets qui se tiendraient bien sagement aux environs de la correctionnelle.
Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquer. D'abord le père Goriot et Eugène dormirent jusqu'à onze heures et demie. Le long sommeil de Christophe causa des retards dans le service de la maison. Victorine et Mme Couture, elles aussi dormirent la grasse matinée. Vautrin revint au moment même où le déjeuner fut servi. Pendant que Sylvie et Christophe s'absentèrent, Mlle Michonneau versa la drogue dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie, comme les autres.
Quand Eugène se réveilla, un commissionnaire lui remit une lettre de Mme de Nucingen. Delphine était inquiète de son absence, la veille au soir. Elle voulait une explication. Eugène demandait l'heure qu'il était. Vautrin lui dit qu'il était onze heures et demie. Un fiacre s'arrêta devant la maison Vauquer. C'était un domestique de M. Taillefer qui était venu chercher Victorine. Un grand malheur était arrivé. Il annonça à Victorine que son frère avait été grièvement blessé lors d'un duel. Vautrin acheva de boire son café tranquillement. Lecteur il s'en alla avec Mme Couture Mme Vauquer dit à Vautrin qu'il était donc prophète.
Vautrin s'exclama en disant à Eugène, qu'hier Victorine était sans un sou et ce matin elle devenait riche de plusieurs millions. Le père Goriot regarda l'étudiant elle lui vit à la main la lettre chiffonnée de sa fille. Il lui demanda s'il était comme les autres. Eugène affirma que jamais il n'épouserait Victorine avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Alors le père Goriot saisit la main de Rastignac et la lui serra. Le commissionnaire de Mme de Nucingen attendait la réponse de Rastignac. Eugène annonça qu'il viendrait. Vautrin s'effondra. La potion absorbée avait opéré. Eugène déclara qu'il y avait donc une justice divine. Mlle Michonneau affirma que c'était une crise d'apoplexie. Mme Vauquer demanda un Rastignac d'aller chercher M. Bianchon. Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. Mme Vauquer et Christophe transportèrent Vautrin jusqu'à son lit. Mlle Michonneau envoya Mme Vauquer chercher de l'éther puis elle déshabilla Vautrin avec l'aide de Poiret. Vautrin fut retourné et Mlle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque et les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. Après quoi, Mlle Michonneau remit la chemise de Vautrin. Mme Vauquer revint avec de l'éther. Elle remarqua que le coeur de Vautrin battait régulièrement. Pendant ce temps-là, Rastignac était sorti pour prendre l'air. Il tremblait d'être le complice du crime de Vautrin. Il espérait que Vautrin allait mourir sans parler. Il rencontra Bianchon qui lui annonça avoir lu dans le journal que le fils Taillefer s'était battu en duel avec le comte Franchessini. Il demanda à Rastignac s'il était vrai que Victorine le regardait d'un bon oeil. Rastignac répondit qu'il n'épouserait jamais Victorine. Bianchon ne voulait pas croire qu'une femme vaille le sacrifice de la fortune du sieur Taillefer. Puis Eugène demanda à Bianchon de se rendre chez la mère Vauquer car Vautrin venait de tomber comme mort. Puis Rastignac continua ses réflexions en marchant. Il décida de prendre soin du père Goriot et de s'arranger pour qu'il puisse voir souvent sa fille Delphine. Il pensait que le soir il serait heureux et il regarda la montre que Delphine lui avait offerte. Il pensait qu'aimer Delphine ce n'était pas tromper quelqu'un car elle s'était depuis longtemps séparée de son mari. Le combat de Rastignac dura longtemps. La victoire était pour les vertus de la jeunesse. Il rentra à la pension Vauquer tout en se disant qu'il la quitterait bientôt pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Bianchon avait administré un vomitif à Vautrin. Puis il avait fait porter à son hôpital les matières rendues par Vautrin afin de les analyser chimiquement. Bianchon avait remarqué l'insistance que mit Mlle Michonneau à vouloir les faire jeter et ses doutes se fortifièrent. Bianchon soupçonnait quelque complot contre Rastignac. Les pensionnaires avaient entendu la nouvelle du duel de Taillefer le fils et devisaient de cette aventure, moins le père Goriot. Quand Eugène entra, ses yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable Vautrin et cela le fit frissonner. Vautrin crut deviner les pensées de Rastignac et lui demanda à l'oreille s'il était fâché de le voir en vie. À ce moment-là, Bianchon révéla à Vautrin que Mlle Michonneau avait évoqué le nom d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort pour dire à Vautrin que ce nom lui irait bien. Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre : il pâlit et chancela. Poiret comprit que Mlle Michonneau était en danger tant la figure du forçat devint férocement significative. Au moment où Collin cherchait une issue en regardant les fenêtres et les murs, quatre hommes se montrèrent à la porte du salon. Le premier était le chef de la police de sûreté et les trois autres étaient des officiers de paix. Tout espoir de fuite fut donc interdit à Trompe-la-Mort. Le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque et rendit à la tête de Collin toute son horreur. Vautrin avait en réalité les cheveux rouge brique et courts ce qui lui donnait un épouvantable caractère de force mêlé de ruse. Les pensionnaires comprirent qui était vraiment Vautrin. Vautrin se rendit sans résister. Vautrin ordonna à un des policiers de rédiger le procès-verbal de l'arrestation. Vautrin reconnaissait être Jacques Collin dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de bagne. Vautrin adressa un sourire gracieux à Rastignac en lui disant que leur petit marché allait toujours, en cas d'acceptation, toutefois.
Rastignac baissa les yeux en acceptant ce cousinage criminel comme une expiation de ses mauvaises pensées. Vautrin demanda qui l'avait trahi. Il est dédié unique ainsi que Mlle Michonneau. Il lui dit qu'il était chrétien et qu'il lui pardonnait. La police était en train de fouiller dans la chambre de Vautrin. Mais Vautrin leur déclara que la police ne trouverait rien. Il avait tout dans la tête. Vautrin avait deviné qui était le mouchard et il comptait bien le faire assassiner. C'était un dénommé Fil-de-soie. Vautrin savait qu'il serait bientôt libre grâce à ses 10 000 frères sur lesquels il comptait pour le faire évader du bagne. Avant d'être emmené, Vautrin dit aux pensionnaires qu'ils avaient été tous très aimables pour lui pendant son séjour et qu'il en aurait de la reconnaissance. Il dit à Eugène qu'il lui avait laissé un ami dévoué. En cas de malheur, Eugène pourrait s'adresser à cet ami. Après le départ de la police et de Vautrin, Sylvie déclara que Vautrin était un bon homme tout de même. Les autres pensionnaires regardèrent Mlle Michonneau avec dégoût. Bianchon déclara qu'il s'en irait de la pension si Mlle Michonneau restait. Cette proposition fut approuvée par l'ensemble des pensionnaires à l'exception de Poiret. Bianchon demanda à Poiret de parler à Mlle Michonneau. Poiret s'exécuta. Mais Mlle Michonneau avait payé et ne voulait pas partir. Les autres pensionnaires acceptèrent de se cotiser pour la rembourser. Elle accusa un Rastignac de soutenir Vautrin. Il était prêt à bondir sur elle mais les pensionnaires l'en empêchèrent. La mère Vauquer fut contrainte de forcer Mlle Michonneau à s'en aller. Poiret regarda tendrement Mlle Michonneau sans savoir s'il devait la suivre ou rester. Il finit par prendre le bras de la vieille et ils sortirent ensemble sous une explosion de rires. En ce moment, un commissionnaire entra pour remettre une lettre à Mme Vauquer. Le fils Taillefer était mort. Mme Couture et Victorine annonçaient à Mme Vauquer qu'elles quittaient la pension. Victorine allait retrouver son père. Mme Vauquer se retrouvait avec cinq pensionnaires de moins. Puis Goriot arriva en fiacre. Eugène lui expliqua ce qui venait d'arriver à Vautrin et lui annonça la mort de fils Taillefer. Mais Goriot s'en moquait car Delphine les attendait pour dîner. Mme Vauquer n'eut pas le courage de dire un mot en ne voyant que 10 personnes au lieu de 18 autour de sa table mais chacun tenta de la consoler. Le père Goriot était fou de joie car il n'avait pas dîné avec sa fille depuis quatre ans. Eugène avait l'impression de revenir à la vie. La voiture s'arrêta rue d'Artois. L'appartement se trouvait au troisième étage d'une maison neuve et de belle apparence. L'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli et de plus gracieux. Eugène prit Delphine dans ses bras en pleurant de joie. Delphine lui dit à l'oreille qu'il était une de ces créatures que l'on devait adorer toujours. Eugène avait du mal à accepter un tel cadeau. Alors Delphine lui dit que son sort était entre ses mains. Il lui dit qu'il réussirait et ferait une brillante fortune. Il pourrait lui rendre plus tard ce qu'elle lui prêtait aujourd'hui. Alors le père Goriot demanda à Rastignac s'il comptait emprunter de l'argent à des juifs. Il acquiesça. Le père Goriot répondit qu'il s'était fait juif et qu'il avait payé toutes les factures. Eugène pourrait le rembourser plus tard. Eugène et Delphine se regardèrent avec surprise en pleurant. Rastignac tendit la main au bonhomme pour la lui serrer. Le père Goriot expliqua comment il avait réussi à trouver l'argent. Delphine était si heureuse qu'elle sauta sur son père qui la reçut sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers. Le père Goriot n'avait pas senti le coeur de sa fille battre sur le sien depuis 10 ans. Le père Goriot avait la physionomie de ce Christ de la Paternité. Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet homme et le contempla en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. Il déclara qu'il serait digne de tout cela. Le père Goriot expliqua à sa fille qu'Eugène avait refusé Mlle Taillefer et ses millions. Delphine promit de d'aller voir son père à chaque fois qu'elle irait chez Eugène. À la fin de la soirée, Delphine dit à Eugène que quand son père était avec eux, il fallait être tout à lui. Elle pensait que ce serait pourtant bien gênant quelquefois. Puis le père Goriot et Rastignac retournèrent à la maison Vauquer. Eugène ne pouvait pas se dissimuler que l'amour du père écrasait le sien par sa persistance et par son étendue. Mme Vauquer se lamentait de sa maison déserte. Elle aurait voulu que Mlle Michonneau soit enfermée au bagne à la place de Vautrin.
Ce moment-là que le père Goriot et Rastignac arrivèrent. Ils annoncèrent à la mère Vauquer qu'ils quittaient la pension pour demeurer à la Chaussée-d'Antin. Eugène ne comprenait pas le désespoir de la mère Vauquer alors Sylvie lui expliqua. Tous les pensionnaires étaient partis et Sylvie voyait sa patronne pleurer pour la première depuis qu'elle était à son service. Le lendemain, la mère Vauquer était toujours accablée on Eugène reçut une lettre qui contenait une invitation adressée à M. le à Mme de Nucingen pour le grand bal annoncé depuis un mois et qui devait avoir lieu chez la vicomtesse. La vicomtesse demandait à Rastignac d'être l'interprète de ses sentiments auprès de Mme de Nucingen. Eugène comprit que Mme de Beauséant lui disait assez clairement qu’elle ne voulait pas du baron de Nucingen au bal. Rastignac se rendit chez Mme de Nucingen. Il n'était pas encore arrivé au point d’où l'homme peut contempler le cours de la vie et la juger. Il avait continuellement hésité à franchir le Rubicon parisien. Néanmoins ses derniers scrupules avaient disparu la veille, quand il s'était vu dans son appartement. En jouissant des avantages matériels de la fortune, il avait dépouillé sa peau d'homme de province et il s'était doucement établi dans une position d'où il découvrait un bel avenir. Eugène se rappelait le Rastignac qu'il était un an auparavant quand il était arrivé à Paris. Il se demandait s'il se ressemblait en ce moment même. En découvrant l'invitation au bal, Delphine fit un mouvement de joie. Elle était ravie d'être enfin présentée dans le faubourg Saint-Germain. Eugène demanda ce qu'elle pensait du fait que Mme de Beauséant n'avait pas l'air de dire dans sa lettre que le baron de Nucingen était invité. Delphine avait compris la même chose qu'Eugène. Delphine raconta les dernières rumeurs sur sa soeur à Eugène. Selon certaines personnes, M. de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant de 100 000 fr. et pour lesquelles il allait être poursuivi. C'est pourquoi elle aurait vendu ses diamants à un juif qui lui venaient de sa belle-mère. Delphine n'appréciait pas sa soeur qui avait toujours cherché à l'écraser. Eugène se souvenait que la veille, Delphine lui avait dit avoir le sentiment qu'un jour elle devrait payer son bonheur par une affreuse catastrophe. Eugène retourna à la maison Vauquer avec la certitude de la quitter le lendemain. Sur le chemin, il s'abandonna à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. Il promit au père Goriot de lui raconter la soirée au bal. Le lendemain matin, Delphine arriva à la pension pour voir son père. Eugène avait payé ses dettes auprès de la mère Vauquer. Il retrouva dans le grand tiroir de sa table l'acceptation en blanc, souscrite à Vautrin qu'il avait insouciamment jeté le jour où il l’avait acquittée. Il était sur le point de déchirer ce papier quand il entendit la voix de Delphine. Il questionna la conversation que tint Delphine avec son père. Delphine remerciait son père d'avoir demandé le comte de sa fortune assez à temps pour qu'elle ne soit pas ruinée. Elle venait d'apprendre que son mari avait jeté tous les capitaux de ceux de sa femme dans des entreprises à peine commencées. Il ne voulait pas déposer son bilan et donc rendre l'argent qu'il avait emprunté à sa femme sans le lui dire. Il s'était engagé sur l'honneur à rendre à Delphine une fortune double ou triple en plaçant ses capitaux dans des opérations territoriales. Il avait rendu sa liberté à Delphine à la condition de le laisser entièrement maître de gérer les affaires sous son nom. Il voulait encore pendant deux ans la conduite de la maison et avait supplié Delphine de ne dépenser que la somme qu'il voudrait bien lui accorder. Mais Delphine avait insisté pour voir les livres de compte de son mari qui avait pleuré en menaçant de se tuer.
Le père Goriot expliqua sa fille que son mari l'abusait. Le père Goriot comptait bien défendre sa fille. Il ne voulait pas que toute la fortune qu'il avait amassée disparaisse en fumée à cause du mari de Delphine. Heureusement Delphine était mariée sous le régime de la séparation des biens. Son père comptait tirer toute cette histoire au clair. Delphine avait peur car elle savait son mari capable de s'enfuir avec tous les capitaux. Il ne fallait donc pas le pousser à bout.
Delphine était obligée de consentir à la demande de son mari sous peine d'être ruinée. Il avait acheté sa conscience en la laissant être à son aise la femme d'Eugène. Son mari avait acheté des terrains nus puis y avait fait bâtir des maisons par des hommes de paille. C'était ces hommes de paille qui concluaient les marchés avec des entrepreneurs qui faisaient ainsi faillite. Pour réussir cette escroquerie Nucingen avait envoyé des valeurs considérables à Amsterdam, à Londres, à Naples, à Vienne. Effondré, le père Goriot demanda pardon à sa fille de l'avoir livrée à ce misérable. Il s'engageait à débrouiller l'écheveau d'affaires que son mari avait mêlé. Mais Delphine refusa car elle voulait s'en occuper seule. Elle voulait simplement que son père vienne examiner les livres de compte. En ce moment une voiture s'arrêta devant la pension. C'était Mme de Restaud. Elle fut embarrassée de rencontrer sa soeur. Anastasie était venue confier ses malheurs à son père. Son amant M. de Trailles devait 100 000 fr. Anastasie les avaient trouvés en disposant de ce qui ne lui appartenait pas. Elle se mit à pleurer en posant sa tête sur le cou de sa soeur qui pleura également. Anastasie avait porté chez Gobseck les diamants de famille de son mari pour les vendre mais son mari l'avait appris. Il avait demandé à Anastasie de signer la vente de ses biens dès qu'il le lui demanderait. Il voulut également savoir lequel de leurs deux enfants était bien le sien Anastasie répondit que c'était Ernest.
Malgré la vente des diamants, Maxime devait encore 12 000 fr. Il avait donc été poursuivi. Mais le père Goriot n'avait plus d'argent. Il ne lui restait plus que 1200 fr. de rente viagère. Anastasie apprit que son père avait dépensé tout ce qui lui restait pour acheter un appartement pour Delphine et Eugène. Elle se mit en colère contre Delphine. Les deux soeurs se disputèrent. Le père Goriot tenta de les réconcilier. Il se mit à genoux devant Delphine pour l'implorer de demander pardon à sa soeur. Le père Goriot était effondré de ne pouvoir sauver Anastasie. Épouvanté, Eugène prit la lettre de change souscrite à Vautrin et en corrigeant le chiffre. Cela lui permit de trouver le père Goriot et de lui offrir 12 000 fr. Il dit que leur conversation l'avait réveillé. La comtesse se mit en colère contre Delphine. Anastasie pensait que sa soeur l'avait laissée délibérément livrer ses secrets tout en sachant qu'Eugène écoutait. Le père Goriot tenta d'apaiser Anastasie et lui demanda d'embrasser Eugène pour le remercier de son geste. Le père Goriot l'embrassa Eugène et le remercia en lui promettant d'être plus qu'un père pour lui. Mais Anastasie était toujours en colère et son père s'évanouit. Alors Anastasie s'enfuit. Le père Goriot revint à lui et Anastasie rentra pour se jeter aux genoux genou de son père et lui demander pardon. Puis elle remercia Eugène. Les deux soeurs se réconcilièrent. Quand Anastasie s'en alla, Eugène dit à l'oreille de Delphine que sa soeur était revenue pour prendre la lettre de change. Il lui conseilla de se méfier de sa soeur. Le père Goriot éprouva le besoin de dormir alors Eugène et Delphine s'en allèrent. Delphine voulut regarder la chambre d'Eugène. En la découvrant, elle fut épouvantée. Elle lui conseilla de ne pas jeter son argent s'il voulait faire fortune. Les deux amants entendirent un gémissement dans la chambre du père Goriot. Le père Goriot rassura sa fille et dit aux amants d’être heureux. Ils le laissèrent. Eugène raccompagna Delphine chez elle et retourna à la pension, inquiet pour le père Goriot.
Rastignac trouva le père Goriot debout mais sa conscience était absente. Il le dit à Bianchon. L’interne de Cochin estima que Goriot semblait être sous le poids de l’apoplexie. Le soir, aux Italiens, Eugène ne voulut pas alarmer Delphine. Delphine dit à Eugène que son père lui avait donné un cœur mais Eugène l’avait fait battre. Elle se sentait plus amante que fille. Delphine parla de Mme de Beauséant. Le roi signerait le lendemain le contrat de mariage entre d’Adjuda et Melle Rochefide. La cousine d’Eugène n’en savait rien encore. D’Adjuda serait absent de son bal. Delphine s’y rendrait grâce à Rastignac. Le lendemain, les deux amants passèrent la journée dans leur nouvel appartement et vers 16 heures, Rastignac retourna à la pension pour chercher le père Goriot. Son état avait empiré et la mère Vauquer réclama à Eugène son loyer et celui de Goriot. Elle lui dit qu’elle avait vu Goriot sortir le matin et emporter ses derniers couverts en argent. Il alla dans la chambre de Goriot. Il le salua et Goriot lui répondit mais Bianchon l’entraîna dans un coin de la chambre pour lui dire qu’il avait fait venir le médecin en chef de son hôpital. Bianchon savait que Goriot était sorti le matin et qu’Anastasie était venue. Eugène fit parler Goriot. Il avait vendu ses couverts pour payer la robe qu’Anastasie avait commandée pour le bal. Il avait engagé sa rente viagère auprès de Gobseck. Rastignac et Bianchon passèrent la nuit à veiller le père Goriot. Anastasie ne vint pas. Elle envoya un commissionnaire chercher l’argent. Le père Goriot parut heureux de cette circonstance car sa fille se serait alarmée de son état. A 19 heures, Thérèse vint apporter une lettre de Delphine. Elle attendait Eugène au bal. Elle lui signalait que Mme de Beauséant avait appris le mariage d’Adjuda et que tout Paris allait se porter chez elle. Si Eugène ne venait pas, Delphine ne savait pas si elle lui pardonnerait cette félonie. Eugène écrivit la réponse. Il attendait le médecin pour savoir si Goriot pourrait vivre car il était mourant. Si le médecin prononçait un arrêt de mort, Eugène demandait à Delphine si elle pourrait se rendre au bal. Le médecin vint à 20h30 sans donner un avis favorable. Il déclara que le mieux serait que Goriot mourût promptement.
Eugène laissa Bianchon auprès de Goriot et partit pour aller porter la triste nouvelle à Delphine. Delphine se préparait pour le bal et semblait indifférente au sort de son père. Elle lui ordonna de se préparer. Eugène était épouvanté de cet élégant parricide. Eugène n’avait pas le courage de déplaire à Delphine ni la vertu de la quitter. Il était prêt à faire à sa aîtresse le sacrifice de sa conscience. Il s’habilla pour le bal. Delphine lui demanda des nouvelles de son père et Eugène ne lui cacha rien. Il voulut aller le voir. Delphine accepta d’y aller mais après le bal. Sur le trajet, Eugène raconta ce que la robe d’Anastasie avait coûté à Goriot. Delphine pleura. Nul désastre de cœur ne fut plus éclatant que ne l’était celui de Mme de Beauséant. Les gens illustrés en tout genre se pressaient autour de la vicomtesse. La vicomtesse semblait calme et personne ne pouvait lire dans son âme. Les plus insensibles l’admirèrent. Elle dit à Rastignac qu’elle tremblait qu’il ne vienne pas. Elle pensait qu’il était ici le seul auquel elle pouvait se fier. Elle lui conseilla d’aimer une femme qu’il pourrait toujours aimer et de n’en abandonner aucune. Puis elle l’envoya chez le marquis pour récupérer les lettres qu’elle avait envoyé son amant. D’Adjuda donna les lettres à Eugène et lui demanda de ne rien dire de lui à la vicomtesse. En retournant auprès de sa cousine, il la trouva en pleurs. Elle prit les lettres et les jeta au feu. Elle lui annonça son désir de partir en Normandie. Elle lui offrit la boîte où elle mettait ses gants. Ils retournèrent au bal. Il resta au bras de sa cousine, dernière et délicate attention de cette gracieuse femme.
Il vit Anastasie qui portait ses diamants pour la dernière fois. Eugène pensa à Goriot sur son lit. A la fin du bal, il ne restait plus qu’Eugène et la duchesse de Langeais laquelle savait les intentions de la vicomtesse et voulut désavouer tout ce qu’elle avait pu dire pour blesser son amie. Elle lui annonça son souhait de se retirer au couvent, étant elle aussi trahie par son amant. Eugène rentra à pied à la pension. Il parla à Goriot qui ne serait pas sauvé. Il lui dit de poursuivre sa destinée modeste. Eugène pensait être en enfer. Le lendemain, Bianchon dit à Rastignac ne plus avoir un liard pour soigner Goriot. Eugène pleura en regardant Goriot qui ne pouvait plus le reconnaître. Avant de partir, Bianchon demanda à Eugène de bien écouter Goriot s’il se mettait à parler pour constater à quel genre d’idées appartiendraient ses discours. Goriot reconnut Eugène et lui demanda si ses filles s’étaient bien amusées. Bianchon l’avait entendu parler de ses filles toute la nuit. Goriot réclama ses filles. Christophe partit sur un signe de Rastignac. Goriot dit que l’enfer était d’être sans enfants. Il voulait guérir pour trouver de l’argent pour ses filles. Christophe revint. Il était allé chercher les filles de Goriot. Anastasie était en discussion avec son mari et ne voulait pas le quitter. Delphine dormait et sa femme de chambre ne voulut pas la réveiller. Goriot avait entendu et ne voulut pas qu’Eugène leur écrive de venir. Il lui conseilla de ne pas avoir d’enfants car leur donner la vie, c’était leur permettre de vous donner la mort. Il n’osait pas y croire mais savait que ses filles ne viendraient pas. Il pleura. Il leur avait donné 800 000 francs. Elles ne pouvaient pas être rudes avec lui. Il avait été bien reçu chez ses filles tant qu’il avait eu de l’argent. Le monde n’était pas beau et Goriot avait vu cela.
Il savait qu’elles avaient eu honte de lui car il manquait d’instruction. Il protesta contre sa souffrance. Il avait donné sa vie à ses filles et souffrait qu’elles ne lui donnent pas même une heure. Il se croyait misérable et justement puni. Il croyait être responsable du malheur de ses filles les ayant habitués à satisfaire leurs fantaisies. Il voulait envoyer Eugène dire à ses filles qu’il lui restait encore des millions. Il préférait qu'elles viennent par avarice plutôt qu'elles ne viennent pas du tout. Eugène promit au père Goriot qu'il allait écrire à ses filles. Le père Goriot pensait que ses filles ne l'avaient jamais aimé. Elles n'avaient jamais su rien deviner de ses propres chagrins ni de ses douleurs. Alors elles ne devineraient pas plus sa mort. Il dit à Eugène que ses filles commettaient un parricide en ne venant pas le voir. Puis il demanda à Eugène d'être un père pour Delphine. Eugène ordonna à Christophe d'aller chercher Bianchon. Épouvanté par les cris et les plaintes du vieillard, Eugène dit au père Goriot qu'il allait chercher ses filles. Puis il fit boire de la tisane au vieillard. Le père Goriot eut le temps de réclamer encore une fois ses filles avant de s'évanouir. Bianchon arriva et Eugène lui expliqua ce qui était arrivé. L'étudiant en médecine lui expliqua qu'il aurait besoin d'argent pour le père Goriot alors Eugène lui offrit sa montre en gage. Puis Eugène s'en alla chercher Anastasie. Mais on lui répondit qu'elle était invisible alors Eugène indigo valait dans quel état se trouvait le père Goriot est. Le comte de Restaud fini par accepter de recevoir Rastignac. Restaud expliqua à que Eugène le père Goriot avait fait le malheur de sa vie car il avait compromis son caractère avec Anastasie. De plus, il ne voulait pas que sa femme quitte la maison. Il demanda à Eugène de rapporter au père Goriot qu'Anastasie lui rendrait visite aussitôt qu'elle aurait rempli ses devoirs envers son mari et son enfant. Alors Eugène demanda au comte de lui promettre seulement de dire à Anastasie que son père n'avait pas un jour à vivre et l'avait déjà maudite en ne la voyant pas à son chevet.
Alors le comte entraîna Rastignac jusqu'à sa femme. Anastasie avait tout entendu et demanda à Eugène de dire à son père que s'il connaissait la situation dans laquelle elle se trouvait, il la pardonnerait. Eugène salua les deux époux en devinant la crise dans lequel était la femme. Il courut chez Delphine et la trouva dans son lit. Elle attendait le médecin. Rastignac insista pour qu'elle vienne voir son père. Elle ne voulait pas croire que son père était aussi malade qu'Eugène le disait. Mais elle ne voulait pas que son père meurt de chagrin à cause d'elle. Alors elle attendrait que le médecin vienne la soigner pour se rendre chez son père. Elle remarqua qu'Eugène n'avait plus la montre qu'elle lui avait offert. Alors il expliqua que son père n'avait plus de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettrait ce soir. Il avait mis sa montre gage car il n'avait plus rien. Delphine sortit de son lit pour prendre sa bourse et la lui donna. Elle décida de l'accompagner. Quand ils arrivèrent dans la chambre du père gros mots, celui-ci avait été opéré par le chirurgien de l'hôpital. Cela était inutile alors le chirurgien et Bianchon replacèrent le mourant à plat dans son lit. Eugène demanda Bianchon l'argent que la montre avait rapporté pour le donner à la veuve Vauquer celle-ci lui réclamait la somme pour le linceul, les draps et la chandelle du père Goriot. Le père Goriot réclama un médaillon qui lui avait été ôté par les médecins. Le médaillon contenait des cheveux. C'était les cheveux de Mme Goriot. Le père Goriot avait fait graver d'un côté du médaillon les prénoms de ses filles.
Le père Goriot poussa un soupir de satisfaction qui devait être un des derniers retentissements de sa sensibilité qui semblait se retirer.
Les deux étudiants furent frappés de ce terrible éclat d'une force de sentiment qui survivait à la pensée et ils pleurèrent. Le père Goriot prononça les prénoms de ses filles. Les dernières paroles du père Goriot furent pour Eugène et Bianchon : « Ah ! Mes anges ! ».
Thérèse avait annoncé à Eugène qu'Anastasie avait demandé à son mari de l'argent pour le père Goriot. Le mari avait refusé et Anastasie s'était évanouie. Anastasie finit par arriver pour constater l'état dans lequel se trouvait son père. Elle pleura et baisa la main de son père. Elle implora sa bénédiction. Elle comprit trop tard que seul son père l'aimait vraiment. Elle avait perdu toutes ses illusions. Son mari était parti en lui laissant des dettes énormes. C'est à ce moment-là que le père Goriot ouvrit les yeux mais par l'effet d'une convulsion. Le père Goriot mourut et Anastasie s'évanouit. Elle fut transportée dans un fiacre et Eugène la confia aux soins de Thérèse, lui ordonnant de la conduire chez Delphine. La veuve Vauquer ordonna qu'on passe à table. Les 15 pensionnaires se mirent à causer comme à l'ordinaire. Leur indifférence glaça d'horreur Eugène et Bianchon. Ils allèrent chercher un prêtre qui veilla le mort toute la nuit. Rastignac écrivit un mot au baron Nucingen et au comte de Restaud pour leur demander d'envoyer leurs gens d'affaires afin de pourvoir à tous les frais de l'enterrement. Mais les deux gendres n'avaient pas répondu. L'étudiant en médecine se chargea donc de mettre lui-même le cadavre dans une bière de pauvre qu'il fit apporter de son hôpital. Bianchon conseilla à Eugène de faire une farce aux gendres et aux filles du père Goriot. Eugène suivit le conseil. Il fit inscrire sur la tombe du père Goriot : « Ci-gît M. Goriot, père de la comtesse de Restaud et de la baronne de Nucingen, enterré aux frais de deux étudiants »
Le coeur d'Eugène se serra quand il se vit dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à Delphine. Il lui écrivit pour lui conseiller de vendre une parure pour que son père soit décemment conduit à sa dernière demeure.
Eugène retourna à la pension et ne put retenir une larme quand il aperçut la bière du père Goriot à peine couverte d'un drap noir et déposée sur deux chaises. La porte n'était pas même tendue de noir. C'était la mort des pauvres. Eugène vit que la veuve avait entre les mains le médaillon à cercle d'or du père Goriot. Il lui demanda comment elle avait osé prendre cela. Il replaça religieusement sur la poitrine du bonhomme le médaillon dans lequel se trouvait une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient vierges et pures, et ne résonnaient pas. Il accompagna avec Christophe le char qui menait le pauvre Goriot à Saint-Étienne-du-Mont. Eugène chercha vainement les deux filles du père Goriot dans l'église. Christophe était venu car il se croyait obligé de rendre les derniers devoirs à un homme qui lui avait fait gagner quelques bons pourboires. Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées mais vides, celle du comte de Restaud celle du baron de Nucingen se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père-Lachaise. Les gens de ses filles étaient venus accompagner le père Goriot jusqu'à sa dernière demeure. Les fossoyeurs réclamèrent un pourboire à Eugène qui n'avait plus rien. Il fut obligé d'emprunter 20 sous à Christophe. Cela détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Eugène regarda la tombe et y ensevelit la dernière larme d'un jeune homme, cette larme arrachée par les saintes émotions d'un coeur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, rejaillissent jusque dans les cieux. Il fit quelques pas vers le haut du cimetière et regardant Paris vers la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il dit ces mots grandioses : À nous deux maintenant ! Son premier acte de défi à la société fut d'aller dîner chez Mme de Nucingen.
Gobseck.
À l'origine, cette nouvelle était un texte écrit à la première personne et au présent, formant un tout. C'était une petite monographie de l'usurier dans laquelle Balzac décrivait cette « variété » parisienne, son aspect extérieur, son habitat et ses moeurs. Balzac racontait une journée de l'usurier pour finir par une conclusion morale. La première version de Gobseck était intitulée L'usurier. Puis, la monographie de l'usurier parisien a fait place à une étude d'adultère. La deuxième version de cette nouvelle a été intitulée par Balzac Les dangers de l’inconduite et l'usurier est revenu au premier plan. La première version de la nouvelle avait été publiée en 1830. La deuxième version avait été publiée en 1835. C'est en 1842 que la nouvelle a pris son titre définitif Gobseck.
La vicomtesse de Grandlieu conseilla à sa fille Camille de changer de conduite avec le jeune comte de Restaud. Elle dit à sa fille qui n'avait que 17 ans que le comte de Restaud avait une mère qui était capable de manger des millions, une femme mal née, une demoiselle Goriot qui jadis avait fait beaucoup parler d'elle. La vicomtesse estimait que cette demoiselle Goriot s'était si mal comportée avec son père qu'elle ne méritait certes pas d'avoir un si bon fils.
Derville écoutait la conversation entre la vicomtesse et Camille. L'oncle de Camille était également présent. Derville raconta une histoire à Camille pour lui permettre de modifier le jugement qu'elle portait sur la fortune du comte Ernest de Restaud. Derville était un avoué de Paris qui normalement n’aurait pu se permettre de parler si familièrement à la vicomtesse qui était une des femmes les plus remarquables du faubourg Saint-Germain. Mais Mme de Grandlieu était rentrée en France avec la famille royale pour habiter Paris où elle n’avait d'abord vécu que de secours accordés par Louis XVIII. L'avoué avait eu l'occasion de découvrir quelques vices de forme dans la vente que la République avait jadis faite de l'hôtel de Grandlieu. C'est lui qui avait permis à la vicomtesse de récupérer son hôtel. L'avoué permit à la vicomtesse de récupérer ses actions sur le canal d'Orléans et certains immeubles assez importants que l'empereur avait donnés en dot à des établissements publics. L'avoué devint alors l'ami de la famille. Mais il ne profita pas de cette faveur comme aurait pu en profiter un homme ambitieux. Néanmoins il était fort heureux que ses talents eussent été mis en lumière par son dévouement à Mme de Grandlieu car il aurait couru le risque de laisser dépérir son étude. Derville n'avait pas une âme d'avoué. Depuis que le comte Ernest de Restaud s'était introduit chez la vicomtesse, Derville avait découvert la sympathie de Camille pour ce jeune homme. Derville avait dit à la jeune fille que le comte de Restaud n'avait pas de fortune. Camille avait répondu qu'elle ne doutait pas qu'il devienne un homme très remarquable le jour où il serait parvenu au pouvoir. Camille avait eu pour l'avoué des attentions inaccoutumées en s'apercevant qu'il approuvait son inclination pour le jeune comte Ernest de Restaud. Derville raconta sa rencontre avec un usurier. L'usurier avait la figure pâle et blafarde et les cheveux soigneusement peignés d'un gris cendré. Les traits du visage de l'usurier paraissaient avoir été coulés en bronze. Il y avait des petits yeux jaunes comme ceux d'une fouine. Il protégeait ses yeux de la lumière avec une vieille casquette.
Il avait le nez pointu et les lèvres minces comme celles de ces petits vieillards peints par Rembrandt. Il parlait bas, d'un ton doux, et ne s'emportait jamais. Tout était propre et drapé dans sa chambre. Ces actions étaient soumises à la régularité d'une pendule. Cet homme s'interrompait au milieu de son discours et se taisait au passage d'une voiture afin de ne pas forcer sa voix. Il économisait le mouvement vital pour concentrer tous les sentiments humains dans le moi. Quelquefois ses victimes criaient beaucoup puis après il se faisait un grand silence, comme dans une cuisine où l'on égorge un canard. Vers le soir l'usurier se changeait en un homme ordinaire et ses métaux se métamorphosaient en coeur humain. Quand il était content de sa journée, il se frottait les mains. Dans ses plus grands accès de joie, sa conversation restait monosyllabique et sa contenance était toujours négative. Derville avait rencontré l'usurier car il était son voisin quand il n'était encore que second clerc et qu'il achevait sa troisième année de droit. Le bâtiment dans lequel Derville et l'usurier habitaient avait été autrefois un couvent. L'usurier ne communiquait socialement parlant qu'avec Derville. Il lui demandait du feu, lui empruntait un livre ou un journal et discutait avec lui le soir quand il était de bonne humeur. Ces marques de confiance étaient le fruit d'un voisinage de quatre années et de la sage conduite de Derville. Derville pensait que la fortune de l'usurier se trouvait dans les caves de la banque. Par une singularité ressemblant à une prédestination, cet homme se nommait Gobseck. Derville travailla pour cet homme et apprit qu'il avait 76 ans. Gobseck était né dans les faubourgs d'Anvers d'une juive et d'un hollandais. À Paris, une femme nommée la belle Hollandaise avait été assassinée. Gobseck avait dit à Derville que cette femme était sa petite nièce. C'était sa seule et unique héritière, la petite fille de sa soeur. Cet homme singulier n'avait jamais voulu voir une seule personne des quatre générations femelles où se trouvaient ses parents. Il abhorrait ses héritiers et ne concevait pas que sa fortune pût jamais être possédée par d'autres que lui, même après sa mort.
Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de 10 ans en qualité de mousse pour les possessions hollandaises dans les grandes Indes où il avait roulé pendant 20 années. Il avait eu des relations avec les plus célèbres corsaires et connu l'amiral Simeuse ainsi que le bailli de Suffren. Gobseck avait bien tout tenté pour faire fortune et avait même essayé de découvrir l'or d'une tribune sauvage aux environs de Buenos Aires. Enfin, Gobseck n'était étranger à aucun des événements de la guerre de l'indépendance américaine. Si l'humanité, si la sociabilité sont une religion, Gobseck pouvait être considéré comme un athée. Derville s'était demandé quelquefois à quel sexe Gobseck appartenait. Il pensait que les usuriers appartenaient au genre neutre. Il se demandait quelle était la religion que pratiquait Gobseck. Derville n'avait jamais rien su des opinions religieuses de l'usurier. Il lui paraissait être plus indifférent qu'incrédule. Par raillerie, ses victimes l'appelaient papa Gobseck. Un soir, Derville trouva Gobseck sur son fauteuil, immobile comme une statue. Derville se demanda si Gobseck savait qu'il existait un Dieu, un sentiment, des femmes, un bonheur. Il le plaignait comme il aurait plaint un malade. Gobseck dit à Derville qu'il ne croyait à rien et lui conseilla de garder ses illusions. Il expliqua au jeune homme qu'il arrivait toujours un âge auquel la vie n'était plus qu'une habitude exercée dans un certain milieu préféré. Pour Gobseck, le bonheur consistait dans l'exercice de nos facultés appliquées à des réalités. Il était persuadé que les conventions pouvaient se modifier suivant les climats. Il ne croyait qu'à l'instinct de notre conservation. Il dit à Derville qu'il n'existait qu'une seule chose matérielle dont la valeur était assez certaine pour qu'un homme s'en occupe, c'était l'or.
L'homme était le même partout : partout le combat entre le pauvre et le riche était établi ; il valait donc mieux être l'exploitant que d'être l'exploité. Le seul sentiment qui survivait partout était la vanité. Et la vanité ne se satisfaisait que par des flots d'or. Gobseck estimait qu'il n'y avait que des dupes qui pouvaient se croire utiles à leurs semblables en s'occupant à tracer des principes politiques pour gouverner des événements toujours imprévus. Il était persuadé que le bonheur consistait ou en émotions fortes usant la vie ou en occupations réglées qui en faisaient une mécanique anglaise fonctionnant par temps réguliers. Gobseck expliqua à Derville que toutes les passions humaines agrandies par le jeu des intérêts sociaux venaient parader devant lui qui vivait dans le calme. En un mot, Gobseck possédait le monde sans fatigue, et le monde n'avait pas la moindre prise sur lui. Gobseck raconta à Derville que le matin même il avait reçu un billet, valeur de 1000 fr., présenté par un jeune homme et signé par l'une des plus jolies femmes de Paris mariée à un comte. Gobseck s'était demandé pourquoi cette comtesse avait-elle souscrit une lettre de change. Il avait voulu connaître la valeur secrète de cette lettre de change.
Il y avait un second billet, d'égal somme, signé Fanny Malvaut qui avait été présenté à l'usurier par un marchand de toile en train de se ruiner. Gobseck savait qu'aucune personne ayant quelque crédit à la banque ne venait dans sa boutique où le premier pas fait dénonçait un désespoir, une faillite près d'éclore et surtout un refus d'argent éprouvé chez tous les banquiers. Gobseck savait que ces deux femmes n'étaient pas en mesure, elles allaient donc le recevoir avec plus de respect que s'il avait été leur propre père. Il restera inébranlable aux câlineries que ces femmes lui réserveraient. Il voulait apparaître comme un remords. Il aimait crotter les tapis de l'homme riche pour lui faire sentir la griffe de la Nécessité. Il était allé voir la comtesse. Aux habits qu'elle portait, il avait deviné une dépense annuelle d'environ 2000 fr. chez ta blanchisseuse. Il avait observé la chambre de la comtesse et remarqué les diamants. Tout était luxe et désordre, beauté sans harmonie. Il avait senti la misère, tapie là-dessous, qui dressait la tête et faisait sentir ses dents aiguës. La comtesse plut à Gobseck. Il y avait longtemps que son coeur n'avait battu. Il était donc déjà payé ! Il était donc prêt à attendre le lendemain pour être payé. Le comte s'était présenté en demandant ce que voulait Gobseck. Anastasie, la comtesse expliqua que l'usurier était un de ces fournisseurs puis elle lui donna un diamant et lui demanda de s'en aller. En sortant, Gobseck aperçut un cabriolet qui entrait dans la cour et dans lequel il reconnut le jeune homme qui lui avait présenté le billet. Il lui tendit 200 fr. et lui demanda de les donner à Mme la comtesse pour le solde représenté par la valeur du diamant. Il ajouta qu'il tiendrait à la disposition de la comtesse pendant huit jours le gage qu'elle lui avait remis le matin même.
En regardant le jeune homme, Gobseck lut sur cette physionomie l'avenir de la comtesse. Il avait deviné que le jeune homme se ruinerait et ruinerait la comtesse et son mari et ses enfants. Après quoi, Gobseck se rendit chez Fanny.
Il observa son appartement et remarqua de nombreux morceaux de toile taillée. Il devina ainsi quelle était son occupation habituelle, elle ouvrait du linge. Il devina que c'était une fille condamnée au travail par le malheur et qui devait appartenir à quelque famille d'honnêtes fermiers car elle avait quelques-uns de ces grandes rousseurs particuliers aux personnes nées à la campagne. Pauvre innocente, elle croyait à quelque chose : sa simple couchette en bois était surmontée d'un crucifix. Cela avait touché Gobseck et il se sentait disposé à lui offrir de l'argent à 12 % seulement. Gobseck prétendait que son regard était comme celui de Dieu et qu'il voyait dans les coeurs. Il était assez riche pour acheter les consciences de ceux qui faisaient mouvoir les ministres, de leurs garçons de bureau à leurs maîtresses. Il pouvait avoir les plus belles femmes et leurs plus tendres caresses. Gobseck prétendait qu'il n'était que 10 comme lui à Paris, rois silencieux et inconnus.
Il voyait la vie comme une machine à laquelle l'argent imprimait le mouvement. Avec ses collègues, Gobseck se rendait à certains jours de la semaine au café Thémis, près du Pont-Neuf pour discuter des mystères de la finance. Ils possédaient les secrets de toutes les familles et ils avaient une espèce de livre noir dans lesquelles se trouvaient les notes les plus importantes sur le crédit public et sur la banque. Gobseck surveillait les fils de famille, les artistes, les gens du monde et les joueurs. Gobseck prétendait être la balance dans laquelle se pesaient les successions et les intérêts du Paris tout entier. Mme de Grandlieu ne voyait rien dans le récit de Derville qui pouvait concerner sa famille. Le jeune homme répondit qu'il allait bien réveiller Camille en lui disant que son bonheur dépendait naguère du papa Gobseck et comme le bonhomme était mort à 99 ans, M. de Restaud entrerait bientôt en possession d'une belle fortune. Quant à Fanny Malvaut, elle était devenue sa femme. Derville reprit son récit. Quelques jours après la conversation qu'il avait eue avec Gobseck, il avait passé sa thèse et il fut licencié en droit puis avocat. Gobseck avait de plus en plus confiance en lui. Il écoutait les conseils de Derville avec une sorte de respect. Derville fut nommé maître-clerc et quitta la maison de la rue de la Grès pour demeurer chez son patron. Il fit ses adieux à l'usurier. Celui-ci n'avait manifesté ni amitié ni du plaisir. Mais il revint le voir huit jours plus tard pour lui apporter une affaire assez difficile, une expropriation. Il continua ses consultations gratuites avec Derville. Le patron de Derville fut obligé de vendre sa charge en 1819. Alors Derville s'en alla prier Gobseck. L'usurier était déjà au courant de la faillite du patron de Derville. Il fallait bien cela pour que Derville lui rende visite. Derville lui expliqua son projet. L'étude de son patron rapportait annuellement une vingtaine de 1000 fr. et il espérait pouvoir en retirer 40 000. Il voulait que Gobseck lui prête la somme nécessaire pour acheter la charge et il promettait de le rembourser sur 10 ans. Gobseck lui demanda son âge. Derville avait 25 ans. Gobseck lui demanda de revenir le lendemain avec son extrait de naissance. C'est ce que fit Derville. Après avoir lu le document officiel, Gobseck proposa à Derville de lui prêter la somme avec 13 % d'intérêt par an. Derville accepta. Gobseck le recommanderait comme le plus savant et le plus habile des avoués. Il chargerait ses confrères d'envoyer à Derville leurs expropriations. Gobseck décida d'acheter lui-même la charge du patron de Derville. Derville pourrait ainsi continuer les affaires de l'usurier sans exiger d'honoraires tant que Gobseck serait en vie. Gobseck lui proposa de venir le voir à 17:00 à la Bourse et ainsi il lui apprendrait à connaître les hommes et surtout les femmes.
Gobseck lui conseilla de ne pas faire de folies et il s'informerait de ses affaires. Derville lui demanda de quelle importance était son extrait de baptême dans cette affaire. Gobseck répondit qu'avant l'âge de 30 ans la probité et le talent étaient encore des espèces d'hypothèques. Passé cet âge, on ne pouvait plus compter sur un homme selon lui. Grâce à son succès, Derville put rembourser Gobseck au bout de cinq ans. Fanny Malvaut était devenait riche en héritant d'un de ses oncles fermiers qui lui avaient laissé 70 000 fr. Cette somme permit à Derville de s'acquitter. Sa vie ne fut que bonheur et prospérité. Un an après l'acquisition de son étude, Derville fut entraîné dans un déjeuner de garçon. Il rencontra Maxime de Trailles. Un de ses clients, le père Goriot lui en avait déjà parlé. Mais il avait évité plusieurs fois le dangereux honneur de sa connaissance. Mais un de ses camarades avait insisté pour le lui présenter. M. de Trailles avait essayé de s'insinuer dans les bonnes grâces de Derville. Derville lui avait donc promis de l'amener le lendemain chez Gobseck. Mais Derville ne se doutait nullement de l'importance qu'il y avait pour Gobseck à se raccommoder avec ce dandy de Trailles. À cause de l'alcool, Derville avait oublié sa promesse de réconcilier Trailles avec l'usurier. Mais il ne voulait pas manquer à sa parole et il le conduisit chez Gobseck. Derville remarqua l'inquiétude de Trailles quand ils arrivèrent devant l'immeuble.
Trailles distingua une femme au fond d'une voiture et son visage afficha une expression de joie presque sauvage.
Gobseck savait que ses collègues avaient le ventre plein des enculés lettres de change qu'ils avaient contractées avec Trailles. Il demanda au dandy pourquoi il accepterait de lui prêter de l'argent alors qu'il devait déjà 30 000 fr. à ses collègues. Alors le jeune homme sortit pour aller chercher quelque chose qui satisferait l'usurier. Gobseck le remercia Derville de lui avoir amené Trailles, pensant que c'était une plaisanterie que ses collègues lui avaient faite. Il comptait rire à leurs dépens. Trailles revint avec une jeune femme. C'était l'une des filles du père Goriot. Elle avait l'air angoissé. C'était la comtesse de Restaud. Trailles était devenu pour elle un mauvais génie. Derville admirait Gobseck car, quatre ans plus tôt, il avait compris la destinée de ces deux amants sur une première lettre de change. Derville frémit d'horreur en contemplant Trailles car elle ressemblait à un ange et il se présenta devant son juge. La comtesse demanda à Gobseck de lui prêter de l'argent contre des diamants qu'elle laissait en gage. C'est Derville qui répondit que c'était possible. La comtesse le regarda et le reconnut en laissant échapper un frisson.
Gobseck regarda les diamants et ses yeux brillaient d'un feu surnaturel. Trailles demanda 100 000 fr. La comtesse était plongée dans une stupeur comme si elle mesurait la profondeur du précipice dans lequel elle allait tomber.
Alors Derville essaya de la sauver en lui demandant si elle était propriétaire des diamants. Elle acquiesça. Il lui demanda si elle était mariée. Elle acquiesça encore. Alors Derville refusa de faire l'acte. Gobseck demanda pourquoi. Derville lui expliqua que l'acte serait nul et Gobseck serait tenu de représenter les diamants. Alors Gobseck se rangea à son avis. Il ne proposa que 80 000 fr. aux deux amants. De plus, la comtesse ne pourrait plus revenir les racheter. C'était à prendre ou à laisser. Derville conseilla à la comtesse de se jeter aux pieds de son mari et elle hésita. Trailles chuchota à l'oreille de la comtesse. Derville comprit que c'était des paroles d'adieu. Alors Anastasie accepta la proposition de Gobseck. Usurier remit à la comtesse un bon de 50 000 fr. sur la banque et les lettres de change de Trailles d'une valeur de 30 000 fr. Le jeune homme poussa un rugissement au milieu duquel domina le mot : « vieux coquin ! ». Alors l'usurier sortit son pistolet et menaça le jeune homme. La comtesse demanda à Maxime de présenter ses excuses et il obéit. La comtesse salua il s'en alla. M. de Trailles fut forcé de la suivre mais avant de partir il menaça de les provoquer en duel s'ils ébruitaient cette affaire. Gobseck lui répondit que pour jouer son sang, il fallait en avoir. Il estimait que le jeune homme n'avait que de la boue dans les veines. Après quoi, l'usurier se mit à danser en répétant : « j'ai les diamants ! J'ai les diamants ! ». Cela fit tressaillir Derville. Gobseck proposa à Derville de déjeuner avec lui mais le jeune homme refusa. Puis le comte de Restaud arriva. Il demanda si sa femme sortait de chez Gobseck. L'usurier répondit que c'était possible. Le comte protesta car sa femme était en puissance de mari et ne possédait pas les diamants. Gobseck n'aurait pas dû les acheter. Il menaça l'usurier de lui faire un procès. Mais Derville expliqua au comte qu’un procès risquait de mettre sa femme en cause. Il lui conseilla donc de transiger avec Gobseck. S'il acceptait de racheter les diamants sur une durée de sept à huit mois l'affaire serait close. Le comte remercia Derville. Derville prépara un acte par lequel le comte reconnu avoir reçu de l'usurier une somme de 85 000 fr., intérêts compris pour pouvoir récupérer les diamants. Le comte signa et l'usurier lui demanda s'il avait des enfants. Le comte refusa de répondre. Alors Gobseck rétorqua que la comtesse était un démon qu'il aimait peut-être encore alors s'il voulait sauver sa fortune pour la réserver à ses enfants le comte pourrait toujours venir le trouver. Le comte s'en alla en disant qu'il fournirait la somme dès le lendemain. Cette scène avait initié Derville aux terribles mystères de la vie d'une femme à la mode. Quelques jours plus tard, le comte se rendit chez Derville pour lui demander ce qu'il pensait de Gobseck. Derville répondit que Gobseck était son bienfaiteur à 15 %. Le comte de Restaud ne s'attendait pas à trouver un ange dans un prêteur sur gages. Mais Derville affirma que Gobseck, sorti de ses affaires, était l'homme le plus délicat et le plus probe qu'il y avait à Paris. Il le voyait à la fois comme avare et philosophe, petit et grand. Le jour où Derville avait porté la somme qui l'inquiétait envers Gobseck, il lui avait demandé quel sentiment l'avait poussé à lui faire payer de si énormes intérêts. Gobseck lui avait répondu qu'il voulait le dispenser de la reconnaissance en lui donnant le droit de croire qu'il ne lui devrait rien et ainsi ils resteraient les meilleurs amis du monde. Le comte de Restaud était convaincu et il demanda à Derville de préparer les actes nécessaires pour transporter à Gobseck la propriété de ses biens. De plus, il demanda à Derville d'être le dépositaire de la contre-lettre car il redoutait de confier ce document à sa femme. Derville accepta à condition que le comte fixe la part de ses enfants par les dispositions de la contre-lettre. La vicomtesse demanda à sa fille Camille d'aller se coucher car elle n'avait pas besoin de tableaux effrayants pour rester pure et vertueuse. Puis elle dit à Derville qu'il était allé trop loin car les avoués n'étaient ni des mères de famille ni des prédicateurs.
Elle lui demanda de continuer son récit. Trois mois plus tard, Derville n'avait toujours pas reçu la contre-lettre que le comte devait lui laisser. Gobseck lui apprit que le comte était mourant. Derville résolut d'aller voir le comte. Mais Anastasie lui expliqua que le comte ne voulait voir personne. Derville comprit qu'Anastasie ne le laisserait jamais parvenir jusqu'à son mari.
Quand le comte tomba malade, son aversion pour la comtesse et pour ses deux derniers enfants se manifesta. Il leur interdit l'entrée de sa chambre. La comtesse avait compris les intentions de son mari quand elle avait vu les biens de la famille passer entre les mains de Gobseck. Trailles était parti en Angleterre pour fuir ses créanciers. Lui seul aurait pu apprendre à la comtesse les précautions secrètes que Gobseck avait suggérées à M. de Restaud contre elle. Le comte avait obtenu la signature de sa femme ce qui était indispensable pour valider la vente des biens. Alors Anastasie régna despotiquement dans sa maison à la recherche des documents que son mari avait cachés. À cette époque, Anastasie expiait par des larmes de sang les fautes de sa vie passée. Elle cherchait à reconquérir la fortune de son mari pour réparer ses torts envers ses enfants. Elle interrogeait Ernest dès qu'il sortait de la chambre de son père et l'enfant se prêtait complaisamment aux désirs de sa mère. Anastasie voulut voir en Derville le ministre des vengeances du comte et résolut de ne pas le laisser approcher du mourant. Derville était inquiet car si la comtesse trouvait les contre-lettre cela aurait provoqué des procès interminables contre Gobseck.
Anastasie tenta de séduire Derville pour le dominer mais elle échoua. Mais Derville résolut de sauver cette famille de la misère qui l'attendait. Il fit poursuivre le comte de Restaud pour une somme due fictivement à Gobseck et il obtint des condamnations. Derville obtint ainsi le droit de faire apposer des scellés à la mort du comte. Il réussit à convaincre un domestique de le prévenir au moment même où son maître serait sur le point d'expirer. Le chagrin avait éteint tous les sentiments humains du marquis qui se complaisait dans la maladie. Il demanda à son valet d'aller chercher Derville. Le valet qui était acquis à la cause d'Anastasie demanda ce qu'il fallait faire. Anastasie lui conseilla de mentir en disant que Derville était parti loin de Paris pour un procès important. Alors le comte parla à Ernest. Il lui confia un secret que l'enfant ne devrait pas répéter à sa mère. Il donna un paquet à son enfant qui était destiné à Derville. Il lui expliqua que dans six ou sept années il comprendrait l'importance de ce secret et il serait alors bien récompensé de sa fidélité. Anastasie voulut interroger son enfant mais le comte sortit de sa chambre pour l'en empêcher. Anastasie tomba évanouie et le comte retourna dans sa chambre. Il perdit connaissance quelques heures plus tard. Les prêtres lui administrèrent les sacrements et il expira. Derville arriva à ce moment-là avec Gobseck. Ernest vint le trouver pour lui dire que sa mère voulait être seule dans la chambre du comte. L'enfant voulut s'interposer pour empêcher Gobseck et Derville d'entrer dans la chambre mais Gobseck le repoussa. Anastasie avait fouillé tous les tiroirs et le secrétaire à la recherche des précieux documents. Anastasie avait trouvé les papiers qui étaient cachés sous l'oreiller de son mari. Elle les avait jetés dans la cheminée. Derville réussit à retirer de la cheminée un fragment que le feu n'avait pas atteint. Il déclara à Anastasie qu'elle venait de ruiner ses enfants. Il lui fit croire que les papiers étaient les titres de propriété.
Gobseck était devenu propriétaire des biens du comte de Restaud. Après quoi, Derville avait peu vu l'usurier. Il lui avait demandé d'aider Ernest mais l'usurier avait refusé. Plus tard, Derville était venu trouver Gobseck pour l'instruire de l'amour qu'Ernest portait à Mlle Camille en le pressant d'accomplir son mandat mais l'usurier ajourna sa réponse. Gobseck était devenu le liquidateur des biens des colons à Saint-Domingue après l'indépendance d'Haïti. Cela avait augmenté sa fortune. Sentant sa mort venir, Gobseck fit convoquer Derville. L'usurier se demandait à qui son or irait-il. Il avait fait un testament et demanda à Derville de le trouver. Avant de mourir, Gobseck avait énuméré la liste de ses richesses. Derville ordonna au domestique de Gobseck de courir chez le juge de paix pour que les scellés soient promptement posés. Puis il alla visiter les chambres du premier et du second étage. Il découvrit des aliments avariés. Il y avait des meubles, de l'argenterie, des tableaux, des livres. C'était probablement des cadeaux et des gages que l'usurier avait conservé fautes de paiement. Il y avait aussi des billets de 1000 fr. dans un livre. Derville n'avait jamais vu dans le cours de sa vie judiciaire pareils effets d'avarice. Derville découvrit également une correspondance entre Gobseck et les marchands auxquels il vendait habituellement ses présents. Mais chaque marché s'était trouvé en suspens. Ce qui expliquait que pendant les discussions les marchandises s'étaient avariées. Derville n'avait trouvé aucun héritier à l'usurier. Il expliqua à la comtesse que le comte Ernest de Restaud serait sous peu mis en possession d'une fortune qui lui permettrait d'épouser Camille.


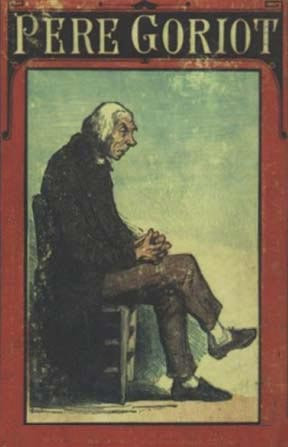


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)